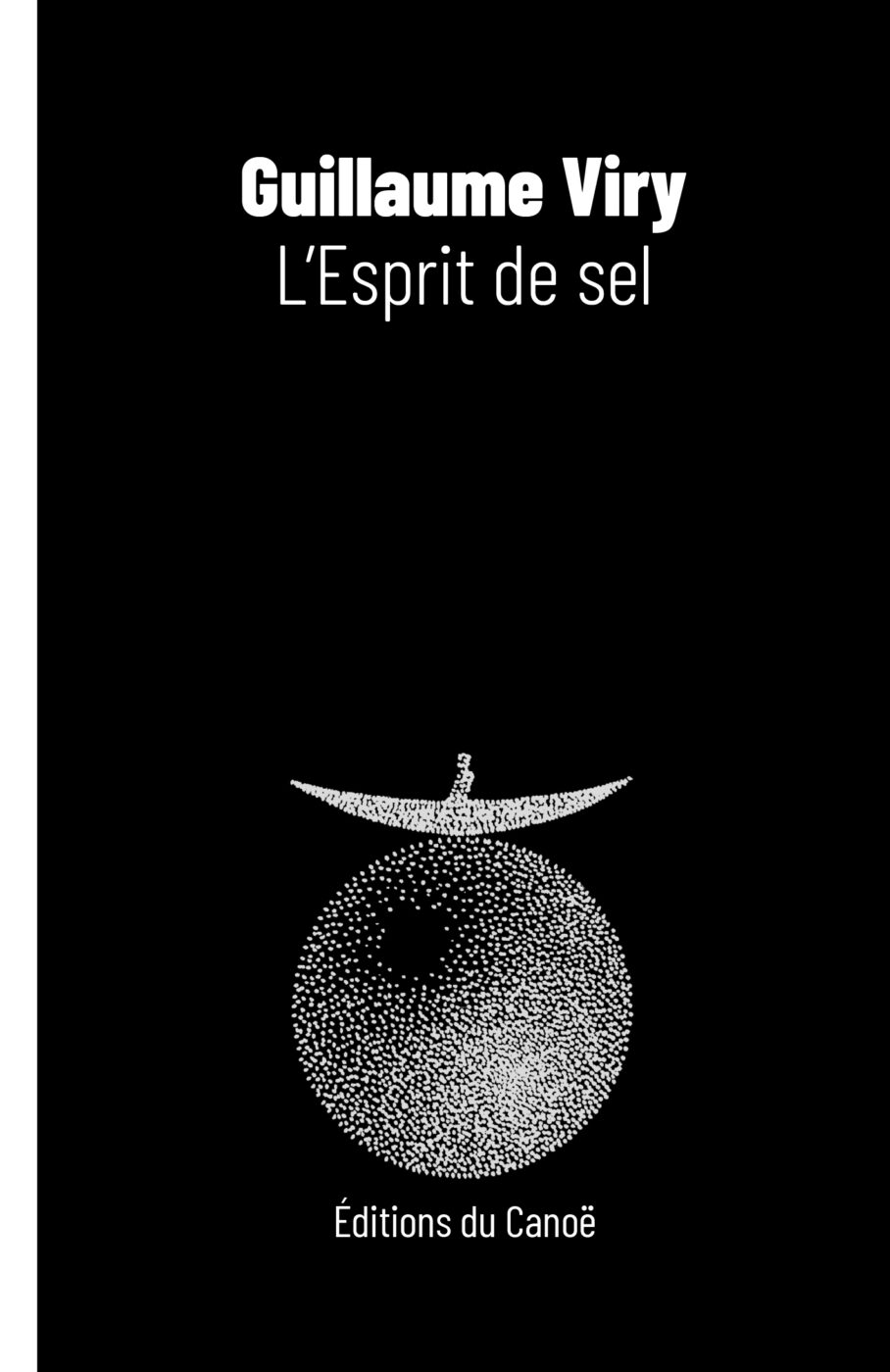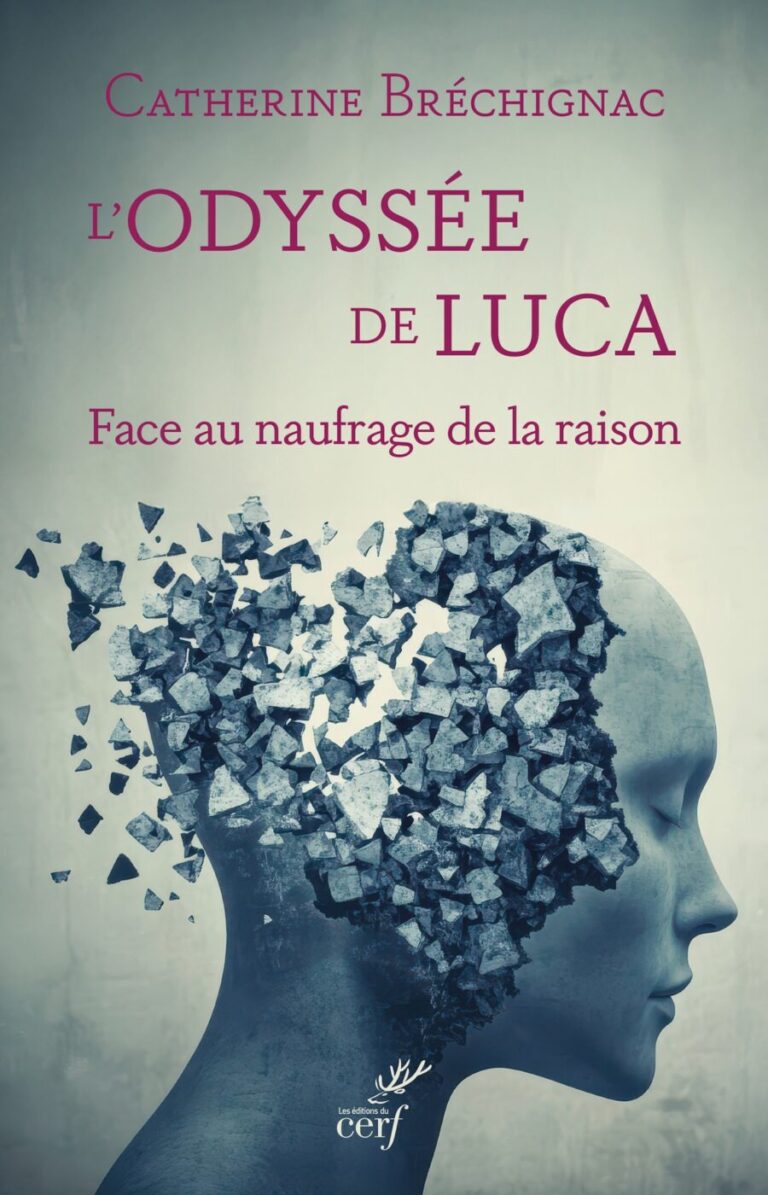Guillaume Viry, L’Esprit de sel, Éditions du Canoë, 14/01/2026, 144 pages, 16€
Dans les plis d’une prose dépouillée qui épouse le tremblement de l’exil, Guillaume Viry retrace le parcours d’Ita, juive polonaise traquée entre les plaines de Sieradz et la chambre close du 35 rue des Rosiers, à Paris, en juillet 1942. Le récit tisse une langue où le sel cristallise toutes les métamorphoses de la survie : conservateur des harengs paternels, larme durcie, statue biblique, poison final. Ce poème narratif explore un paradoxe vertigineux : comment raconter l’impossibilité même de raconter lorsque le monde se referme entièrement ?
Le legs paternel et la fabrique d'une voix
Guillaume Viry ouvre son livre dans les plaines polonaises de l’entre-deux-guerres. Mendel vend des harengs, beugle, titube, rentre « à l’envers » après ses journées sans vente. Il sait que « les jours d’après c’est plus du hareng c’est plus rien que du sel ». Pourtant, dans cette déchéance, il transmet à Ita une histoire hassidique empruntée à Martin Buber : celle d’un paralytique guéri par le seul pouvoir du récit. Le grand-père paralysé raconte comment son maître priait en sautillant, se lève pour mimer ces mouvements, et « à dater de cette heure il fut guéri ». Mendel enseigne ainsi que raconter peut défaire la paralysie, dissoudre le sel qui fige : « si un jour le monde veut te changer en statue de sel chère Ita si un jour le monde entre dans sa folie blanche voulant te rendre paralysée ce jour-là ne l’oublie pas raconte ». La répétition anaphorique (« raconte dit Mendel ne beuglant plus raconte ») scande le texte comme une incantation prophétique qui résonnera jusqu’aux dernières pages.
Pessa, la mère, lègue à Ita un dé à coudre : « si un jour tu dois partir Ita pars avec ton dé et tu pourras aller à n’importe quel endroit du monde ». L’artisanat devient talisman de survie. Ita découvre aussi l’amour avec Jozef, fils d’horloger, rêve avec lui d’une boutique à Gdansk où elle verrait la mer. Mais c’est surtout sa propre voix qui se forge, dans des déclarations bâties sur l’anaphore « je suis celle… » : « je suis celle qui ne se plaint pas », « je suis celle qui parle », « je suis celle qui veut voir la mer ». Ces formules reviennent tout au long du livre comme un socle identitaire inébranlable. Ita apprend que « dire ses mots les mots à soi » constitue « une véritable existence », mais cette affirmation s’accompagne du sentiment d’une trahison envers les parents. La langue à soi devient « lieu secret » inviolable, ultime bastion face aux persécutions futures.
Les premiers signes de haine surgissent à Lodz : « vous les juifs vous ne devriez pas exister ». Mendel et Pessa meurent de misère avant la catastrophe. Jozef part pour l’Amérique. Ita se retrouve seule, déjà étrangère « à l’endroit de sa naissance ».
Les fuites successives
Guillaume Viry condense les exils d’Ita en une série de rétrécissements spatiaux. À Bruxelles, elle travaille et dort dans un atelier de couture, ne connaît rien de la ville. Les nuits, elle perçoit son corps recouvert d’« une fine pellicule de givre », image du gel intérieur qui préfigure la pétrification finale. La mer, fantasmée depuis l’enfance, reste horizon impossible. À Ostende, elle plonge enfin ses pieds nus dans le sable, s’allonge sur la plage, mais doit repartir dès le lendemain. Guillaume Viry écrit : « ce n’est pas la petite fille de Sieradz qui découvre la mer c’est la femme bringuebalée ». Le rêve s’accomplit une fois déjà périmé. Le lendemain, elle court sur les pontons en criant « l’Amérique l’Amérique » devant des hommes qui rient. Cette scène condense l’absurdité tragique de l’exil : une femme seule hurlant le nom d’un continent inaccessible.
À Paris, elle sollicite députés et ministres avec la langue humble des suppliques administratives. Le refus tombe : « le papier est rouge il est écrit refus de séjour ». L’absence de ponctuation traduit le choc. Ita épouse un inconnu pour obtenir des papiers, mais fuit le restaurant de noces, court jusqu’à la gare. Quand elle reçoit la lettre de Jozef annonçant son mariage américain, quelque chose se brise : « la phrase est courte la phrase courte se cache dans les replis de la longue lettre je ne lis que la phrase courte je la relis ». La répétition obsessionnelle mime l’incapacité à avancer dans la lecture.
L'encerclement et l'effondrement de la parole
Juillet 1942. Guillaume Viry resserre l’espace autour de la petite chambre du quatrième étage du 35 rue des Rosiers. Ita refuse de coudre l’étoile jaune : « je ne suis pas celle que vous voulez réduire à votre risible morceau de tissu jaune ». La formule « je suis celle… » atteint son point culminant, devient litanie de résistance : « je suis celle qui échappe je suis celle qui n’a fait qu’échapper je serai toujours à l’endroit où vous ne m’attendrez pas ». Les phrases sans ponctuation se déversent en flux continu, traduisant l’urgence d’affirmer son existence contre l’effacement programmé. Les anaphores fonctionnent comme des verrous syntaxiques, des bastions de parole contre l’anéantissement.
Pourtant, le livre expose simultanément l’effondrement de cette résistance. La langue se délite. Ita perd la notion du temps, s’absente à elle-même. Guillaume Viry traduit cette désintégration par des phrases qui s’étirent sans ponctuation puis se brisent : « je ne sais pas son nom un oiseau de la grande ville un petit oiseau maigre il est resté longtemps je l’ai regardé nous nous sommes regardés ». La syntaxe juxtapositive mime la conscience qui se déstructure. L’histoire hassidique échoue. Raconter ne suffit plus. Ita dit à son père mort : « je raconte cher père je raconte mais je suis déjà la statue de sel cher père les mots du récit s’éparpillent dans le vent ». La répétition de « cher père » scande l’invocation désespérée d’une transmission devenue inopérante.
Et la parole devint sel
Puis vient l’effondrement définitif : « ma parole est devenue blanche entièrement cher père alors qu’elle devrait dire l’immondice qu’elle devrait être le hurlement elle est le blanc elle est la séparation du monde ». Le blanc, jusque-là figure de la peur et du gel, devient l’impossibilité même de dire. La parole ne peut plus témoigner : elle échoue, s’échoue, ne dit plus que « la disparition ». Le 16 juillet 1942, jour de la rafle, Ita boit l’esprit de sel. Le « verre rempli d’écume de mer » accomplit une dernière métamorphose : elle refuse la pétrification mais se dissout elle-même.
Guillaume Viry signe un texte hybride, entre témoignage et élégie, où la forme porte le poids de l’indicible. Ce n’est ni tout à fait un roman ni tout à fait un poème : c’est un long chant funèbre construit sur des anaphores, des ressassements, une syntaxe déponctuée qui mime la respiration haletante de la fuite. Le sel traverse toutes ses incarnations : conservateur, larme, statue, poison. La voix d’Ita, qui raconte depuis sa propre mort, interroge les limites du témoignage. En creusant une langue minimale qui refuse toute surcharge, Guillaume Viry atteint une nécessité tragique : celle d’un récit qui s’efface en se racontant, à l’image de celle qu’il porte.