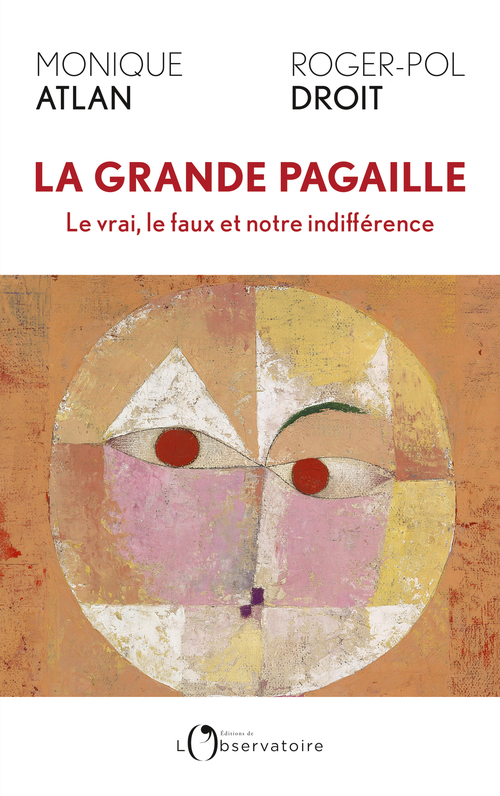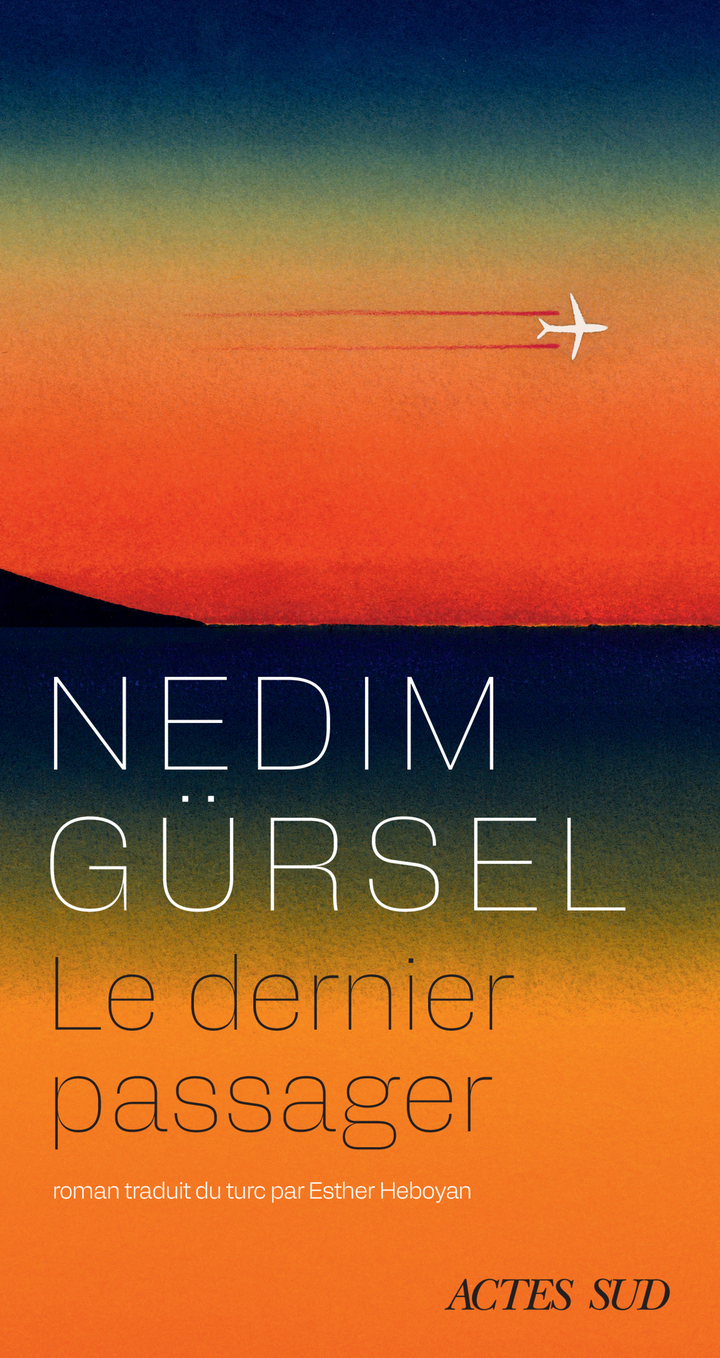Hélène Lotito, Comme pour se battre, Éditions Fugue, 23/01/2026, 205 pages, 20 €
Une voix d’enfant d’abord : celle de Nana, dix ans, qui mange des fleurs de tilleul entre les rafales de mitraillettes et les youyous d’Alger. Puis la fissure, l’exil vers une France grise, l’effilochement d’une sœur adorée. Avec Comme pour se battre, son premier roman publié aux éditions Fugue, Hélène Lotito déploie en un souffle l’arc d’une enfance fracassée par la guerre civile algérienne et recomposée, pastel après pastel, dans la quête obstinée du bleu.
Alger en éclats : l'enfance dans la fournaise (1991-1994)
Hélène Lotito choisit d’entrer dans la décennie noire algérienne par le biais le plus déconcertant qui soit : le bavardage d’une gamine de CM1. Nana Mostat, fille d’un père français et d’une mère algéroise qu’elle appelle « yemma », grandit dans le quartier de Ben Aknoun, fréquente l’école française, reçoit chaque matin un croissant du boulanger qui la salue d’un “C’est toujours gratis pour la petite Française !” aux dents d’or étincelantes. La guerre civile, elle l’entend à travers les cloisons : les mots chuchotés de ses parents la nuit, les mitraillettes de la caserne voisine dont la maîtresse “a pété un plomb”, les barrages de faux militaires adolescents sur la route du restaurant de poissons. Ce qui sidère, c’est la cohabitation du trivial et du tragique sous un même regard enfantin : on passe des querelles de cour de récréation (les « Cheh » vengeurs de Soraya, meilleure amie kabyle aux yeux bleus) à l’annonce de la mort du père de Jessica dans un attentat-suicide, puis à l’assassinat des parents d’un camarade par des terroristes, sans que la voix ne change de registre, car c’est précisément ainsi qu’un enfant reçoit l’horreur, par à-coups, entre deux parts de gâteau et une leçon de conjugaison du verbe battre.
Ce regard enfantin capte aussi, avec une acuité involontaire, les lignes de fracture identitaires. Nana vit entre deux langues, deux religions (le catéchisme du père, l’islam de la famille maternelle), deux nationalités que le passeport bordeaux ne suffit pas à réconcilier. Son père veut que ses enfants connaissent les deux cultures “pour pouvoir bien les rejeter quand on sera ado”, puis il rigole ; la mère exige le silence devant les grands-parents. Le roman capte la géographie affective d’Alger avec une attention maniaque au détail sensoriel : le tilleul dont on grignote les fleurs à la récréation, la boutique du trabendo borgne, les cassettes Cadic piratées par l’État, le racisme ordinaire de la famille maternelle envers les Noirs qu’une fillette de dix ans conteste déjà. Et surtout les pastels Sennelier, commandés à Paris par l’entremise d’une collègue du père, qui ouvrent à Nana un espace de souveraineté absolue : “C’est la première fois que je n’ai besoin de personne, et je sais que je serai toujours heureuse.” Hélène Lotito fait de cet objet l’ancrage d’une vocation à naître, le seul territoire que l’exil ne pourra confisquer.
Villetaneuse, ou l'asphyxie (1994-1998)
Le départ de Souad, la sœur aînée, incendiaire et magnifique, vers la France constitue la première déchirure. La scène où yemma annonce la nouvelle à Nana, la soupière de chorba qui explose au sol, le corps de l’enfant agrippé à la hanche de sa sœur sur une chaise de cuisine, atteint une violence physique à laquelle rien ne préparait. Puis c’est Nana elle-même qui prend le train, à douze ans, seule, empaquetée dans quatre couches de laine par une mère terrorisée par le froid. “Par la fenêtre : du gris et du gris. Quand je me penche : le ciel, les façades des immeubles et les trottoirs, gris. Les gens même, gris.” La France promise se révèle un petit appartement de Villetaneuse où Souad, rebaptisée « Sophie » pour effacer l’arabe de son prénom, tente de se réinventer. Ce changement de nom cristallise l’un des nœuds les plus subtils du roman : la honte identitaire comme stratégie de survie, que Nana refuse d’adopter, elle dont le prénom suscite partout le ricanement mais qu’elle revendique avec une obstination silencieuse.
Hélène Lotito orchestre avec une habileté singulière le glissement de la voix narrative : l’enfant bavarde cède la place, presque imperceptiblement, à une adolescente qui observe, encaisse, se tait. Les lettres envoyées aux parents restent sans réponse. Les dessins passent du bleu des paysages algériens au vert et gris. Les journées se fondent en une “longue apnée”. La scène de la chaîne hi-fi fracassée, où la rage muette de la fillette explose enfin, répétant trois fois “Je ne veux pas vivre cette vie de merde”, donne à la douleur de l’exil sa forme la plus crue, dans la destruction des objets. La vie des deux sœurs oscille entre tendresse féroce et chaos : Souad lance un youyou debout sur le lit, prépare des baklavas hors Ramadan parce qu’ici, “si je veux faire des baklavas, je les fais” ; puis elle rentre le regard vague, “rouge, mort et fou à la fois”, et Nana se contracte jusqu’à ce “point zéro” où plus rien ne peut atteindre. Le roman ne détourne pas non plus le regard de la violence que la rue française inflige aux corps vulnérables : la nuit où Nana est traquée, blessée, ramenée à la pharmacie, transforme la « liberté » promise en menace concrète et retourne l’exil contre lui-même.
Le corps, dans cette partie, devient le champ de bataille central. Souad s’amenuise, ses épaules se chargent d’os, ses essoufflements se multiplient ; la spirale qui l’emporte mêle dérèglements, addictions, vomissements, effondrements. Hélène Lotito se garde de nommer cliniquement ce qui détruit sa créature : elle décrit, montre les bras “noueux en fil de fer”, les mains crispées, le corps qui pèse quarante-sept kilos, et laisse au lecteur le soin de mesurer l’ampleur du désastre. Nana, elle, rêve d’une ronde de petits gâteaux au miel, à la figue, au beurre, dont elle ne bougerait plus. Le contraste entre ces deux rapports au corps dessine les versants symétriques d’un même refus du monde tel qu’il s’impose.
Le bleu retrouvé, le bleu perdu (1998)
La rencontre avec Erwann, lycéen breton aux yeux “bleus comme pas permis”, ouvre dans l’existence cadenassée de Nana un espace inattendu. Hélène Lotito écrit la naissance du désir sans effets de manche : une main brûlante qui saisit une autre main, un silence partagé dans une cour de lycée, et sous les paupières fermées de Nana une petite fille qui tourne dans sa robe bleue et blanche, “que j’ai cru morte”. L’amour tient ici moins de la rédemption que de la preuve d’existence ; quand Nana rit en découvrant les maquettes de fusées d’un garçon qui rêve d’astrophysique, c’est le corps de l’adolescente qui se réconcilie avec la joie, provisoirement.
Car le roman refuse la consolation. Le lien sororal, fil conducteur obsédant du livre, se tend jusqu’à la rupture. Souad sombre : l’hôpital, la maison de repos aux hortensias absents, la grossesse dont l’issue défait ce qui restait de la jeune femme, les murs roses et les linoléums antidérapants d’une institution qui tient davantage du mouroir que du refuge. Dans cette salle saturée de malheur, Hélène Lotito maintient intacte, par la seule force de l’écriture, la splendeur d’un être que la vie consume : Souad demeure “la plus belle princesse d’Égypte qu’on ait jamais vue”, celle dont le regard “intime aux siens de l’abandonner” et “ordonne les planètes d’un froncement de sourcil”. C’est à cette tension entre la majesté de Souad et sa destruction que le roman emprunte sa force la plus vive, et c’est de là que le dernier geste de Nana tire sa brutalité. Le titre, emprunté à Nicolas Mathieu, dit exactement cela : « comme pour se battre », l’élan d’un corps qui se jette vers l’avant sans savoir ce qu’il trouvera, un arrachement qui ressemble autant à une fuite qu’à une naissance, et dont le dernier mot claque comme une porte.
Avec cette prose en apnée qui épouse les soubresauts d’une conscience en formation, sans jamais lisser la violence ni la tendresse qui la traverse, Hélène Lotito signe un premier roman où le bleu d’enfance, le gris d’exil et le rouge des corps abîmés composent une palette qui n’appartient qu’à elle.