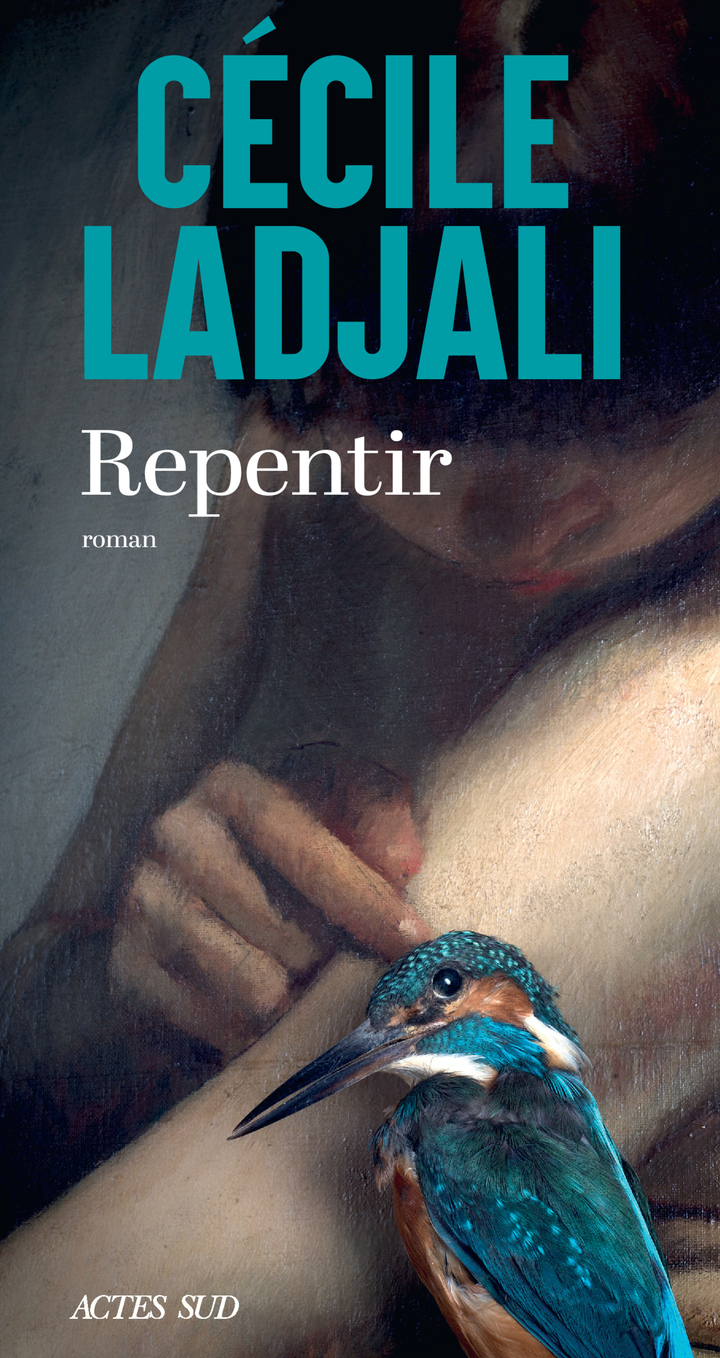Cécile Ladjali, Repentir, Actes Sud, 07/01/2026, 288 pages, 21,80€
Dans la cage en verre du fumoir de Roissy, noyée sous une lumière verte, Charlotte lâche une phrase qui ressemble à une prière : « Faites que j’arrête. » Elle parle de la cigarette, bien sûr. Mais Cécile Ladjali place d’emblée plus haut l’enjeu : arrêter de se mentir, arrêter de confondre le désir et la faute, arrêter de jouer au bord du vide comme si l’on pouvait en sortir indemne.
Repentir n’est pas un simple roman sur le théâtre. C’est un dispositif de jugement : la scène, la cellule, l’église et l’atelier s’y renvoient leurs ombres, jusqu’à rendre instable la frontière entre le rôle et la vie. Le titre le dit : repentir, au sens moral, mais aussi au sens pictural ; la retouche, la reprise, la trace d’un geste corrigé. Tout le livre revient à cette question : que peut la parole une fois l’acte posé, quand il n’est plus possible de faire comme si de rien n’était ?
Février–mars : la zone de transit
L’ouverture installe Charlotte dans l’entre-deux : entre Paris et Marseille, entre un âge « difficile » pour une comédienne et l’obstination de remonter sur scène, entre une liberté revendiquée et une dépendance affective qui la travaille. Octave, metteur en scène de ses débuts, lui confie un texte anonyme, Coupable (?), et lui propose une consigne à la fois simple et vertigineuse : jouer Claire « coupable » ou « innocente », et changer d’option si elle le souhaite. Ce dispositif n’est pas un jeu intellectuel : il devient la forme même du roman, qui refuse la case confortable du verdict.
Le sacré, chez Cécile Ladjali, ne descend pas du ciel : il suinte des objets. Le cendrier du fumoir ressemble à « une vasque de baptistère », la poignée de porte est « cruciforme », la cabine se transforme en « crypte ». Charlotte prie « même si elle ne croit pas en Dieu », fréquente l’église du Saint-Esprit, relit l’Annonciation de Simone Martini jusqu’à y reconnaître une grammaire du désir. La langue religieuse devient matière : or, feu, souffle. Et quand l’Ave Maria se dérègle, quand les mots semblent entrer « à l’envers » dans l’oreille, c’est tout l’ordre du sens qui vacille.
Dans ce premier mouvement, l’un des coups de force du livre est l’insertion régulière de fragments In carcere : une voix enfermée, un œil collé au judas, un temps mesuré au bruit des clefs. Ce contrechamp n’est pas un ornement noir : il rappelle que le théâtre et la prison partagent une même économie de la contrainte (corps assigné, parole surveillée), et que la fiction peut aussi être un dossier instruit contre soi.
Mars–avril : le règne du faux
Quand viennent les répétitions, le roman décrit une contamination : le rôle s’insinue, modifie les rêves, déforme le regard. Charlotte choisit la culpabilité comme option de jeu, non par goût du spectaculaire, mais parce que le mal lui paraît donner une densité que l’ordinaire refuse. Le théâtre devient une épreuve morale : si le public vient « contempler des horreurs », qu’est-ce que cela dit de nous ? Et qu’est-ce que cela exige de l’actrice, sinon une mise en danger qui déborde la rampe ?
Autour de Charlotte, les figures de l’art se répondent par la question du faux. Gabriel, son fils, peint des archanges, copie, se rêve élu tout en se vivant humilié ; ses petites cruautés de beauté font système. Un fils, jeune artiste narcissique, beau, tourmenté, figure ambiguë et inquiétante. Il incarne la pulsion de destruction, le fils aimé jusqu’à la folie, en tension constante avec sa propre monstruosité. Les détails matériels font signe : les boîtes d’allumettes « lucifers », l’obsession de la lumière, la manie de “fabriquer” des images comme on fabriquerait un alibi. À l’inverse, Emmy – jeune artiste reconnue compagne de Gabriel – incarne une autre énergie, celle qui accepte de défaire et de refaire : le roman nomme explicitement le repentir en peinture, cette reprise qui corrige sans effacer tout à fait. Emmy, artiste prometteuse et lumineuse, représente l’innocence sacrifiée. Son destin tragique constitue l’un des nœuds du récit.
La taxidermie, introduite avec Marie, est la métaphore la plus inquiétante. Empailler, conserver, donner l’illusion du mouvement à un corps mort : tout le livre travaille ce fantasme de préservation. Cécile Ladjali en tire une réflexion aiguë sur l’art : sauver n’est pas toujours innocent ; fixer peut relever du contrôle ; et le désir de retenir le vivant peut se transformer en violence. Dans cet univers, l’intertexte (Perec, entre autres) n’est pas une pose : il rappelle que l’œuvre circule, se copie, se contamine, et que l’authenticité elle-même peut devenir un masque.
Mai–seuil d’été : l’épreuve
Dans sa dernière partie, Repentir déplace la question de la faute : elle ne se joue plus seulement à l’intérieur d’une conscience, mais dans le regard des autres et dans les loyautés intimes. Le roman devient plus âpre, plus social : on n’y “choisit” plus un rôle comme on choisit une nuance ; on subit la pression du soupçon, le poids des attachements, la tentation de fermer les yeux. La romancière montre alors ce que coûte l’amour maternel, quand il devient un angle mort, et comment la « loi du sang » concurrence la loi commune sans jamais se justifier proprement.
Ce déplacement permet au livre d’atteindre son vrai sujet : le repentir comme opération sur la langue. Demander pardon, revenir sur une phrase, tenter de marcher à reculons dans le langage : voilà le geste que le roman ausculte. Il n’offre pas de confort moral, et c’est sa force : même quand la parole cherche la réparation, elle garde une part d’ombre, de théâtre, de mauvaise foi.
Au bout du compte, la scène redevient paradoxalement un lieu habitable : non parce qu’elle dirait “la vérité”, mais parce qu’elle accepte l’ambivalence. Coupable (?) est une question posée au public autant qu’au personnage. Et Repentir laisse le lecteur dans cet inconfort lucide : la beauté du verbe n’absout rien, mais elle peut, parfois, ouvrir une brèche – une seconde de clarté – avant que le jugement ne retombe.