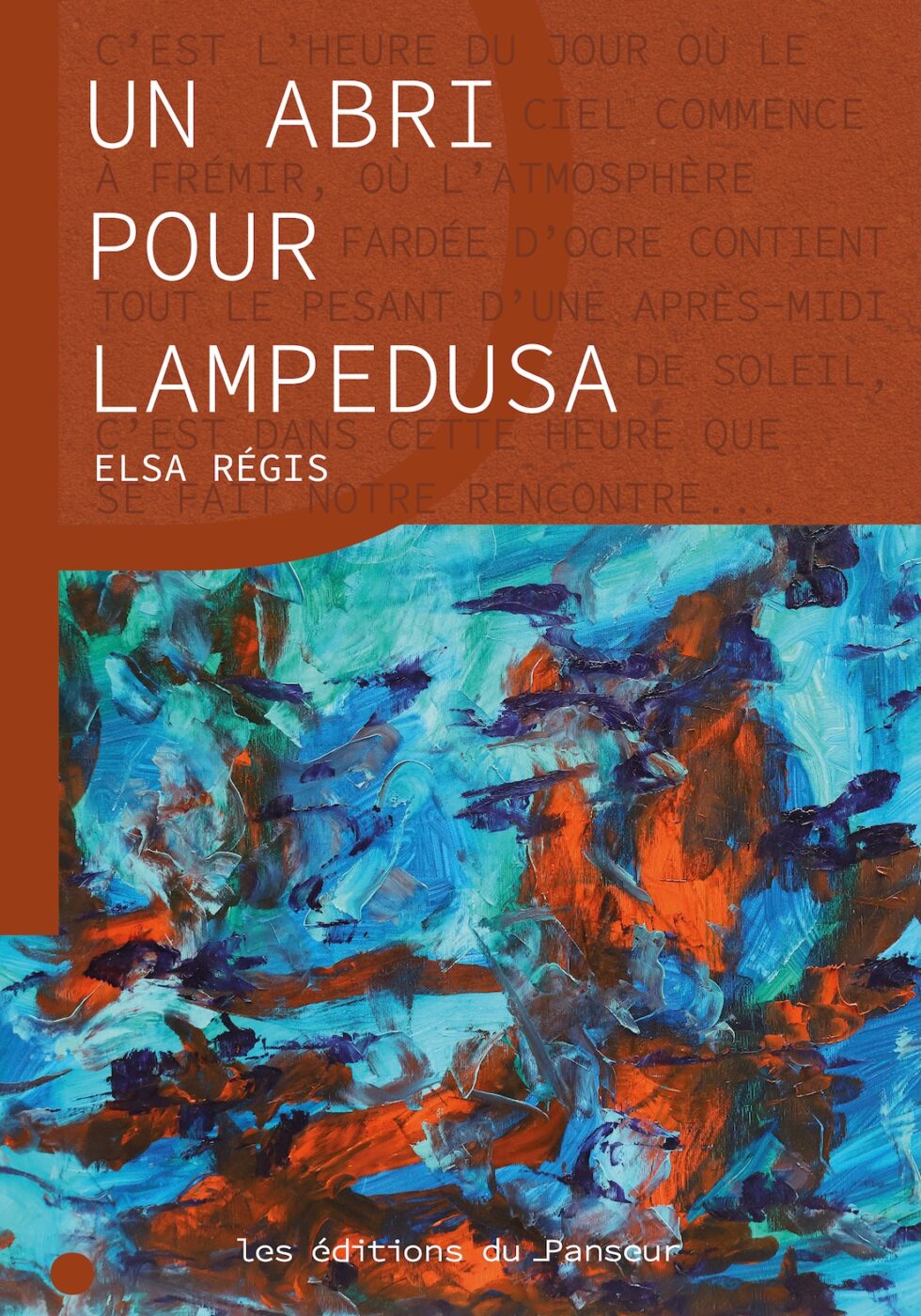Elsa Régis, Un abri pour Lampedusa, Les Éditions du Panseur, 08/01/2026, 224 pages, 19€
Découvrez notre podcast
Un été à Rome. Sous un soleil de plomb qui fait fondre le bitume et les certitudes, Elsa Régis nous ouvre les portes de son roman par le prisme d’une amitié improbable. Dans la touffeur des jardins de la Villa d’Este, Giuseppe Alde, un architecte spécialisé dans les villas de luxe, croise Marco Serve, un écrivain hanté par ses années de taxi militant. De cette rencontre naît une interrogation qui traverse tout le livre : comment jouir de la beauté du monde quand, un peu plus au sud, ce même monde se délite ?
L'architecture du confort et le malaise romain
Le récit s’ancre d’abord fermement sur le continent, dans cette Italie touristique et millénaire où la canicule semble suspendre le temps. L’auteure installe une atmosphère sensorielle prégnante qui envahit les rues, s’immisce dans les discussions du bar Barbarossa et jusque dans la chambre de Giuseppe, via della Lungaretta. C’est ici, entre les Spritz en terrasse et les conversations de voisinage avec Salvini – un fils d’immigrés tunisiens ironiquement nommé –, que se joue la première fracture.
Elsa Régis utilise habilement le métier de son narrateur comme métaphore centrale. Giuseppe passe son été à rénover la Villa Armani, à ériger des murs pour protéger l’intimité des riches, tandis que Marco Serve lui parle d’un autre type de construction : l’Abri de Lampedusa, bâti « contre la loi de l’État en faveur de la loi de la nécessité ». Le roman organise une circulation fascinante entre le réel et la fiction : Marco confie à l’architecte ses carnets, où un couple inventé observe, depuis un hôtel de Tarente, les bivouacs de fortune sur la plage. Ce récit enchâssé agit comme un miroir tendu à Giuseppe : il force cet homme, habitué à structurer l’espace, à observer sa propre passivité face à l’exil des autres.
Lampedusa : le chantier des corps et des âmes
Lorsque Giuseppe quitte enfin sa tour d’ivoire romaine pour rejoindre l’île, le changement d’atmosphère est radical. Fini le jazz de Chet Baker écouté dans les bras de Bianca à Tivoli ; ici, la bande-son est faite de bruits de tôle, de rondes militaires et de comptines congolaises chantées par les enfants. Lampedusa apparaît sous la plume d’Elsa Régis comme une terre d’usure et de poussière, où l’architecte troque ses plans précis contre du ciment gâché à la main pour agrandir des dortoirs de fortune.
C’est dans cette partie centrale que le roman gagne en âpreté. L’auteure évite l’écueil de la carte postale humanitaire pour livrer des portraits d’une intensité brute. Il y a Amadou, cet enfant d’ébène à la résilience poignante, pour qui Marco joue les pères de substitution, rejouant éternellement le mythe d’Abraham et d’Isaac sur une terre aride. Il y a surtout la parole des femmes, comme celle d’Amma, dont le récit de la nuit de noces et de la fuite rappelle que la violence masculine est souvent le premier moteur de l’exil. Elsa Régis décrit ces trajectoires sans fard, exposant la brutalité des causes et la précarité des conséquences, tout en convoquant les poètes de la traversée, de Mahmoud Darwich à Josué Guébo.
La zone grise du témoin
Le grand tour de force du livre réside dans son refus du manichéisme moral au moment du retour à Rome. Giuseppe revient, mais il revient seul. Là où Marco Serve choisit l’immersion totale, le risque du feu et la clandestinité pour rester auprès de l’enfant, l’architecte, lui, reprend sa place dans le monde confortable. Elsa Régis sonde avec une honnêteté désarmante cette « zone grise » de l’engagement. Son narrateur admire le courage de l’écrivain, mais confesse son incapacité à le rejoindre pleinement. « L’alliage ne prenait pas », admet-il ; il est fait d’étain quand son ami est fait de sang.
Le dernier mouvement, mélancolique et lucide, consigne cet écart irréductible. L’Abri est menacé par les incendies criminels, les voix de Lampedusa s’éloignent, et Giuseppe reprend sa place dans le monde du continent, dans le souvenir de cet été décisif. Le vide qu’il ressent, ce « creux » au ventre, devient la seule trace tangible de son passage sur l’île. Un abri pour Lampedusa réussit ainsi le pari d’être un livre sur la migration vu non pas depuis le canot, mais depuis le rivage, interrogeant sans relâche le confort de ceux qui regardent, comprennent, et finissent pourtant par détourner les yeux pour survivre à leur propre impuissance.