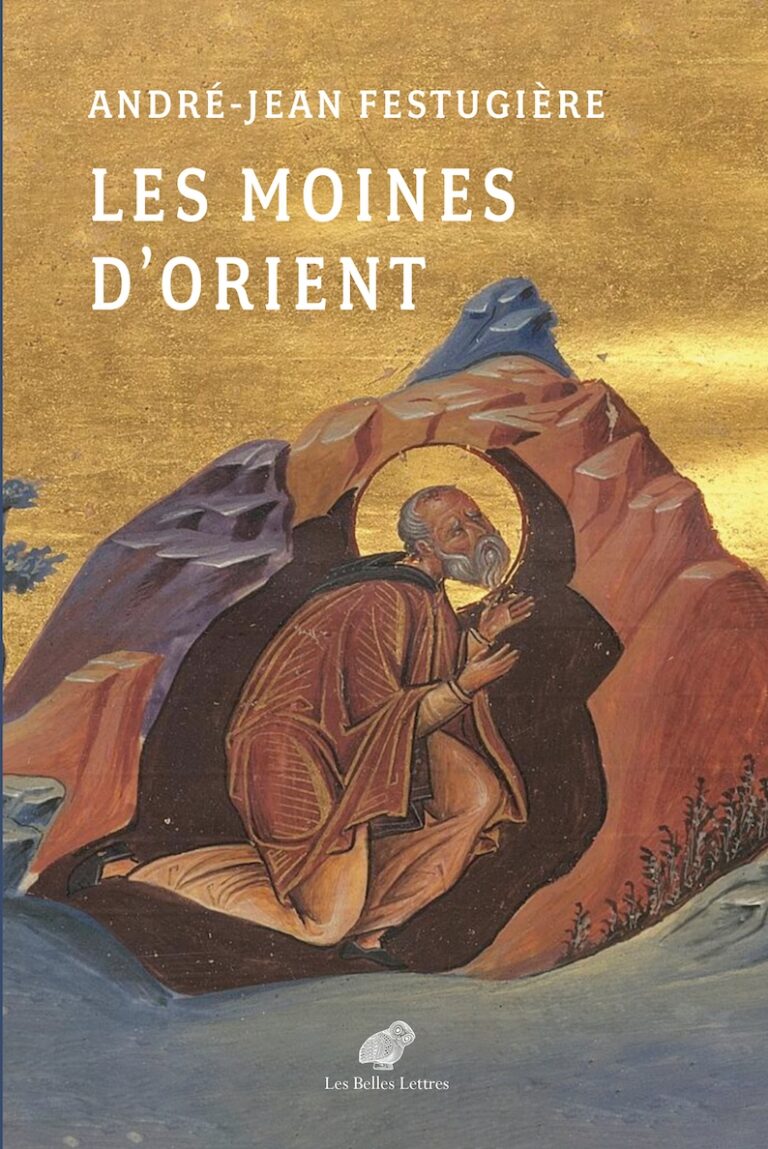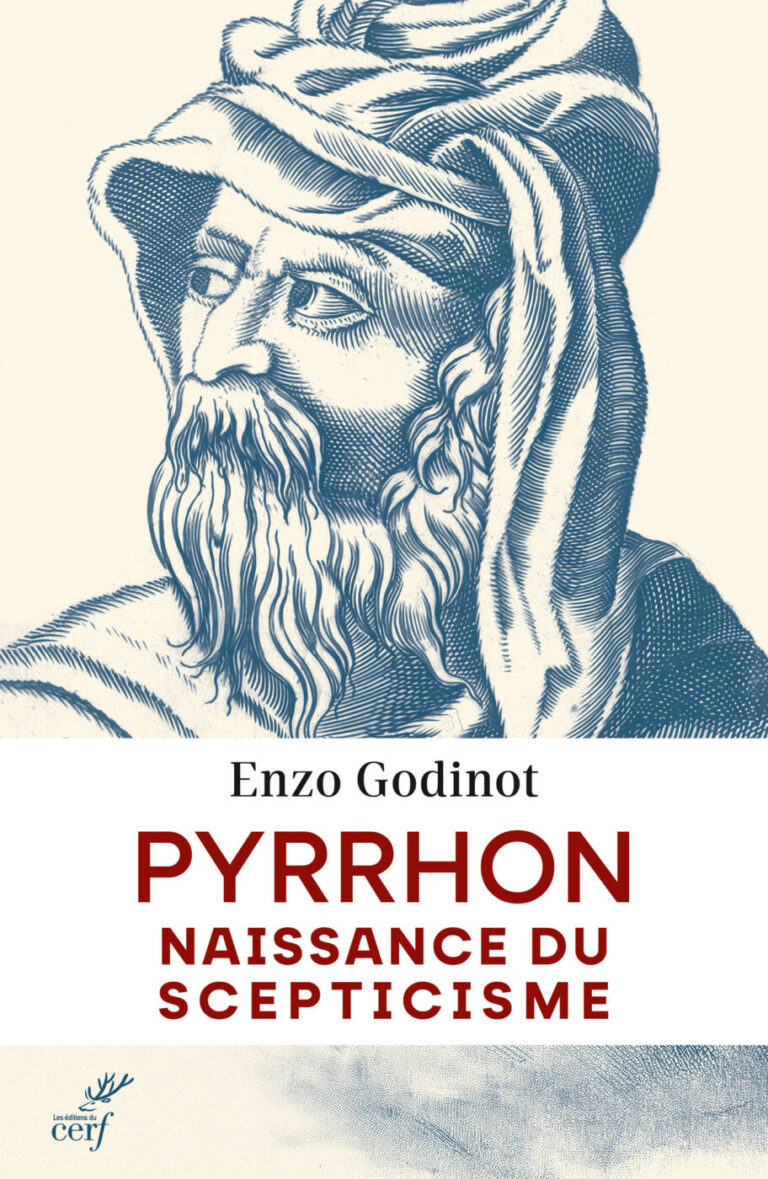Aurélien Gautherie, L’Enfant du vent des Féroé, Les Éditions Noir sur Blanc, 08/01/2026, 192 pages, 20€
À Gjógv, village aux consonnes de roche et aux falaises souveraines, le vent ne fait pas que souffler : il insiste, revient, déplace. Il polit la pierre, raye la peinture, s’infiltre sous les portes, et finit par donner au paysage une étrange qualité d’archive vivante. L’Enfant du vent des Féroé s’ouvre sur un retour paradoxal : celui d’un voyageur qui se sent “chez lui” sans vraiment appartenir. Autour de lui, l’île se met à parler, et c’est peut-être là le premier charme du roman : faire entendre, sous le récit, une rumeur plus ancienne, faite de mémoire, de sel, de gestes minuscules, de culpabilité diffuse.
Le texte déploie une narration polyphonique où les voix humaines ne sont pas seules à tenir la phrase. Le lieu lui-même – ses seuils, ses matières, ses objets – semble chargé d’une présence active. Aurélien Gautherie écrit l’insularité comme une expérience intérieure : à mesure que l’on avance, ce n’est pas seulement l’espace qui se referme, mais le temps qui s’épaissit.
Arriver : paysage, rituel, seuils
Dès les premières pages, l’auteur plante Gjógv avec un sens aigu de la géographie sensible : rien de décoratif, rien de “carte postale” sans contrechamp. La beauté est là, évidente, mais toujours travaillée par son envers : le basalte, l’humidité, l’usure, le vent comme force de sculpture. Le narrateur – “l’Étranger” – s’installe pour une saison et observe. Il apprend la maison, les habitudes, les circulations, les repères minuscules qui font qu’un endroit se laisse habiter sans être possédé.
Le roman excelle dans ces micro-rituels d’arrivée : récupérer une clé, entrer, toucher, respirer, écouter. Et surtout : sentir que l’on n’entre jamais seul. Même vide, une maison n’est pas neutre. Elle porte des traces. Elle a “vu”. Elle garde, dans ses interstices, les restes d’anciennes vies. Aurélien Gautherie fait du seuil un motif essentiel : ce qui sépare et ce qui relie, ce qui autorise et ce qui repousse, ce qui, en silence, enregistre les passages.
C’est ici que surgit l’audace formelle du livre : certaines parties prêtent une conscience aux choses, comme si la matière était capable de mémoire tactile. Le procédé n’est pas gratuit : il sert une idée forte, presque physique, de la rémanence. Sur cette île, le temps n’est pas abstrait. Il adhère.
Compter : famille, vent, culpabilité
Au centre du roman, une constellation familiale se dessine – Jonas, Olga, Elin, Anna – non comme “personnages” au sens strict, mais comme nœuds d’affects, de liens, de devoirs et de manques. Le romancier évite les jugements faciles : il préfère les tensions. Il montre comment l’amour peut être une force simple et pourtant impuissante, comment la tendresse se mêle à l’épuisement, comment la communauté protège autant qu’elle observe.
L’alcool, la fatigue, la honte, la solitude : ces thèmes affleurent sans jamais se transformer en plaidoyer appuyé. Le roman garde une pudeur dure, presque minérale. Il met en scène un quotidien où l’on “tient” – où l’on compte les jours, les gestes, les signes – et où l’on découvre que la fragilité n’est pas seulement celle des corps, mais celle des équilibres. L’île amplifie tout : les conflits, les silences, les non-dits. L’intime se retrouve pris dans un paysage trop grand, trop exposé.
Et partout, le vent — non comme décor sonore, mais comme principe narratif. L’auteur insère des respirations poétiques (notamment autour de Vents de Saint-John Perse) qui jouent le rôle d’un chœur : elles élargissent le drame au-delà des individus, ouvrent une perspective mythique, presque cosmique. Les références nordiques (Nornes, fils tendus du destin) ne sont pas des ornements : elles donnent au roman une profondeur d’écho, une manière de dire que sur ces terres, l’humain se croit maître, mais demeure invité.
Rester : objets, pierre, mémoire en acte
Quand le récit déplie ses strates – entre présent d’observation et passé affleurant – la matière devient le vrai réservoir du roman. Un vêtement de laine, une planche usée, une inscription, un objet domestique : tout peut faire bascule, non parce qu’il “révèle” un secret au sens mécanique, mais parce qu’il concentre du vécu. La mémoire, ici, n’est pas une suite d’événements ; c’est une charge. Elle circule par les choses, s’accroche au tactile, survit dans le plus humble.
C’est là que la réussite du livre devient évidente : Aurélien Gautherie sait écrire la trace sans la sentimentaliser. Il n’idéalise pas le passé ; il le rend présent, au sens presque physiologique. La pierre, la laine, le bois — ces matières modestes — prennent une valeur de témoin. Et l’Étranger, en se laissant traverser par ce qu’il touche, comprend qu’il n’est pas venu “visiter” : il est venu se confronter à ce qui persiste quand les mots manquent.
Le roman pose alors une question simple, mais redoutable : qu’est-ce qui reste ? Pas seulement “de nous”, mais de nos gestes, de nos soins, de nos lâchetés, de nos élans. Qu’est-ce qui s’imprime ? Qu’est-ce qui s’efface ? Et qui, un jour, saura encore lire ces marques ?
Ce qui fait la singularité du roman
L’Enfant du vent des Féroé est un livre dense, très sensoriel, parfois lyrique, mais rarement gratuit. Il mêle le récit et le chant, l’enquête intérieure et la présence du lieu, le réel concret (odeurs, matières, routines) et une dimension plus archaïque (mythes, chœur, souffle). On y entre comme on entre dans une maison qu’on croyait vide : avec prudence, puis avec une forme de fascination inquiète.
Ce n’est pas un roman qui “raconte” à toute vitesse. C’est un roman qui imprègne. Et lorsque l’on le referme, on garde l’impression d’avoir marché longtemps dans un air salé où chaque chose : un seuil, une pierre, une maille de laine, aurait retenu quelque chose de l’humain, en attente d’un lecteur pour l’entendre.
Si vous cherchez un récit d’île qui ne cède ni au folklore ni à la jolie brume, mais travaille la mémoire comme une matière vivante, ce livre a de quoi vous happer doucement, obstinément, comme un vent qui n’abandonne pas.