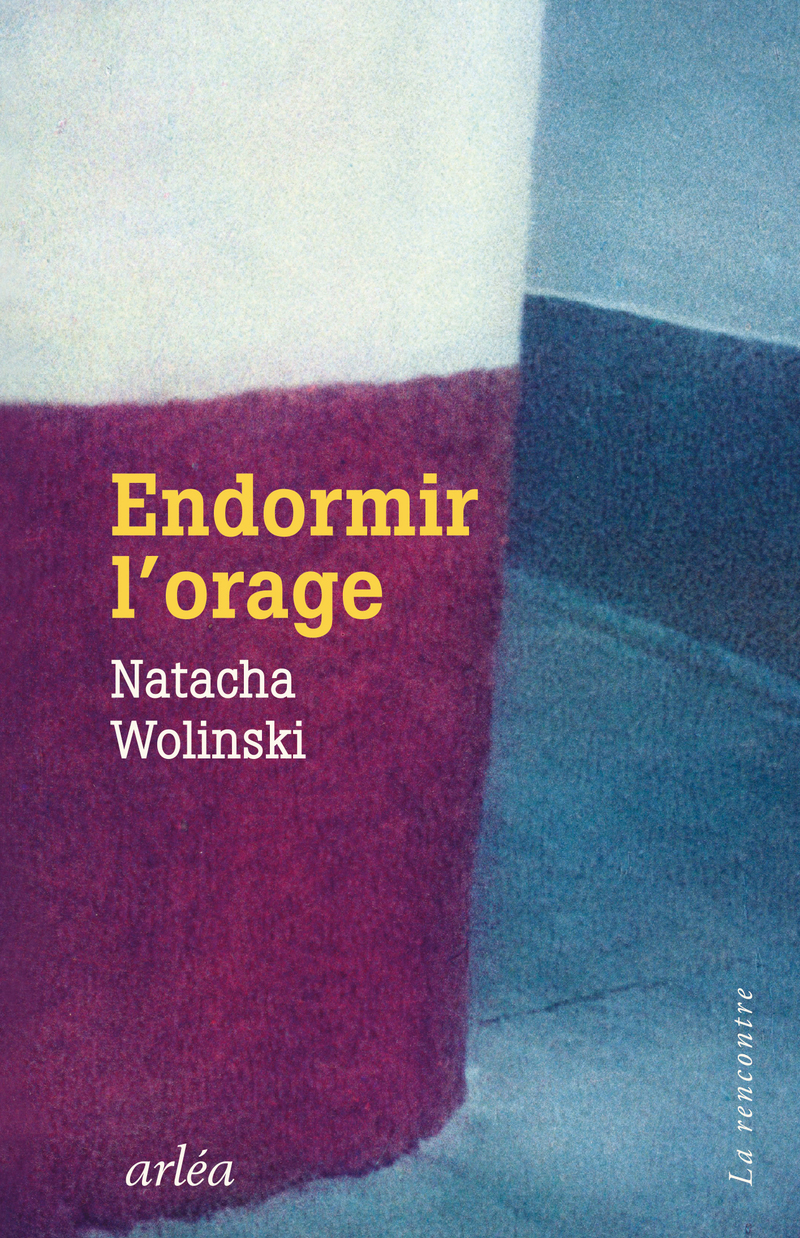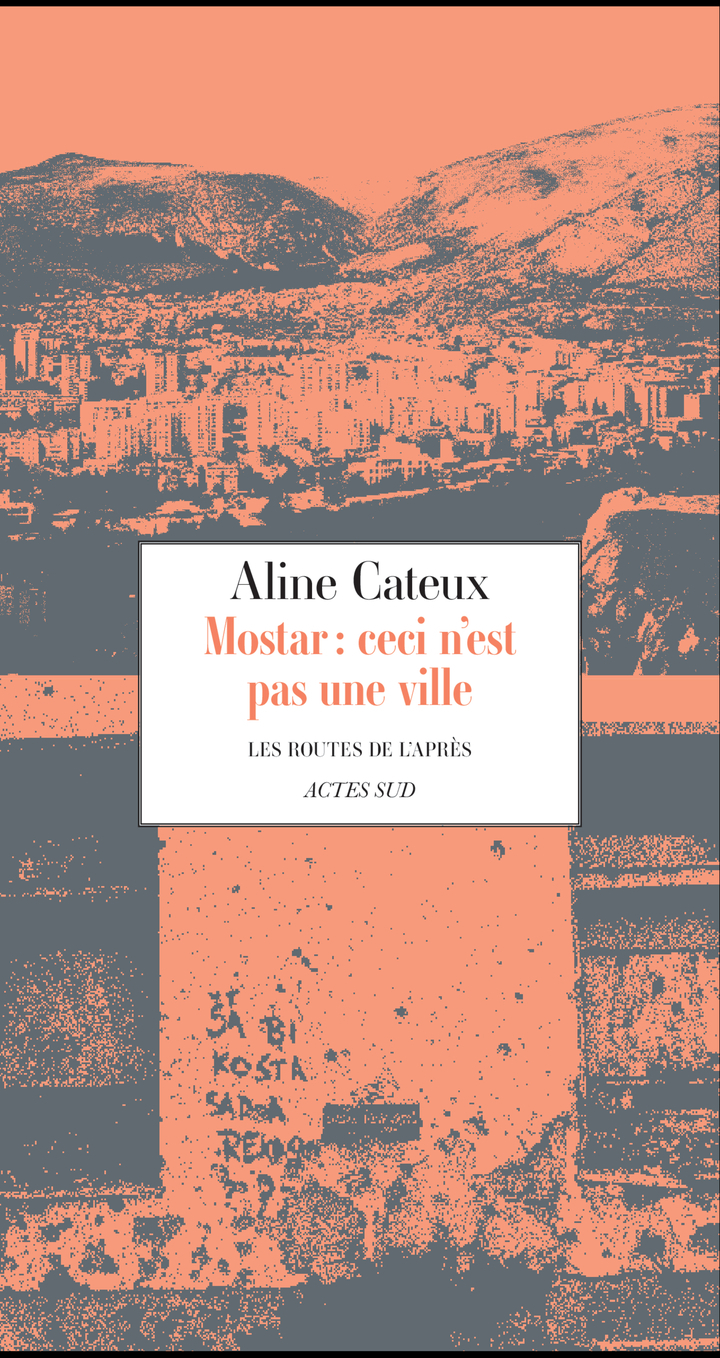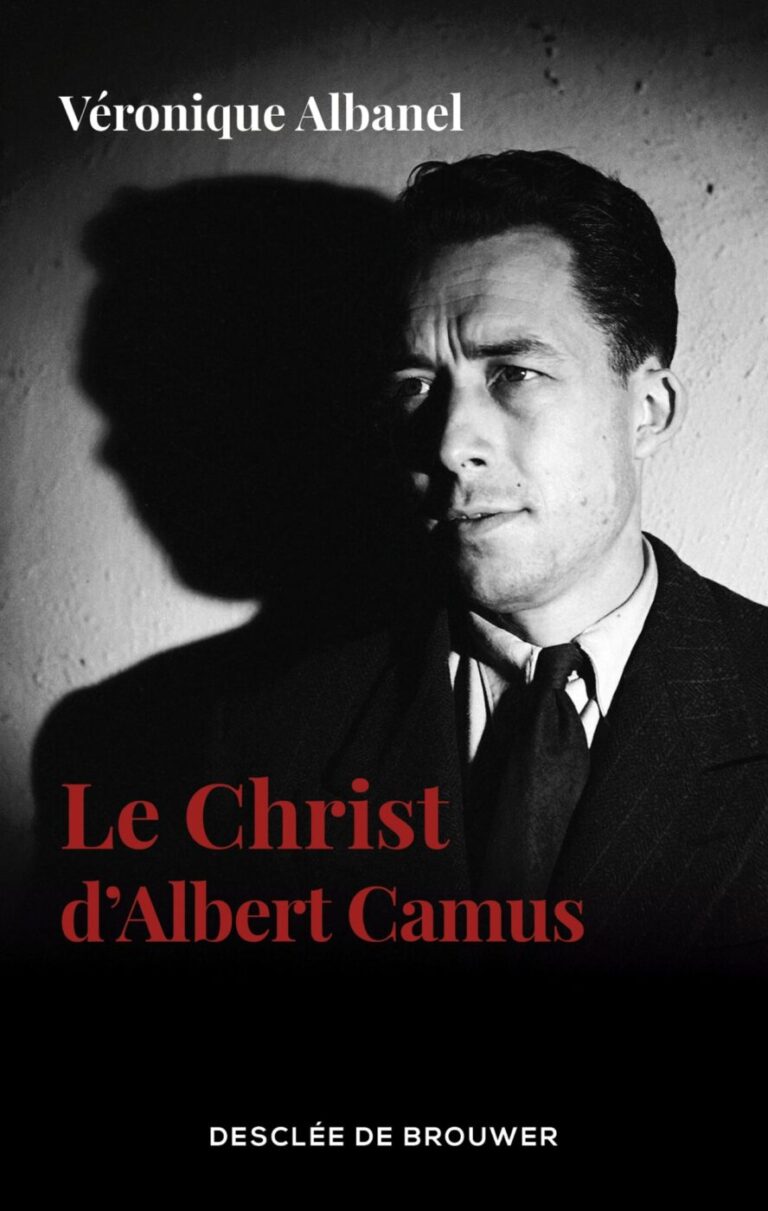Natacha Wolinski, Endormir l’orage, Arléa, 08/01/26, 80 pages, 13€
Il existe des livres qui refusent d’avancer en ligne droite, préférant tournoyer autour d’un centre obscur qu’ils tentent d’approcher sans jamais l’atteindre tout à fait. Endormir l’orage, que Natacha Wolinski publie aux éditions Arléa en janvier 2026, appartient à cette famille d’ouvrages où le fragment s’impose contre la continuité, le vers libre contre la prose domestiquée. Dix ans après l’assassinat de son père Georges Wolinski à Charlie Hebdo, l’autrice compose un poème long qui entrelace le deuil, la mémoire familiale et l’épreuve du procès des attentats de janvier 2015. Mais ce livre recèle une ambivalence que sa beauté formelle pourrait masquer : il interroge autant qu’il célèbre, accuse autant qu’il pleure.
La structure du recueil fait dialoguer deux morts violentes. Le 7 janvier 2015, Georges Wolinski tombe sous les balles des terroristes. En octobre 1936, à Tunis, son propre père Siegfried, juif polonais exilé devenu forgeron prospère, était abattu par un apprenti mécontent. Ce rapprochement traverse le texte comme une obsession : l’autrice évoque « son assassinat relaté dans les journaux tunisiens, comme le tien dans la presse française ». Deux pères fauchés, deux enfances fracassées, une boucle de violence qui se referme. Pourtant, la nature des deux meurtres diffère : 2015 relève du terrorisme idéologique, 1936 d’un différend personnel. Natacha Wolinski ne force pas l’analogie politique ; elle sonde plutôt ce que la répétition produit dans une lignée : le silence transmis, l’incapacité à « broyer les os de tes fantômes ».
Une part considérable du livre s’ancre dans l’expérience du procès. Le Palais de Justice devient un espace tellurique, « cet Etna qui mâche et remâche les morts ». Face au silence minéral de l’accusé aux « lèvres de granit », les parties civiles forment « un chœur d’agneaux sans litières, une chorale de loups ensanglantés ». Natacha Wolinski invoque Simon Fieschi, Coco, Hélène, Gabrielle, Louisa, figures d’une communauté paradoxale forgée dans le cratère de la catastrophe. Elle se désigne comme « l’empêchée », puis élargit : « nous sommes les empêchées ». Ce passage du « je » au « nous » constitue un moteur essentiel du livre, où la solitude du deuil se mue en solidarité des inconsolés.
Mais la force singulière de ce texte réside dans ce qu’il ose formuler à l’endroit du père. Georges Wolinski n’apparaît pas seulement comme la victime héroïque d’un attentat ; il surgit aussi en père défaillant, « oublieux de tout », homme « des déserts et des traces qui s’effacent ». L’autrice questionne avec une franchise déchirante : « Tu nous as tant dessinées et pourtant, tu n’as rien laissé, du fronton de ton testament nous étions tes trois filles effacées. » Et plus loin : « Quel père ne laisse rien à ses enfants ? » Cette accusation intime, glissée entre les strophes de tendresse, donne au recueil sa tension véritable. Natacha Wolinski ne compose pas un tombeau lisse ; elle écrit depuis la faille, depuis « cette fureur et cette prière d’amour qui sont ma faille et mon intensité ».
La géographie familiale ajoute une dimension romanesque. « La Tunisie est une province de la Pologne, la Grèce est rattachée à la France » : cette cartographie délirante et vraie restitue une mosaïque d’exils où les ancêtres polonais, grecs, italiens, tunisiens se confondent. Maïté règne sur son appartement aux mille pampilles, Jacques le grand-père grec offre ses baklavas depuis des divans de velours, les tantes jumelles Michèle et Monique enseignent « l’art de la liesse, de la feinte et de la double esquive ». Les dessins paternels fonctionnent comme des talismans, « géographies familières » permettant de dialoguer avec les disparus.
La forme épouse le tremblement : vers brefs, blancs typographiques, strophes suspendues. L’écriture devient geste de survie : « J’ai appris à désherber les tombes ». Dans les dernières pages, une litanie de mains données s’élève : au père, aux sœurs, aux aïeuls dont les traces se perdent « entre Ioánnina et Auschwitz », à Simon Fieschi enfin, dont la mort semble « plus injuste que toutes les autres ». L’orage n’est pas dissipé ; il sommeille. Mais l’écriture, ce « chant du merle moqueur », permet de traverser la nuit les yeux ouverts.
Il y a dans Endormir l’orage une vérité si nue, une beauté si âpre, qu’on en sort à la fois dévasté et étrangement consolé, comme après avoir traversé un orage et découvert que l’on tient encore debout.