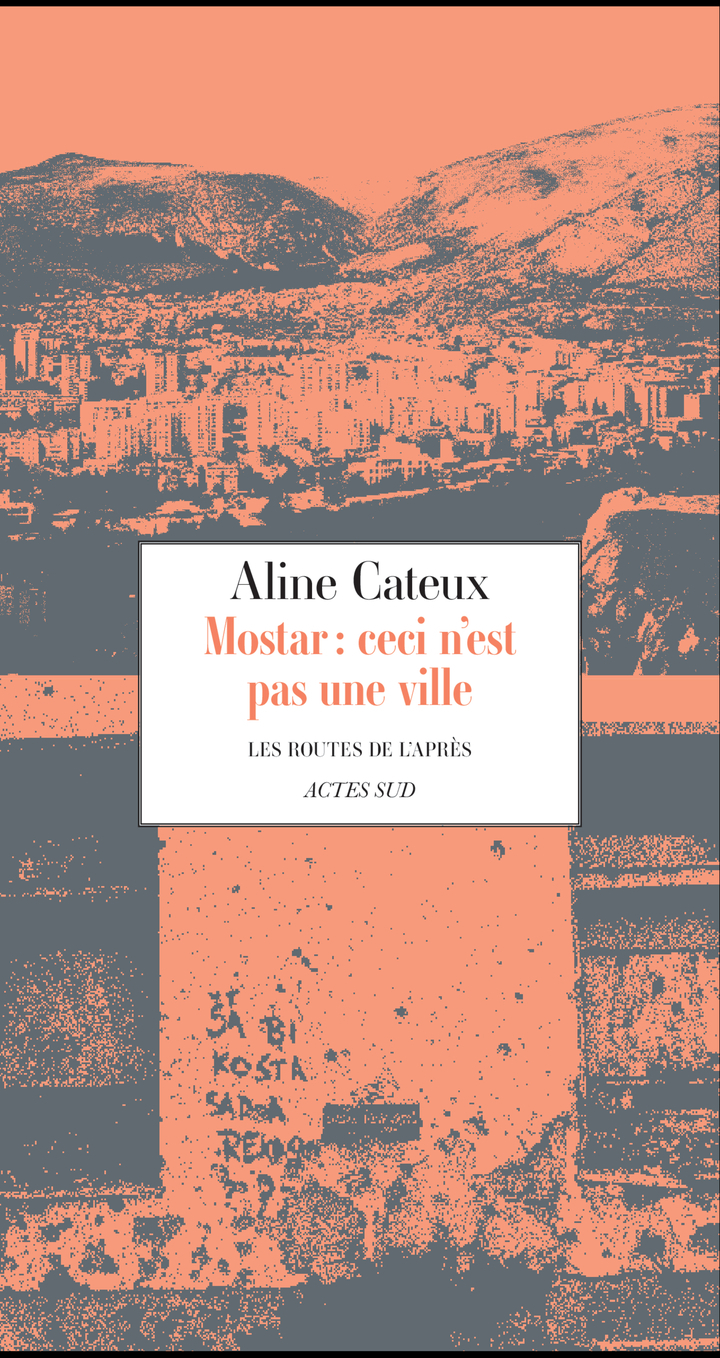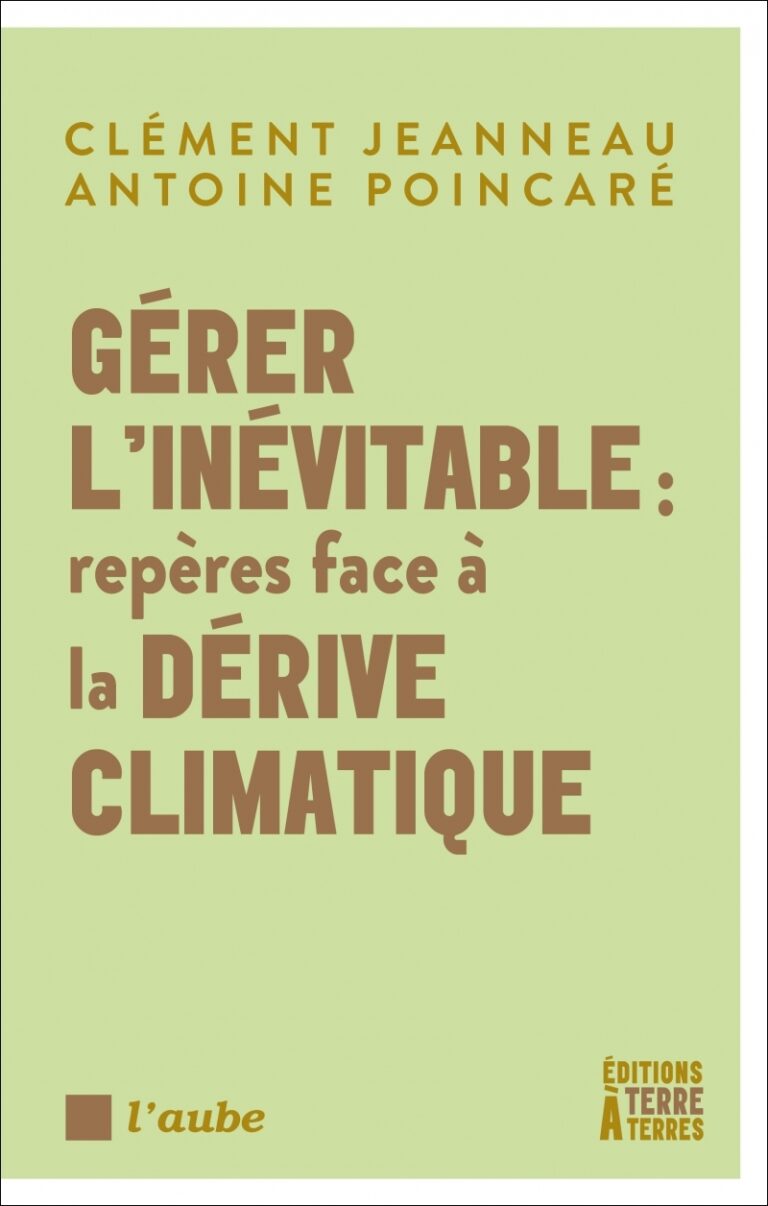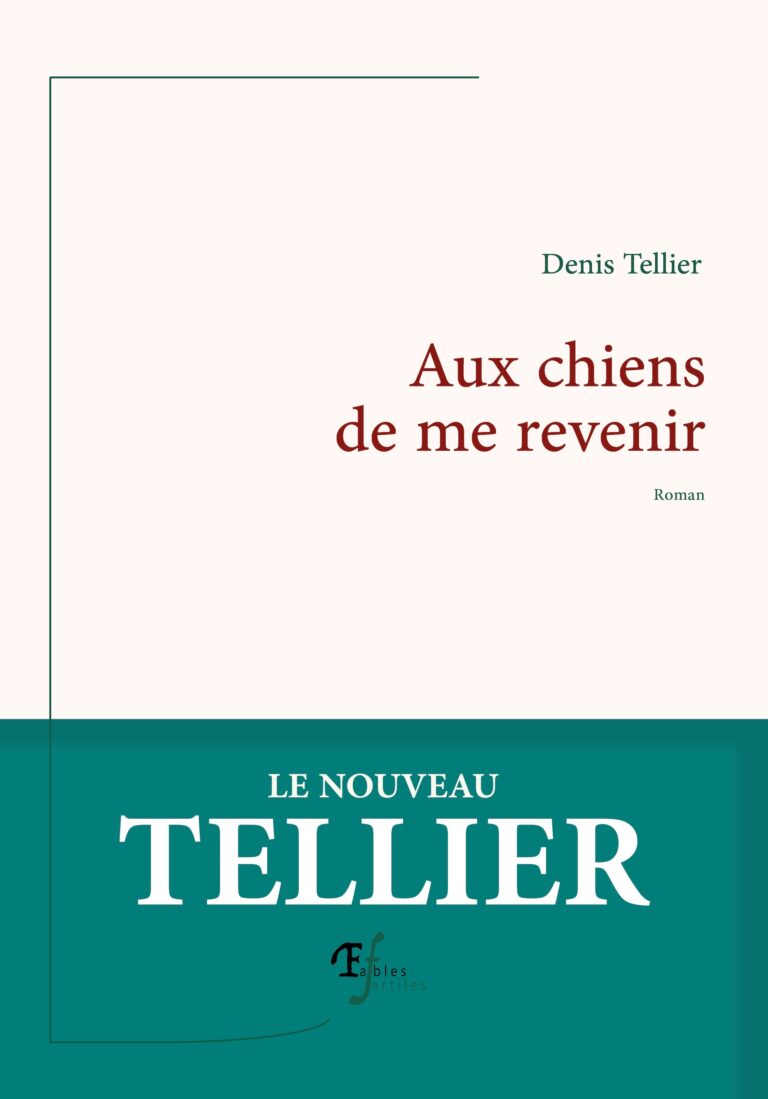Aline Cateux, Mostar : ceci n’est pas une ville, Actes Sud, 07/01/2026, 208 pages, 22€
Où est Mostar ? Quelque part dans l’angle mort de la conscience européenne. Vingt ans après les caméras du monde entier, que reste-t-il de la “perle de Bosnie” ? Des institutions fantômes, une décharge toxique aux portes de la ville et une population qui se terre pour survivre. Loin du folklore de la reconstruction, Aline Cateux livre une enquête impitoyable sur un urbicide qui continue à bas bruit. Ce n’est pas un guide de voyage, c’est l’anatomie d’une disparition.
Voici donc un livre qui refuse l’amnésie du “post-conflit” pour regarder la blessure en face. Mostar : ceci n’est pas une ville n’est pas le récit d’une reconstruction, mais l’anatomie d’une décomposition active. Vingt-cinq ans après les accords de Dayton, Aline Cateux dresse le bilan d’une paix toxique qui a fini le travail que la guerre avait commencé : vider une cité non seulement de ses bâtiments, mais de sa substance civique et sensorielle. Entre enquête de terrain au long cours et anthropologie des affects, l’autrice documente ce que les institutions internationales s’acharnent à ne pas voir : le glissement d’une ville martyre vers une “ville cas spécial” (grad slučaj), où la corruption empoisonne jusqu’à l’eau du robinet.
Le choc des ruines : désorientations et éthique du regard
L’ouvrage s’ouvre sur la sidération de juillet 1999. Depuis la banquette arrière d’une voiture remontant le Bulevar, Aline Cateux découvre un paysage de façades pulvérisées, friables comme de la « poussière tassée ». Cette entrée en matière pose immédiatement l’éthique de sa démarche : contre le voyeurisme de la presse qui assiège les habitants de « questions zoo » sur leur traumatisme, l’autrice choisit le temps long et la méthode de la marche. Elle s’impose une règle de conduite stricte : ne jamais initier la conversation sur la guerre, attendre que la mémoire affleure d’elle-même dans les interstices du quotidien.
C’est cette patience qui lui permet de démêler les temporalités d’un urbicide souvent simplifié à l’excès. Elle rappelle que Mostar a subi deux guerres : le siège par la JNA et les forces serbes en 1992, puis la trahison du HVO croate en 1993. Cette stratification de la violence explique la complexité des ruines qui parsèment encore la ville, comme celle de l’ancien magasin Nama ou du bâtiment Razvitak. L’autrice analyse comment ces béances architecturales ne sont pas des vestiges passifs, mais des acteurs qui déstructurent l’orientation et empêchent la pratique ordinaire de la ville. Les habitants ne se contentent pas de contourner des gravats ; ils contournent des mémoires interdites et des périmètres de sécurité invisibles à l’œil nu.
Les impostures de la "réconciliation"
La décennie 2000 est disséquée sous l’angle critique de l’ingérence. L’ouvrage démontre avec force comment la reconstruction du Vieux Pont (Stari Most) en 2004 a servi de cache-misère, une « histoire botoxée » selon la formule cinglante d’Esma, urbaniste locale citée dans le texte. Tandis que la communauté internationale célébrait une “réunification” de façade, la ville réelle s’enfonçait dans une partition administrative et sociale gérée par les partis ethnonationalistes (HDZ et SDA).
Le livre excelle à décrire la guerre des symboles qui sature l’espace public. L’autrice s’arrête longuement sur le changement des noms de rue à l’Ouest, où les héros antifascistes comme Leo Bruk ont été effacés au profit de figures du régime oustachi telle que Mile Budak. Cette réécriture de l’histoire culmine dans le sort réservé au Partizansko groblje. Le cimetière des Partisans, chef-d’œuvre de Bogdan Bogdanović conçu comme une « ville des morts » regardant celle des vivants, est devenu le terrain vague de la délinquance politique, vandalisé par ceux qui craignent la puissance intégratrice de la mémoire yougoslave.
L’analyse sociale se fait ici particulièrement fine. Aline Cateux rapporte les tensions entre les starosjedoci (citadins de longue date) et les populations rurales déplacées par le conflit. Sans valider le mépris de classe parfois exprimé par les premiers qui dénoncent un « primitivisme » ambiant (primitivizam), elle écoute ce que cette friction révèle : une perte du šmek – cette patine indéfinissable faite d’élégance et de savoir-vivre mostarien –, sacrifiée sur l’autel d’une démographie recomposée par la violence.
Interstices et asphyxie : "Tout est à nu"
La dernière partie de l’ouvrage, centrée sur la décennie 2010-2019, abandonne l’espoir pour une lucidité tranchante. Guidée par la figure centrale de Damir, véritable sismographe de la colère citoyenne, l’autrice documente l’agonie du système. « Il n’y a plus nulle part où se cacher, tout est à nu », lance Damir, épuisé par vingt ans de lutte. Ce ne sont plus les obus qui menacent, mais une prédation systémique.
L’enquête sur la décharge d’Uborak constitue le point d’orgue de cette démonstration. Aline Cateux montre comment le clientélisme a muté en une menace biologique directe : pollution des sols au pyralène, augmentation explosive des cancers, silence complice des institutions. La notion de “résilience”, mantra des bailleurs de fonds occidentaux, apparaît dès lors pour ce qu’elle est : une injonction perverse à tolérer l’intolérable. La débrouillardise ne suffit plus quand l’air lui-même est toxique.
Dans ce tableau sombre, l’autrice n’oublie pas les interstices de lumière, comme l’éphémère victoire de la jeunesse pour le centre culturel Abrašević en 2003, mais elle note honnêtement l’essoufflement de ces luttes. Le livre se clôt sur une saturation sensorielle. Le silence recueilli des vieilles ruelles a laissé place au vacarme des terrasses touristiques standardisées, transformant la “Perle de l’Herzégovine” en kasaba (trou paumé) commercialisable. Il reste l’odeur des tilleuls et des roses de mai dans la mémoire d’Olga ou de Jasna, mais dans le présent, comme le constate Aline Cateux avec une mélancolie dépourvue de pathos, l’espace se rétrécit (skupiti se). Quand une ville n’offre plus de protection ni de justice à ses habitants, il ne reste que le départ ou l’exil intérieur. En cartographiant ce vide, l’autrice signe une œuvre majeure qui rejoint la littérature de la “géographie de la peur”, rappelant les écrits d’Urba et les analyses urbaines sur Beyrouth : quand la ville disparaît, c’est la civilité même qui s’éteint.
Indispensable pour qui refuse de confondre la paix avec le simple silence des armes, ce livre est une boussole morale posée sur les ruines de nos renoncements.