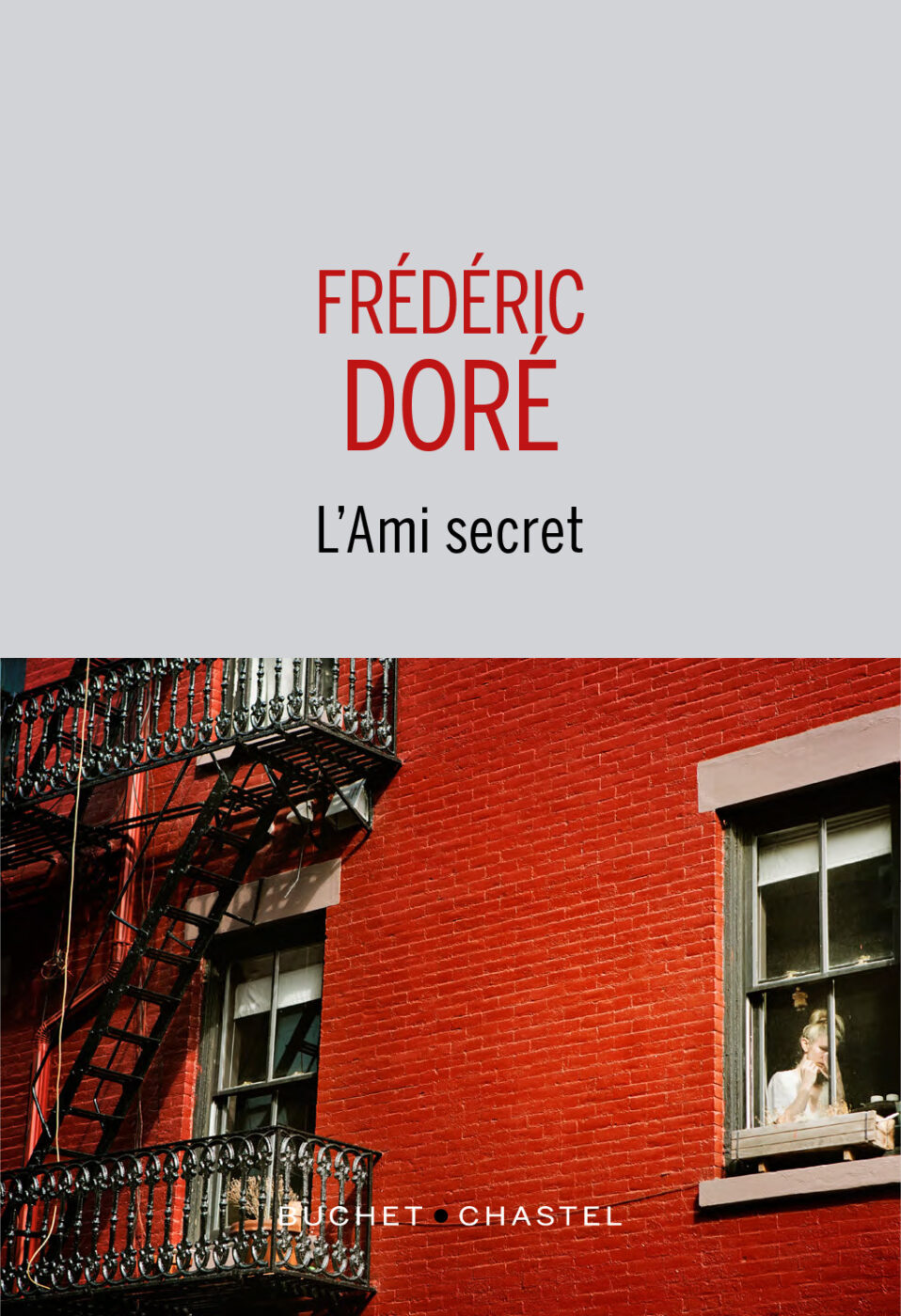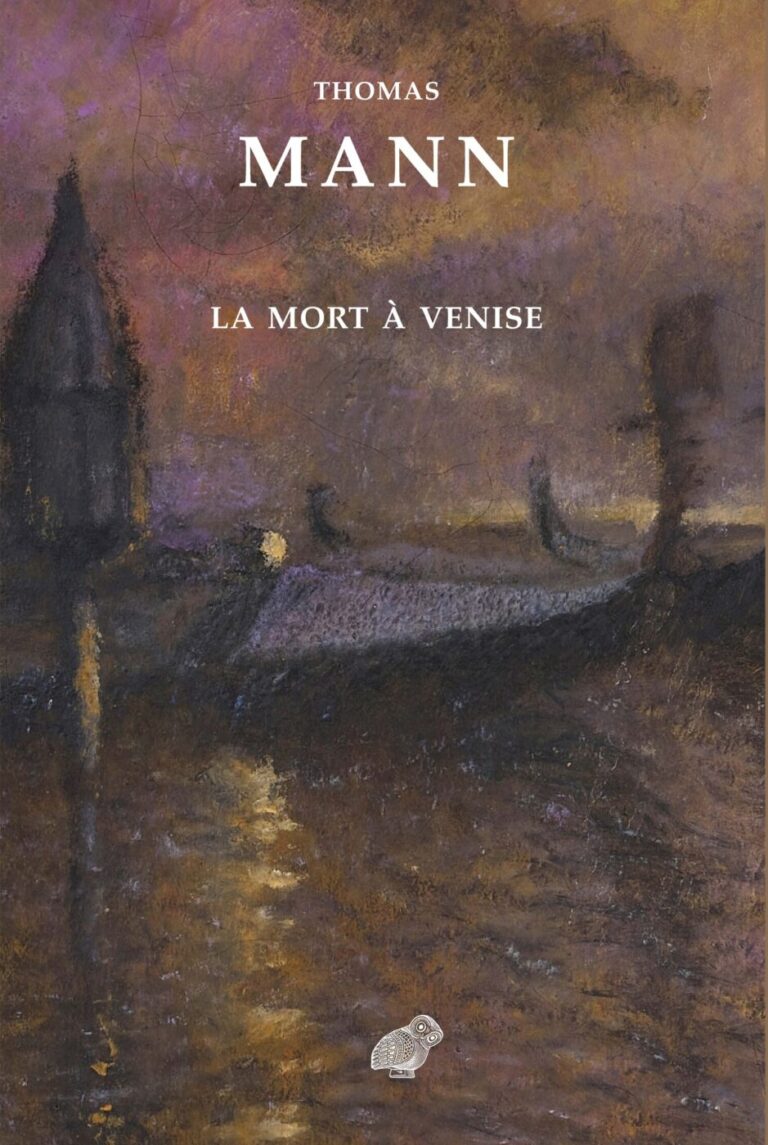Frédéric Doré, L’Ami secret, Buchet/Chastel, 08/01/2026, 272 pages, 21,90€
Que reste-t-il quand la musique s’arrête et que les chefs-d’œuvre disparaissent ? Dans L’Ami Secret, Frédéric Doré orchestre une traque littéraire envoûtante où le fantôme de Truman Capote sert de guide à un expert en solitudes, transformant une enquête impossible en un magnifique tombeau pour les illusions perdues.
Le blues de l’expert. Une double vie new-yorkaise
Bill Gardner est un homme coupé en deux, arpentant un Manhattan schizophrène. Né le 16 mai 1966, date canonique où Pet Sounds et Blonde on Blonde fracassèrent la pop music, il traîne ce double patronage comme une promesse non tenue. Rocker à mi-temps dont le seul tube, Next Saturday, nourrit à peine les caisses, il survit en exerçant le métier de « personal appraiser ». Il évalue les vestiges, chiffre les souvenirs des défunts dans des intérieurs de Soho ou de l’Upper East Side désertés par le souffle. Frédéric Doré excelle à peindre cette atmosphère clinique, où la valeur sentimentale est impitoyablement convertie en dollars pour le fisc. Mais derrière cette routine d’inventaire se cache une fissure plus profonde : Gardner est un survivant rongé par la culpabilité. Hanté par « le son » – ce bruit mat d’impact, signal auditif d’un accident qui l’a laissé seul et indemne – il avance en automate, anesthésié par un traumatisme qu’il contient difficilement. « J’aurais préféré que ce soit moi », finit-il par lâcher, aveu qui confère à sa démarche une gravité funèbre. C’est dans ce contexte, dans l’appartement de Paco Beaulieu – que son fils (Peter Boliew/Beaulieu) fait inventorier après la mort de son père –, que Bill trouve une issue de secours inattendue : un kit antivenin rappelant une boîte de Joseph Cornell, portant la signature inversée « Namurt Etopac ».
La chasse au manuscrit fantôme de Manhattan au Greyhound
S’engage alors une traque qui tient autant de l’enquête littéraire que de la fuite en avant : retrouver les chapitres manquants de Prières exaucées (Answered Prayers). On sait que Capote, après avoir trahi ses « cygnes » (Babe Paley et la haute société) en publiant des extraits assassins dans Esquire, s’était retrouvé ostracisé, incapable, disait-on, d’achever son chef-d’œuvre proustien. Doré superpose habilement cette quête mythique à la tournée minable de Bill Gardner sur la côte Ouest. De Seattle à Sacramento, dans des bus Greyhound suintant l’ennui et l’Amérique déclassée, le narrateur cherche une rédemption par procuration.
Soutenir cette architecture narrative demandait une galerie de seconds rôles solides. Doré convoque des figures baroques : Tacos, le manager devenu portier d’immeuble qui pilote la carrière de Bill entre deux paquets Amazon ; Steve, voisin monomane aux t-shirts militants ; Andy, majordome manchot au passé d’ouvrier des aciéries et à la mémoire infaillible. Si le dispositif de la chasse au trésor frôle parfois le mécanique – indices trouvés sur des photos zoomées, coïncidences opportunes – il fonctionne car il détourne Bill de son propre gouffre. L’auteur utilise cette intrigue pour explorer la géographie émotionnelle d’une solitude peuplée de fantômes, ceux de la Beat Generation et du Rock FM.
Cuba et l’art de la mémoire
La géographie du roman bascule ensuite vers les Caraïbes, brisant la linéarité du road trip américain. En retraçant la jeunesse de Paco Beaulieu à La Havane post-révolutionnaire, Frédéric Doré touche sans doute le point névralgique de son propos. Il s’attarde sur la figure du lector de la fabrique Romeo y Julieta, fonction sacerdotale où la littérature, lue à voix haute aux torcedores, devient cadence de travail et évasion collective. C’est ici que se joue l’opposition centrale du livre : contre la fétichisation de l’objet écrit que recherche l’expert Gardner (le manuscrit papier), l’auteur oppose la puissance de la mémoire pure, organique. Beaulieu, entraîné par Capote lui-même à retenir annuaires et conversations, incarne une littérature qui refuse la fixité de l’encre.
Le style de Frédéric Doré tente de s’accorder à cette exigence. S’il revendique l’héritage de Capote d’une écriture « à l’os », transparente comme un « verre d’eau », sa prose n’est pas toujours exempte d’une certaine démonstration. Il aime théoriser, expliquer – l’expertise comme « métier proustien », les digressions musicologiques – ce qui ralentit parfois l’élan émotionnel au profit d’une intelligence d’essayiste indéniable, mais parfois déroutante. Reste une précision évocatrice, capable de saisir l’odeur de tabac froid d’une manufacture ou la lumière crue d’un patio cubain.
Le dernier bal
Le terminus du voyage nous conduit dans la touffeur d’un Paraguay fané. Dans un palais décrépi envahi par la végétation, digne d’un décor viscontien, l’auteur resserre l’énigme et déplace l’attente du lecteur. Le « Bal en noir et blanc » de 1966 au Plaza, sommet de la gloire mondaine de Capote, trouve ici son écho fantomatique. Doré évite l’écueil de la preuve matérielle et choisit au contraire un dénouement qui déplace l’attente du lecteur. La quête ne se referme pas sur un trophée, mais sur une idée cohérente avec le roman tout entier : ce qui compte n’est pas tant de posséder un texte que de comprendre comment il survit, et ce que cette survie, intime, produit chez Bill Gardner.
Ce dénouement scelle le destin du livre fantôme sans céder au confort d’une démonstration. Pour Bill Gardner, la révélation ne réside pas dans la possession d’un objet, mais dans le déplacement intérieur que la quête provoque : accepter la perte, et cesser de faire de l’énigme une digue contre son propre gouffre. La conclusion privilégie ainsi une idée de permanence plutôt qu’un effet de trouvaille.
Un roman d’une mélancolie solaire qui confirme, s’il en était besoin, que Frédéric Doré possède l’art rare de sculpter le silence pour en faire entendre la musique secrète.