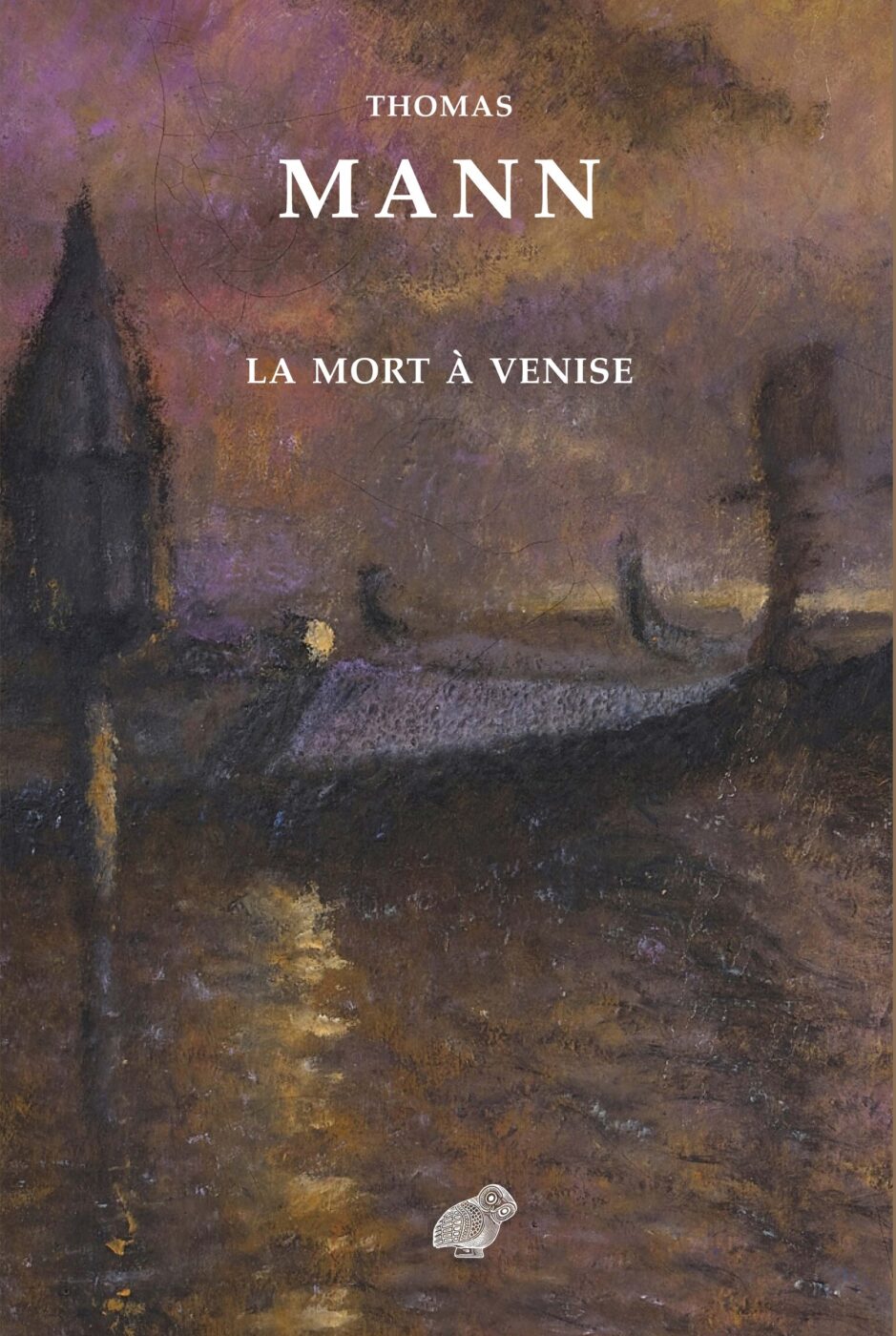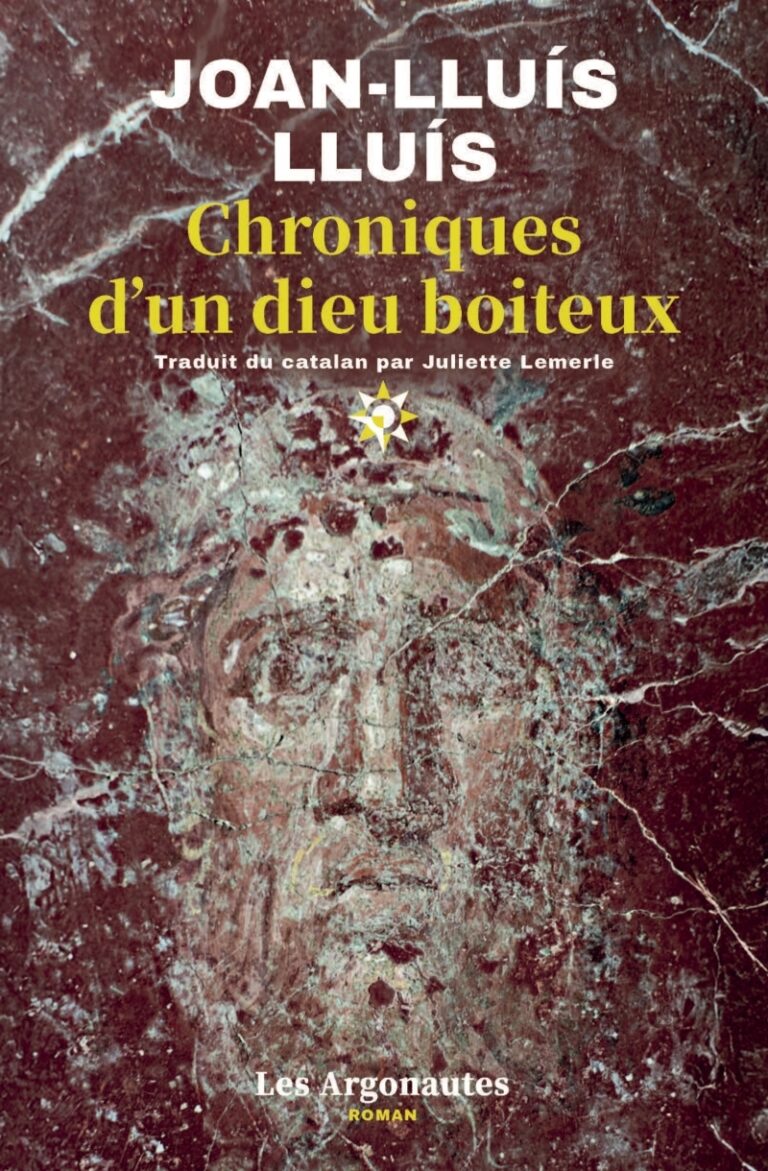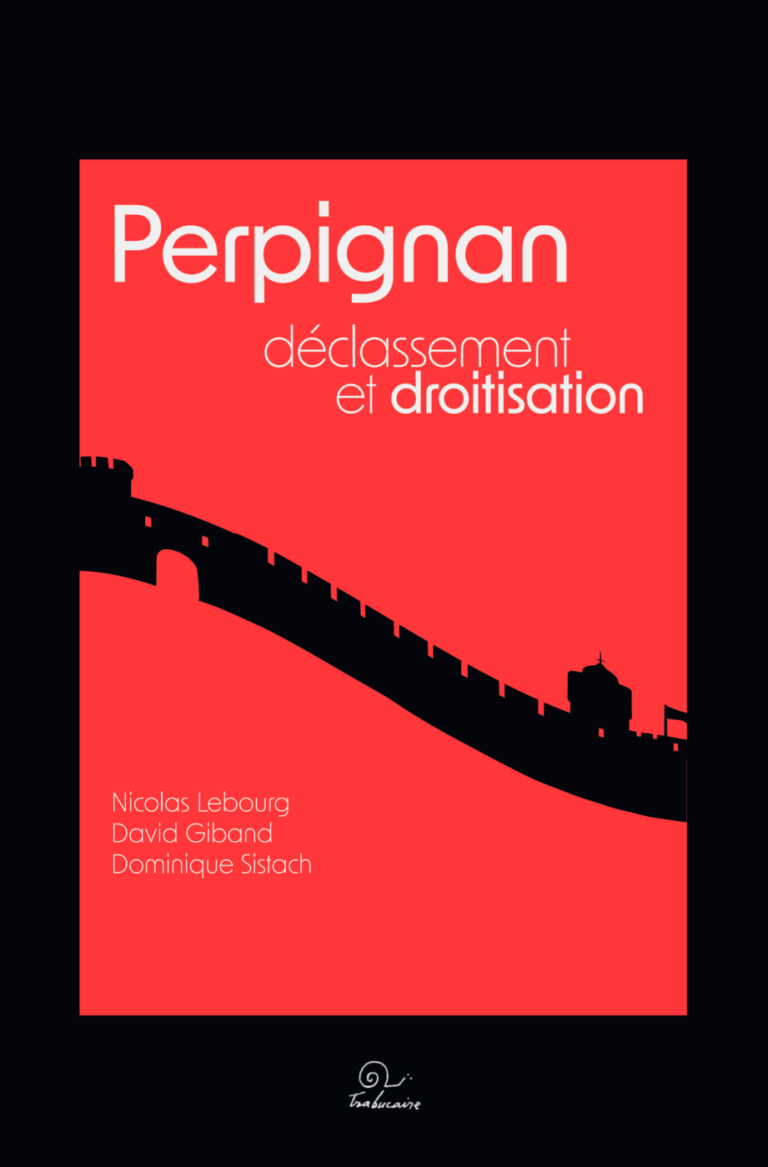Thomas Mann, La Mort à Venise, traduction Dominique Tassel, Les Belles Lettres, 16/01/2026, 110 pages, 21€
Gustav Aschenbach a passé sa vie à écrire. À Venise, il cessera d’écrire pour regarder. Dans ce glissement du verbe vers l’œil, du créateur vers le voyeur, Thomas Mann a logé l’une des méditations les plus troublantes sur ce que l’art fait à ceux qui le pratiquent. Car La Mort à Venise raconte moins une passion fatale qu’une grève de l’écriture, un écrivain qui dépose les armes de la phrase pour s’abandonner au mutisme du désir. La nouvelle traduction de Dominique Tassel rend à ce texte de 1912 sa texture de soie froide, son élégance vénéneuse.
L'écrivain qui se tait
Il y a dans La Mort à Venise une scène que l’on oublie toujours. Au chapitre trois, Aschenbach s’installe sur la plage avec son sous-main de voyage, son stylographe, ses papiers. Il veut travailler. « Au bout d’un petit quart d’heure, il trouvait déjà dommage d’abandonner ainsi dans l’esprit la situation la plus jouissive qu’il connût. » Il range ses affaires. Il ne les ressortira plus.
Thomas Mann a construit toute son œuvre antérieure autour d’un credo : l’artiste est celui qui transforme la vie en phrases, qui discipline le chaos par la forme. Aschenbach incarne cette foi jusqu’à la caricature. Il travaille chaque matin « deux ou trois heures », sacrifiant à l’art « les forces qu’il avait accumulées dans le sommeil ». Son corps entier s’est modelé sur cette ascèse ; son visage porte les traces non d’une vie agitée mais d’« aventures imaginaires et spirituelles ». La vie réelle, il l’a toujours tenue à distance. Or voici qu’à Venise, pour la première fois, il regarde quelque chose qu’il ne peut pas transformer en texte. Tadzio résiste à la phrase. Aschenbach passe des heures à le contempler, mais il n’écrit rien. Ce stylographe rangé dans le sac, c’est une capitulation.
On a beaucoup glosé sur le désir homoérotique qui traverse cette nouvelle. On a moins remarqué que ce désir s’accompagne d’un silence absolu. Aschenbach et Tadzio ne se parlent jamais. Pas un mot échangé en cinq chapitres. L’écrivain qui a fait de l’éloquence son métier (Thomas Mann cite Cicéron dès la première page : « motus animi continuus ») se retrouve aphasique devant un adolescent polonais dont il ne comprend même pas la langue. Le nom de Tadzio lui parvient déformé, mélodieux et confus : « Adgio », « Adgiou ». Cette opacité sonore le ravit. Il préfère ne pas comprendre.
Le grand mensonge
Venise ment. Les autorités cachent l’épidémie de choléra pour ne pas effrayer les touristes. Les journaux locaux nient, les affiches rassurantes se multiplient, on désinfecte en secret. Thomas Mann fait de cette dissimulation le double exact de celle d’Aschenbach. L’écrivain, lui aussi, se ment. Il se persuade que son intérêt pour Tadzio relève de la pure contemplation esthétique, qu’il admire en lui « la noble époque » de la statuaire grecque, qu’il éprouve une « bienveillance paternelle ». Mais il le suit dans les ruelles, il l’épie, il veille sur lui comme un gardien alors qu’il le traque comme un chasseur.
Le mensonge culmine dans la scène du barbier. Aschenbach se fait teindre les cheveux, farder le visage, rougir les lèvres. Il devient la réplique exacte du vieillard grimé qu’il avait observé avec dégoût sur le vapeur au début du récit, ce « faux jeune homme » aux « dents jaunes » et à la « mouche poilée colorée ». La boucle se referme avec une cruauté géométrique. Thomas Mann ne juge pas son personnage ; il le regarde devenir ce qu’il méprisait. C’est pire qu’un jugement.
Cette architecture du mensonge donne à la nouvelle une dimension politique que l’on néglige souvent. Nous sommes en 1911. L’Europe croit à sa propre santé, à sa civilisation, à son ordre. Dans deux ans, Sarajevo. Thomas Mann, sans le savoir encore, décrit un monde qui se maquille pour cacher sa décomposition. L’épidémie que Venise dissimule, c’est aussi celle qui va emporter le vieux continent. Aschenbach meurt sur une plage désertée ; quelques années plus tard, des millions d’hommes mourront dans la boue des tranchées. La « décadence » que théorisait Paul Bourget n’était pas qu’une posture littéraire.
Le corps contre l'œuvre
Thomas Mann a glissé dans sa nouvelle un détail cruel. Les dents de Tadzio sont mauvaises : « un peu crénelées et pâles, sans l’émail de la santé ». L’adolescent dont Aschenbach fait une idole grecque est probablement malade. « Il ne vivra sans doute pas vieux », pense l’écrivain. Et cette pensée, au lieu de le refroidir, le rassure. Aschenbach n’aime pas Tadzio ; il aime l’idée que cette beauté est condamnée, qu’elle ne vieillira pas. Il projette sur l’adolescent sa propre fascination pour la mort.
Car Aschenbach, au fond, semble moins désirer posséder Tadzio que devenir Tadzio : jeune, beau, insouciant, délivré du labeur de l’écriture. Il paraît davantage fasciné par la possibilité de sa disparition que par sa présence elle-même. Le maquillage du barbier est une tentative pathétique de métamorphose. L’écrivain quinquagénaire voudrait troquer son corps usé contre celui de l’éphèbe. Échange impossible, bien sûr. Mais Thomas Mann suggère que tout art repose sur ce fantasme : devenir l’autre, se glisser dans une forme étrangère, échapper à soi. Aschenbach a passé sa vie à créer des personnages. À Venise, il voudrait en devenir un.
Le dernier paragraphe montre Tadzio debout dans la mer, « se détachant du groupe des siens », tournant la tête vers Aschenbach. Ce regard est-il une invitation ? Un adieu ? Une hallucination du mourant ? Thomas Mann laisse la question ouverte. Mais il y a dans cette image finale quelque chose qui ressemble à une promesse d’écriture. Comme si Tadzio, en se retournant, offrait enfin à Aschenbach la possibilité d’une phrase. Trop tard. L’écrivain meurt « quelques minutes » plus tard.
Le monde apprendra. Thomas Mann écrira. La nouvelle que nous lisons est, en quelque sorte, le livre qu’Aschenbach n’a pas su écrire. L’élève dépasse le maître ; l’auteur survit à son personnage. Il y a dans cette victoire quelque chose d’un peu cruel, comme dans toute littérature. Adaptée à l’opéra par Benjamin Britten, transposée au cinéma par Luchino Visconti avec l’adagietto de Mahler en bande-son obsédante, la nouvelle a ouvert une veine crépusculaire qui irrigue l’imaginaire occidental jusqu’à aujourd’hui.
La traduction de Dominique Tassel, nerveuse et précise, restitue les longues phrases de Thomas Mann sans les alourdir. Cette édition des Belles Lettres donne à lire La Mort à Venise comme ce qu’elle est : non pas un récit sur l’homosexualité ou la décadence, mais une méditation sur ce que coûte l’art à ceux qui le font, et sur ce qui arrive quand ils cessent de le faire.