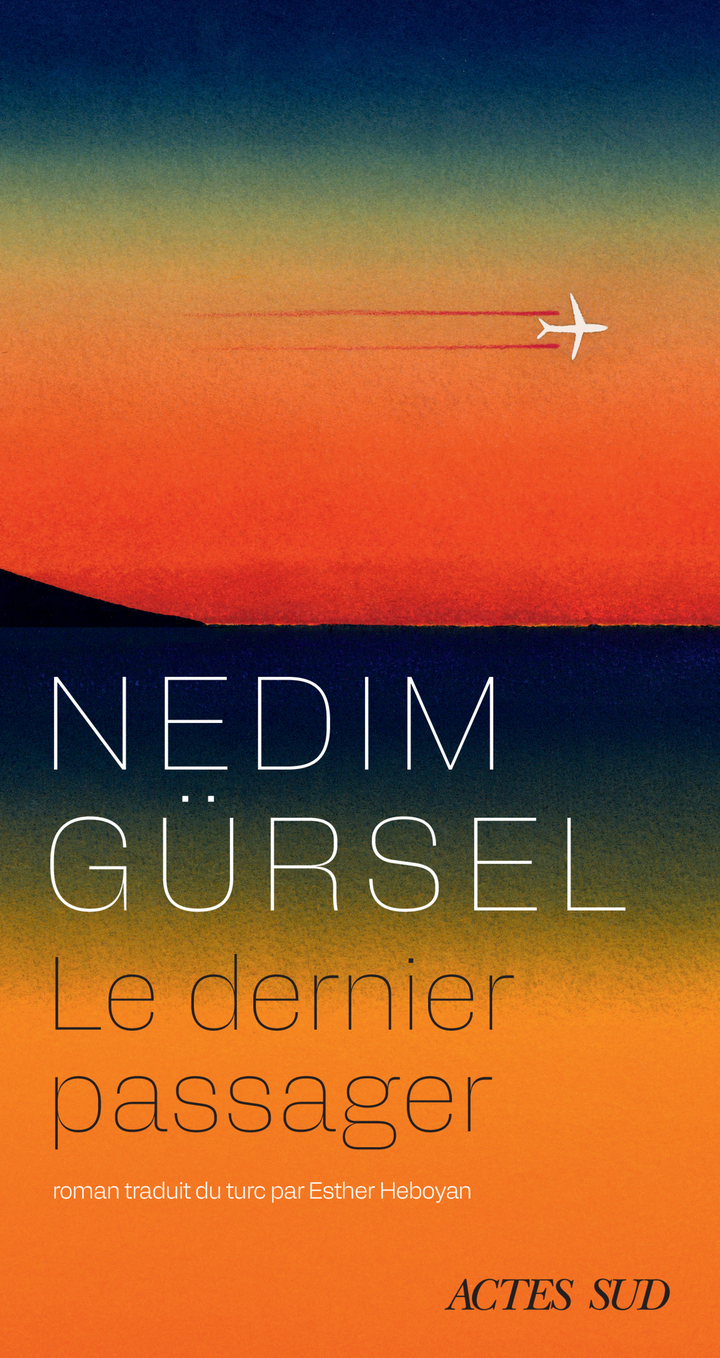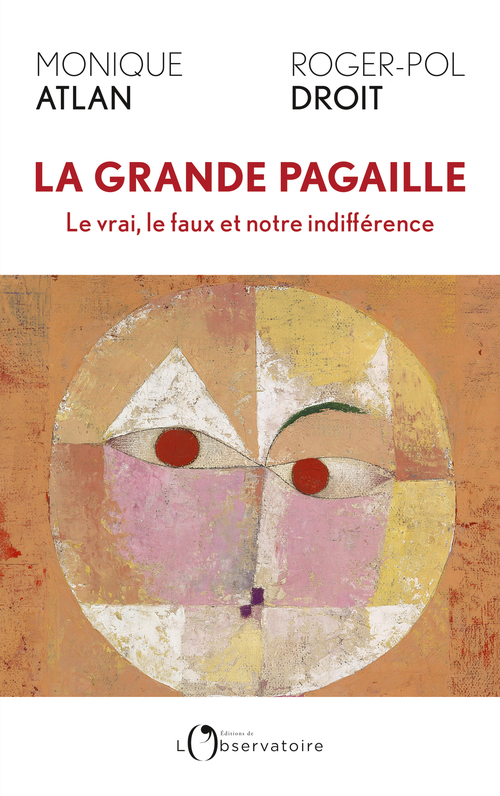Nedim Gürsel, Le Dernier Passager, Actes Sud, traduit du turc par Esther Heboyan, 04/02/2026, 192 pages, 20€
Certains romans tiennent dans un vol Paris-Istanbul, le temps qu’un écrivain septuagénaire nommé Deniz Çakır ferme les yeux, s’abandonne aux rêves, et traverse toutes les frontières que sa vie a dressées entre les langues, les femmes, les morts et les régimes politiques. Nedim Gürsel fait de ce trajet aérien une chambre d’échos où passé et présent fusionnent dans une même phrase, un même souffle, une même inquiétude.
Ceux qui attendent entre deux rives
L’ouverture du roman procède d’un enchâssement de réveils qui brouille d’emblée les repères du lecteur. “Allez, réveille-toi” : c’est la voix de la mère, Emine Çakır, arrachant l’enfant au sommeil dans une ville de province turque pour attraper le train de Balıkesir. Puis c’est un gondolier vénitien, silhouette de Charon en cape noire, qui prononce la même injonction au-dessus des eaux bourbeuses d’un canal. Puis c’est Paris, “cette cage dorée d’où il voulait s’échapper depuis très longtemps”. Le dispositif est posé : Nedim Gürsel construit un roman de la conscience somnolente, où chaque assoupissement ouvre une trappe vers un autre temps, un autre lieu, un autre registre de douleur ou de désir.
La figure maternelle irrigue ces premières pages avec une intensité singulière. Nedim Gürsel lui accorde un long monologue en italique, voix d’outre-tombe à la fois tendre et cinglante, qui apostrophe directement le fils exilé. Emine Çakır y déplie toute une vie d’attente : “Des années durant, celui que j’ai attendu était l’enfant espiègle d’antan, l’élève qui a appris à lire en trois jours, le chef comanche qui mettait la pagaille dans le quartier, et non pas le tombeur de ces dames”. La dédicace du livre annonçait déjà cette coloration funèbre : “Aux morts qui attendent / Aux Pénélope qui attendent.” L’attente, chez Nedim Gürsel, constitue un état ontologique, partagé aussi bien par les vivants que par les défunts. Pénélope, l’épouse grecque de Deniz Çakır, porte en elle l’épaisseur d’une mémoire qui déborde le couple : son père Yorgo Sideris, communiste stambouliote chassé par les pogroms du 6-7 septembre 1955, est mort sous la torture de la junte sur l’île de Makronissos. L’exil grec et l’exil turc se croisent dans ce roman comme deux fleuves souterrains, Nedim Gürsel faisant d’Ikaria, de Nea Smyrni et de la Catastrophe d’Asie Mineure autant de strates mémorielles qui se superposent aux souvenirs anatoliens de Deniz Çakır.
Daphné violentée, Istanbul reconquise
Le deuxième temps du roman ouvre simultanément la veine érotique, mythologique et politique. Deniz Çakır vole vers Istanbul officiellement pour un documentaire sur les forteresses du Bosphore, officieusement pour retrouver Songül, jeune institutrice kurde de Diyarbakır dont le prénom signifie « dernière rose ». L’écart d’âge vertigineux, la clandestinité, la charge politique que porte cette femme originaire du sud-est turc : tout conspire à donner à cette passion la dimension d’une transgression intime et géopolitique. Songül, pourtant, tient tête à cet homme vieillissant ; elle le piège autant qu’elle l’attire, elle l’ancre dans un réel qu’il voudrait dissoudre dans le lyrisme. Nedim Gürsel n’élude rien de la dimension charnelle. Son héros note avec une ironie décapante que “son oiseau continuait de se dresser, voire de gazouiller, surtout lorsque Songül et lui partageaient le même lit, le même désir, la même fougue”.
L’épisode le plus remarquable de cette séquence reste la relecture du mythe de Daphné, que Deniz Çakır exhume de son propre livre Voyage au cœur de la Turquie. La nymphe poursuivie par Apollon, changée en laurier pour échapper au viol : Nedim Gürsel fait soudain basculer le récit mythologique dans le vocabulaire juridique contemporain, qualifiant la poursuite divine de “carrément une agression sexuelle”. Ce geste d’anachronisme volontaire, ce court-circuit entre l’Antiquité et l’ère post-#MeToo, révèle la méthode du romancier, qui pratique le collage temporel avec une désinvolture calculée.
Le documentaire fournit à Nedim Gürsel le prétexte d’un bloc frontalement politique. La forteresse de Rumelihisar, dite “Coupe-Détroit”, est aussi, par un jeu de mots turc, le “coupeur de gorges” ; et la section intitulée “Conquête et Conquérant“ déploie une charge acide contre la célébration annuelle de la prise de Constantinople, les janissaires de carton-pâte, les discours de conquête instrumentalisés par le pouvoir. “Dans aucun pays d’Europe je n’ai assisté à de telles célébrations de conquêtes”, écrit Nedim Gürsel dans la voix de son narrateur, avant de rappeler qu’un pays candidat à l’Union européenne ne saurait se complaire dans la rhétorique du sabre. Le roman passe ici du rêve intime au réel coercitif avec une frontalité qui surprend, tant la somnolence de l’avion semblait avoir anesthésié toute véhémence.
Les morts chantent, l'avion descend
Le dernier tiers déplace l’axe vers la question kurde. Le père de Songül, Neco, prend la parole dans un monologue posthume déchirant, évoquant les “trente-trois balles de plomb” du massacre de 1943 et les paroles du chanteur Ahmet Kaya, exilé lui aussi, enterré au Père-Lachaise : “Je pars chevaucher mon malheur / Je pars pour claquer comme une balle de plomb, un fusil Mauser, une montagne”. Nedim Gürsel tisse ici la chronique familiale et la mémoire collective kurde dans un même fil narratif, par la seule force de la voix paternelle qui murmure depuis la mort. Le Stabat Mater de Vivaldi, écouté dans les écouteurs de l’avion, enveloppe ces pages d’une lamentation qui traverse les confessions et les siècles : “Stabat Mater dolorosa !”, et Marie pleurant le Christ rejoint Yaya implorant le retour de Yorgo, et Emine attendant un fils qui ne revient plus.
L’atterrissage à Istanbul fracasse la rêverie. Deniz Çakır se réveille seul dans l’avion vide, “le dernier passager”, et le titre trouve sa résonance pleine : être le dernier, c’est aussi être celui qui reste quand tous les autres ont déjà franchi la passerelle vers l’autre côté. Ce que la piste d’atterrissage réserve à cet homme qui a traversé en dormant toute l’épaisseur de ses vies, Nedim Gürsel le concentre en quelques pages d’une sécheresse implacable où quarante ans de répression intellectuelle en Turquie, les procès pour blasphème, la longue fabrique de l’exil, convergent vers un point de chute qu’il appartient au lecteur de découvrir.
Avec Le Dernier Passager, Nedim Gürsel signe l’un de ses livres les plus complets, les plus libres, les plus nécessaires : un roman qui ose tout embrasser (l’érotisme, le deuil, la satire politique, le chant funèbre, l’humour noir) dans le mouvement d’un seul vol, et qui confirme, avec l’ampleur tranquille des œuvres de maturité, que la littérature turque possède en lui l’un de ses écrivains les plus irremplaçables.