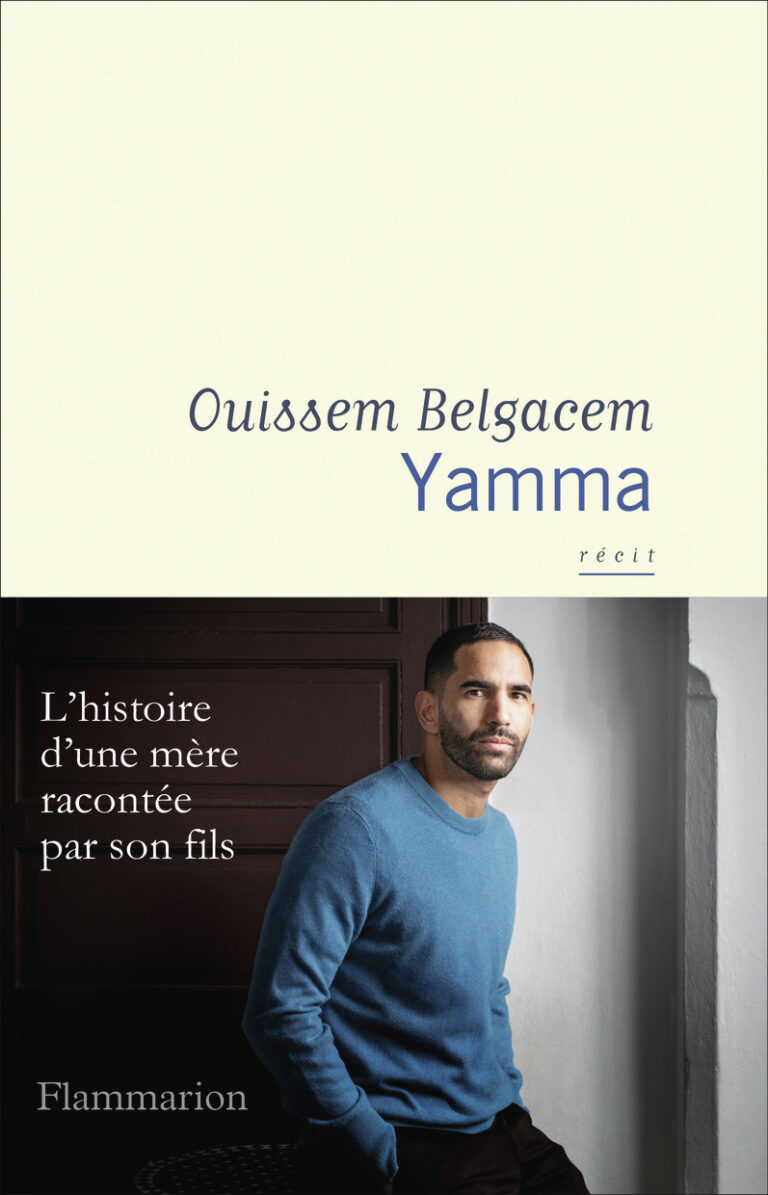Dans son monumental essai sur “La mort”, publié en 1966, Vladimir Jankélévitch faisait une démonstration simple, dont ce livre me paraît illustrer la pertinence. En quelques mots :
“La mort en première personne est source d’angoisse. Je suis traqué. En première personne, la mort est un mystère qui me concerne intimement et dans mon tout (…)”
Il distinguait ainsi la manière dont la mort est ressentie selon qu’il s’agit de celle d’un tiers inconnu (“il ou elle”), d’un proche, (“tu”) ou de soi-même (“je.”)
Le propos de « Ce qui reste des hommes » est facile à résumer : sans doute un peu âgée, Diane se dit qu’elle ne veut pas vivre seule dans l’éternité. Elle se met donc en tête de trouver un homme, parmi ceux qui ont compté dans sa vie, qui accepterait de partager sa dernière demeure. En même temps, elle organise avec un soin minutieux ses futures obsèques. Dans tout le livre, elle se parle à elle-même, utilisant donc le pronom personnel “tu.”
Mais ce “tu” là n’est pas l’Autre, disparu, irremplaçable et laissant le survivant inconsolable. C’est en fait un “je” travesti qui ne masque finalement que le tragique échec de la vie de Diane : la solitude ici-bas, dont elle redoute et qu’elle se perpétue dans l’au-delà. En fait, elle donne l’impression d’être morte vivante et tous ses efforts pour donner quelques couleurs à son semblant de vie s’avéreront vains… Tout au plus parviendra-t-elle à retrouver l’un de ses ex-compagnons, mais réduit à l’état de cendres dans une urne, car il n’a pas eu le bon goût de l’attendre. Cette éventuelle compagnie ne lui plaît pas. Avec les autres possibles candidats qu’elle parvient aussi à retrouver, cela tourne court.
Et puis le lecteur retrouve un peu espoir pour elle car, chemin faisant, elle rencontre deux autres hommes qui – peut-être – pourraient lui redonner vie et la détourner de son macabre projet ? Selon l’affirmation biblique tant galvaudée, “l’amour sera-t-il finalement plus fort que la mort ?” Je laisse au lecteur le soin de le découvrir.
En contrepoint du personnage principal de Diane, nous suivons le parcours tout aussi chaotique de sa meilleure amie, Hélène, également aux prises avec la Parque. Veuve en raison du tragique assassinat de son mari, elle recourt à un remède aux antipodes du morbide projet de Diane. Pour sa part, elle cherche à se griser en donnant libre cours aux plaisirs de l’existence : voyages, fêtes, beuveries, amorce d’une idylle avec deux personnages soupçonnés par ailleurs d’être les assassins de son époux. Le tout entrecoupé de séances de spiritisme à la Allan Kardec, avec un guéridon en guise de truchement vers le monde des morts. Aura-t-elle plus de succès que son amie dans cette lutte, contre ce qui apparaît finalement comme une immense détresse face à leur solitude dans cette vie, plus encore que face à leur crainte du “repos éternel ?”
Tout cela est très triste.
Et le talent de Vénus Koury-Ghata donne un caractère poignant à ce livre admirablement écrit, mettant en scène, d’une part une femme qui ne songe qu’à l’ennui auquel elle associe l’éternité, et d’autre part une femme psychologiquement à demi-morte, qui aimerait tant vivre. Avec Hélène, on pense en effet à la comtesse du Barry implorant le bourreau Samson, au pied de la guillotine : “encore un moment, Monsieur le bourreau !” Quant à Diane, elle rejoint Pierre Lazareff, ce grand patron de presse auquel on prête ce propos : “Ce n’est pas vraiment que j’ai peur de mourir. Mais j’ai tellement peur de m’ennuyer quand je serai mort !”
Tout le vocabulaire lié à la mort défile dans cet ouvrage : meurtre, assassinat, squelette, spiritisme… Même les paysages sont sinistres : brume sur l’île où séjourne Hélène, pourtant sur la Côte d’Azur. Ici, le squelette d’un marronnier. Ailleurs, la visite d’un cimetière…
L’un des interlocuteurs de Diane pressentis pour son projet se montre d’ailleurs très cru : “une tombe reste une tombe, autant dire une poubelle et le mort un déchet, autant dire une ordure. Hop là, on s’en débarrasse…” On est à mille verstes de la vision romantique de Shâh Jahân pour son aimée Mumtaz Mahal, qui a donné lieu à cette merveille, le Taj Mahal.
Le lecteur a envie de voler au secours de ces deux femmes, toutes deux aux prises avec l’angoisse dont parle Jankélévitch en leur rappelant, par exemple, la très pragmatique sagesse d’Épicure, dans sa Lettre à Ménécée :
“La mort n’est rien par rapport à nous puisque quand nous sommes, la mort n’est pas là et quand la mort est là, nous ne sommes plus.” Ou bien lorsque Hélène écrit ceci à son amie : “vie et mort sont un cercle fermé, un serpent qui se mord la queue.” Réminiscence de l’ouroboros égyptien ? Pourquoi ne pas envisager alors l’interprétation optimiste de ce symbole, un cycle de naissances et de renaissances ?
Mais impitoyable, Vénus Koury-Ghata n’offre aucune échappatoire au lecteur : si les graves questions que soulève ce livre trouvent un écho chez lui, lui seul devra y apporter ses propres réponses.
Guillaume SANCHEZ
contact@marenostrum.pm
Khoury-Ghata, Vénus, “Ce qui reste des hommes”, Actes Sud / L’Orient des livres, 03/02/2021, 1 vol. (123 p.), 13,80€
Retrouvez cet ouvrage chez votre LIBRAIRE près de vous ou sur le site de L’ÉDITEUR