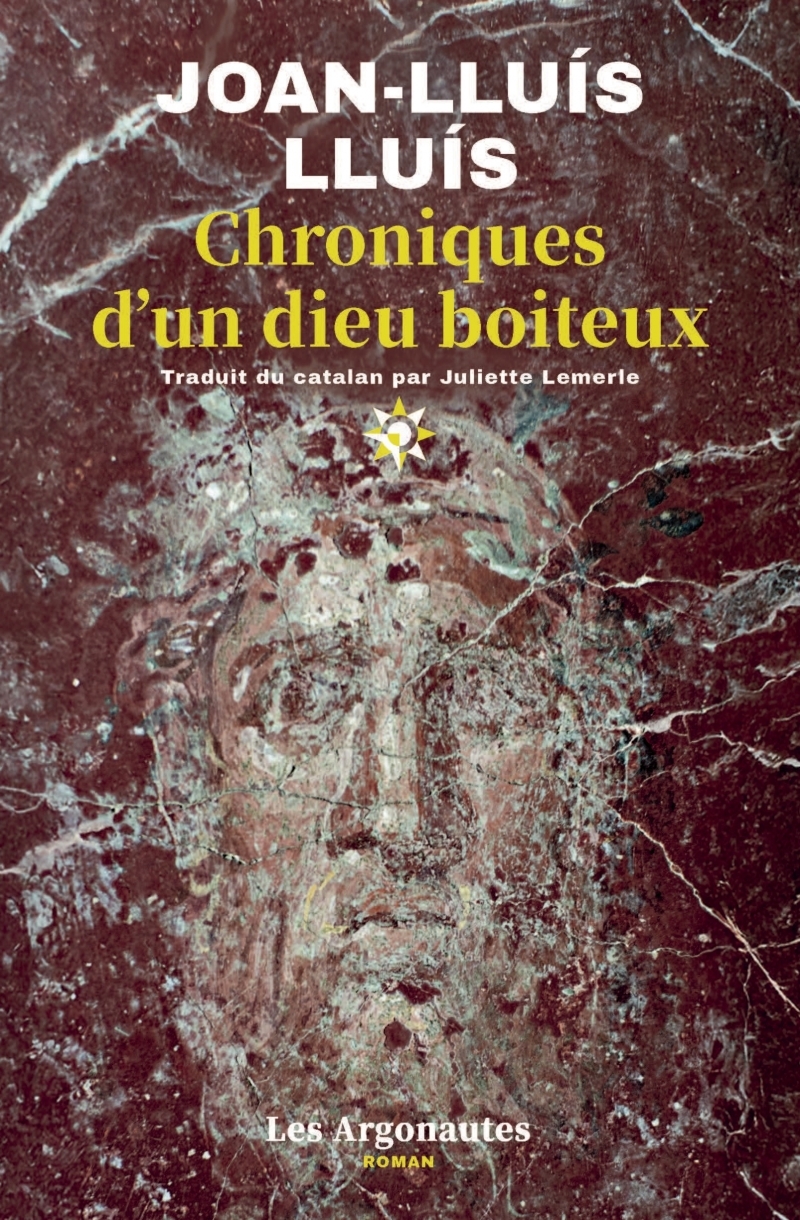Joan-Lluís Lluís, Chroniques d’un dieu boiteux, Traduit du catalan par Juliette Lemerle, Les Argonautes,06/02/2026, 224 pages, 20€.
Imaginez un dieu qui vole une poule. Qui rampe dans la fiente, à plat ventre, pour égorger une volaille avec une fibule en or, aspire la fumée du sacrifice et la vomit aussitôt. Voilà Héphaïstos, forgeron divin, époux d’Aphrodite, réduit à l’état de vagabond grotesque sur les pentes d’un Olympe en ruines. Avec Chroniques d’un dieu boiteux, Joan-Lluís Lluís signe un roman mythologique d’une audace réjouissante, où la grandeur antique se fracasse contre la trivialité de la survie.
La faim d'un immortel, ou comment tuer un dieu
Le roman repose sur une prémisse physiologique qu’aucune fiction consacrée aux dieux grecs n’avait exploitée avec une telle conséquence narrative : les Olympiens se nourrissent exclusivement de la fumée des sacrifices animaux. Quand les chrétiens abolissent ces rites, ils meurent de faim et se désagrègent en statues de sable. Tous, sauf un. Héphaïstos, le boiteux, le laid, celui que sa propre mère Héra a jeté par-dessus la balustrade de l’Olympe le jour de sa naissance, survit parce qu’un mortel, quelque part, continue à brûler un peu de viande en son nom.
Mais celui qui raconte cette histoire le fait depuis le XXIe siècle, après avoir appris, au fil des âges, l’art de lire et d’écrire. L’écart est capital. L’Héphaïstos du VIIe siècle qui quémande l’hospitalité chez un pope de village grec, pris pour un simple d’esprit parce qu’il réclame des sacrifices au milieu de la messe, ne sait rien des mots ; celui de 1946 avoue encore ne pas savoir lire. Ce sont des Chroniques au sens plein, le travail rétrospectif d’un dieu devenu mémorialiste, qui contemple sa propre déchéance avec une lucidité acquise après coup, et cette conscience tardive irrigue chaque page d’une ironie acide.
Un dieu monstrueux, et c'est là que ça devient intéressant
Joan-Lluís Lluís ne cherche pas à rendre son narrateur sympathique. Héphaïstos est drôle, souvent touchant, mais il faut avoir l’estomac solide pour habiter sa voix. Devenu seigneur sicilien, il tue froidement quatre personnes pour s’emparer d’une sacrificatrice, puis s’étonne que cette femme préfère se pendre plutôt que de vivre avec lui. Sa relation avec Magdalena, gamine boiteuse de dix ans qui devient sa première pourvoyeuse de sacrifices, ne relève pas de l’ambiguïté : le texte expose crûment une logique de prédation, de manipulation par la récompense, un rapport de domination que le narrateur rationalise avec la tranquillité d’un être pour qui les mortels n’ont jamais été que des insectes utiles. Quand il oublie que les humains ne respirent pas le soufre de l’Etna et que Magdalena meurt asphyxiée à ses pieds, il récupère sa fibule sur le cadavre et rebrousse chemin. Le lecteur est mis au défi de supporter cette voix qui rationalise l’inacceptable, et c’est précisément ce malaise qui donne au roman sa force singulière.
Ceux qui ont lu Junil, le précédent roman de Joan-Lluís Lluís traduit par la même Juliette Lemerle chez le même éditeur, reconnaîtront une obsession commune : la question de ce que l’on devient quand tout ce qui vous définissait a été détruit. Junil découvrait dans les mots d’Ovide un refuge contre la brutalité du monde. Héphaïstos accomplit le trajet inverse : ce n’est pas une mortelle qui s’élève vers le divin, c’est un dieu qui s’effondre vers l’humain. Les deux romans partagent cette capacité de Joan-Lluís Lluís à créer des compagnonnages improbables entre des êtres que tout devrait séparer.
Quand la machine dépasse le forgeron
À mesure que les siècles avancent, le roman construit une seconde défaite, plus insidieuse que la victoire du monothéisme. Héphaïstos, dieu des inventions, se retrouve dépassé par les inventions des mortels. Le chapitre intitulé « La machine plus forte qu’un dieu » cristallise ce retournement : le forgeron céleste admet que les humains l’ont surpassé. En 1946, il n’est jamais monté dans une voiture, craint l’électricité et les avions. La défaite du paganisme ne procède donc pas seulement de la croix plantée sur les ruines des temples ; elle s’achève dans le bruit d’un moteur que le dieu ne comprend pas.
Et pourtant, c’est dans cette fin de monde que surgissent les pages les plus vibrantes. Artémis, en 1928, déguisée en chasseuse à lunettes noires, tire deux coups de fusil près de sa tête pour lui signaler sa présence : la caresse au bord des lèvres d’une déesse vierge par la main calleuse du forgeron vibre d’une émotion que treize siècles de solitude rendent presque insoutenable. Bernardina, ancienne prostituée aux yeux découpés dans des mouchoirs de nuit, apprend au dieu l’amour tel qu’il ne l’avait jamais connu. Et Antonello Rizzo, prêtre sicilien tombé en moto dans un ravin un matin de neige, devient le premier ami véritable d’Héphaïstos, celui à qui il confie enfin son récit, et dont la présence, à la toute fin, prend une dimension qu’il vaut mieux découvrir dans le silence de la lecture.
Joan-Lluís Lluís a composé un roman picaresque et métaphysique, porté par une voix qui réinvente la première personne divine avec une liberté frondeuse. Héphaïstos insulte sa mère (mère-assassine, mère-truie, mère-vipère, mère-merdeuse), éjacule jusqu’au plafond d’une grotte sous-marine et pleure la mort d’une prostituée aux taches de rousseur, le tout avec la même souveraineté de ton. La traduction de Juliette Lemerle préserve la rugosité catalane dans une langue française qui respire, qui boite, qui avance à l’image de son narrateur.