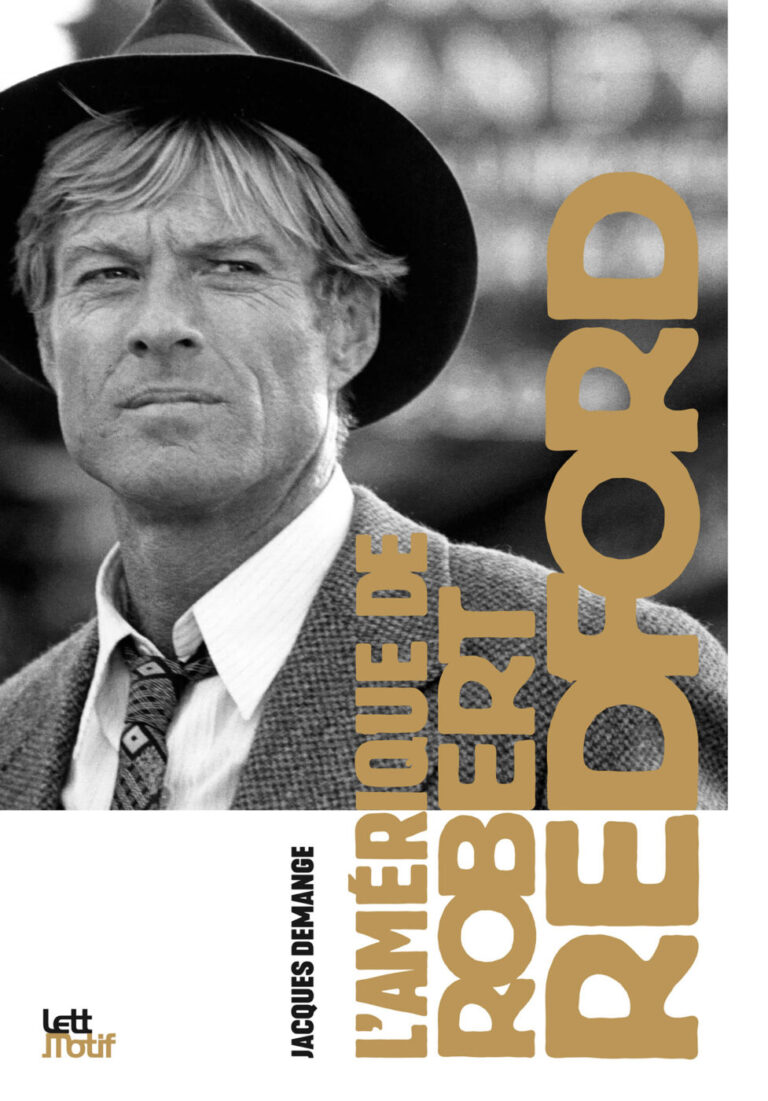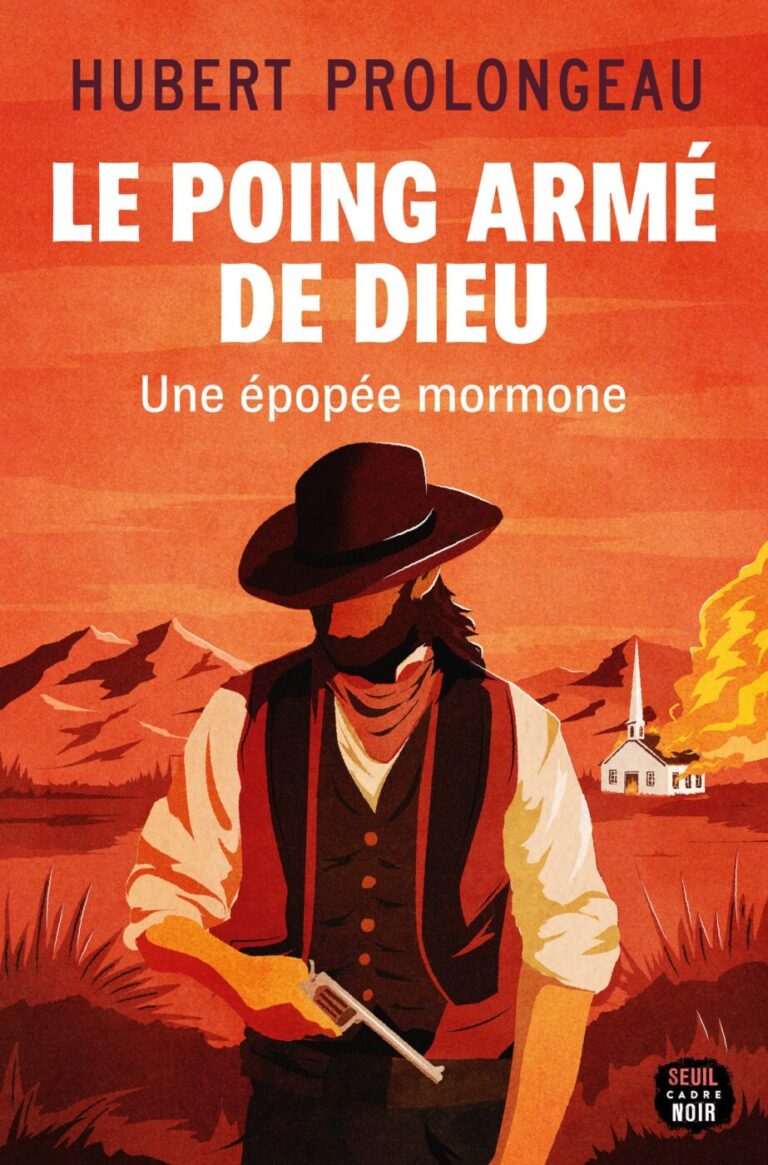Martin Smaus, Petite, allume un feu…, Traduit du tchèque par Christine Laferrière, Éditions des Syrtes, 23/01/2026, 500 p. 14€
Un gamin morveux au pantalon retenu par une ficelle, une chaîne en or volée à quatre ans, et le rapide de nuit qui cliquète sur les rails : c’est par ces images que Martin Smaus ouvre le destin d’Andrejko Dunka, petit Rom arraché à sa mère dans les montagnes slovaques pour traverser, pieds nus et cœur battant, toute la Tchécoslovaquie d’avant la partition. Quatre cent quatre-vingts pages d’une densité narrative et sensorielle rare.
Le gamin aux doigts d’or
Le premier geste d’Andrejko dans ce roman est un vol. À quatre ans, il subtilise la montre et la chaîne en or de son oncle Fero, voleur des chemins de fer balafré et boiteux. L’épisode fonde tout : “ses mains sales et barbouillées resplendissaient d’or, comme un tournesol épanoui au beau milieu d’un champ gelé”. L’enfant prodige de la débrouille quitte alors les montagnes pour Prague, où l’attend l’immeuble décrépi de Zivkov, la mendicité organisée par sa tante Ida, le froid du balcon qui remplace le ciel de Poljana. Dès ces premières pages, Martin Smaus inscrit son récit dans la lignée du roman d’apprentissage dévoyé : Andrejko grandira, mais chaque étape de sa formation sera une perte, chaque initiation un arrachement.
Car le livre avance par dépossessions successives, chacune plus cruelle. Chaque déplacement est une amputation : de sa mère Maria, dont les pleurs résonnent longtemps après la séparation ; de sa langue maternelle, le romani chib, que la télévision tchèque érode insidieusement ; de sa dignité, que la maison de correction de Kostelec pulvérise avec méthode. Les éducateurs rasent le crâne du fugitif, les garçons le tabassent pour une semaine sans télévision, le directeur se réjouit que “ce vaurien soit encore en vie”, pour ne pas perdre sa prime. La violence institutionnelle se déploie avec une exactitude factuelle qui tient du constat. Ce traitement rejoint une question vive de la littérature tchèque contemporaine : la visibilité rom dans un espace national qui a longtemps préféré l’assimilation forcée à la reconnaissance.
Le poêle, la lampe, le seuil
Le roman bascule quand Andrejko revient à Poljana et retrouve sa cousine Anetka, la petite Kalori qui aimait danser. Leur nuit de Noël dans la roulotte constitue l’un des passages les plus saisissants du livre. Martin Smaus y déploie une écriture du corps d’une franchise qui situe le roman dans une tradition centre-européenne de l’enracinement charnel, plus proche d’un Bohumil Hrabal par le mélange de trivialité et de grâce que d’un Kundera, trop ironique pour ce registre. Les lokse cuisent sur la plaque en fonte, Anetka murmure “Mon Andrejko, Andrejecko”, et deux solitudes se fondent dans une scène d’amour longue, maladroite, charnelle, où la douleur et le désir se confondent. Le feu, ici, est d’abord domestique et rituel : celui du poêle, de la lampe à pétrole que les amants transportent d’un coin à l’autre, de la plaque où cuisent les galettes. Il ordonne les gestes du quotidien, scande les saisons. Martin Smaus lui confère progressivement une dimension cosmologique, en l’arrimant au feu pascal de l’église de Poljana, à cette flamme que chaque fidèle rapporte chez soi pour rallumer un foyer nettoyé.
De cette étreinte naît Darjenka, et avec elle un fragile équilibre. Le hameau, les Jasencak, le garde forestier Mihalic composent un réseau de solidarité silencieuse. Mais la scène de la petite monnaie jetée par Anetka aux pieds des villageois, ce renversement superbe où la Tzigane traite les gadjé en mendiants, annonce la catastrophe : les humiliés ne pardonnent jamais.
Les rails, toujours les rails
Le fils Jankura viole Anetka. Andrejko le tue à la hache. Une expédition punitive fracasse la roulotte, renverse la lampe à pétrole dont le “cylindre noir de suie” se brise au sol. Le foyer s’éteint, au sens propre : ce qui disparaît avec Anetka, ce sont les gestes qui structuraient leur existence commune, cuire, chauffer, éclairer. Anetka meurt dans les bras d’Andrejko, et le texte bascule dans une prose visionnaire, où les couleurs se succèdent “du noir au rouge, puis au violet, jusqu’au bleu turquoise”, avant de retomber dans le silence.
Ce qui sauve Andrejko de la balustrade du pont sur la Radbuza, c’est Darjenka, sa fille. Et c’est un haut-parleur de gare qui le remet en mouvement : le rapide international Becva en direction de Kosice et Zilina, les rails de son enfance. Le 23 décembre 1993, quatorze heures passées de quelques minutes, Andrejko attrape la poignée d’un wagon et le roman se referme sur ce geste d’élan, sur un quai de Plzeň où des flocons descendent sur les toits. Le roman s’achève sans formation accomplie : Andrejko repart vers l’est avec pour seul bagage un enfant et un édredon roulé.
Martin Smaus a écrit un livre circulaire, où les trains reviennent comme les saisons, où les roues d’acier mesurent le temps mieux que les horloges. Le roman pose, avec une ampleur ethnographique et une sensualité terrestre qui lui sont propres, la question du déracinement rom dans l’espace centre-européen d’après 1989. La traduction de Christine Laferrière épouse les longues phrases sinueuses de l’original, ces périodes qui avancent par accumulation. Le titre en forme d’injonction tendre, Petite, allume un feu…, résonne jusqu’à la dernière page : dans un pays où l’on passait encore des chaînes sur les puits, allumer un feu, c’est un acte de subsistance, de résistance, de civilisation.