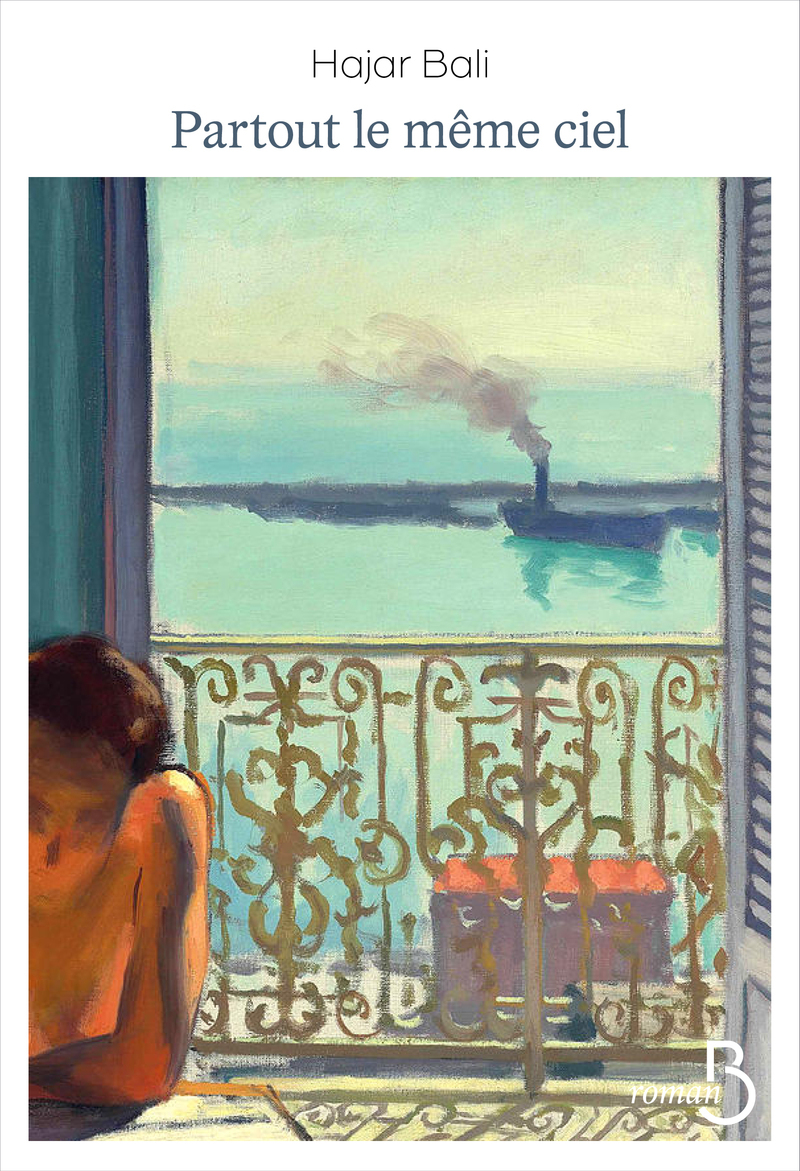Hajar Bali, Partout le même ciel, Éditions Barzakh / Belfond, Alger, 21/08/2025, 320 pages. 21€
Alger, fin des années 2010. Wafa, lycéenne de dix-sept ans, et Adel, son petit ami de vingt ans qui a décroché du système scolaire, s’introduisent chez une vieille dame pour lui dérober quelques billets. Ils repartent avec cinq mille dinars et un pot de confiture, persuadés d’en avoir fini. Mais Slim, le fils de la victime, ancien professeur de philosophie en rupture avec le monde, les rattrape et leur propose un marché inattendu : plutôt que la police, des « travaux forcés » à son service. De cette dette inaugurale naît une relation triangulaire où le désir, la quête spirituelle et la violence sourde s’entremêlent, tandis que l’Algérie du Hirak gronde au-dehors. Hajar Bali construit son deuxième roman comme une partition à plusieurs voix qui bascule progressivement de la confession intime vers le dossier d’enquête, du récit d’apprentissage vers l’interrogatoire policier.
Le cordon rose des boîtes à gâteaux
« Madame Souami ? c’est pour un sondage. Vous connaissez la lessive “Normal” ? » Wafa, dix-sept ans, lunettes trop grandes, prend sa plus belle voix pour s’introduire chez Mémé Souami. Adel, vingt ans, pousse violemment, plaque la vieille dame contre lui, main sur la bouche. Hajar Bali ouvre son roman par une scène d’une brutalité sèche où le malaise physique (Wafa vomit, croit être enceinte) se mêle à des digressions incongrues. Pendant qu’Adel ligote la victime avec un cordon de boîte à gâteaux, Wafa feuillette les enluminures des Mille et une nuits trouvées sur la table de chevet : « Les Perses peignaient sans tenir compte de la perspective. Tout le monde est de profil, des nez droits et des barbes en pointe. »
Cette dissonance donne le ton. Le cambriolage n’échoue pas à proprement parler : ils emportent l’argent, le pot de confiture pour la mère de Wafa. Mais la culpabilité les ramène sur les lieux, où Slim les cueille. Quarante ans, fils unique de Mémé atteinte d’alzheimer, ancien professeur de philosophie ayant démissionné de l’université, il leur inflige ce qu’il nomme des « travaux forcés » : Adel repeindra la cuisine, Wafa fera la toilette de sa mère. « J’ai enfin une mission : les guider vers la lumière », pense-t-il, avec cette grandiloquence qui masque mal sa propre dérive.
Le contrat semble déséquilibré, trouble. Slim oscille entre posture de guide spirituel et désir inavoué pour Wafa. Il se répète qu’elle est trop jeune ; qu’il doit se tenir à distance, mais il la regarde, la frôle, lui prête des livres cornés aux bonnes pages. Adel perçoit cette tension sans pouvoir la nommer ; il se croyait protégé par le mariage, « persuadé que, grâce au mariage, je n’aurai plus jamais de rival ». Le triangle qui se noue n’a rien de platonique ; c’est un désir qui se nie, se déplace vers le discours mystique, revient en obsession.
Là où le sable s'envole à chaque bourrasque
Hajar Bali ancre ses personnages dans une géographie concrète. Alger d’abord, ses quartiers populaires de Belcourt, ses cafés où Slim affronte l’hostilité d’un serveur nommé Moh qui lui jette son café et passe un chiffon crasseux sur la table. Le front de mer où Wafa et Adel se retrouvent sur « leur banc », les pigeons tyranniques, les enfants qui courent. Les appels des muezzins « jamais synchrones », formant « comme un canon, avec des voix aux textures différentes » : le premier jeune et rageur, le suivant chevrotant, le dernier timide et modulant ses fins de phrase.
Biskra ensuite, où Slim emmène le couple sur ses terres familiales. Le cousin Mustapha, végétarien qui « ne mange rien qui ait une âme, et des yeux qui regardent », les accueille dans sa cabane rustique. Palmeraie, gravures rupestres libyques, mosquée souterraine garnie de manuscrits : la romancière déploie un Sud algérien à la fois archaïque et vivant. Wafa découvre une femme au front tatoué d’un alif et veut aussitôt « la lettre noun sur mon épaule et un ciel étoilé sur le dos ». Le désir de marque traverse le roman, contrepoint charnel aux spéculations de Slim sur l’« anarchie numide » : « Citadelles imprenables, barbarie assumée. Rien ne prend. Le sable s’envole à chaque bourrasque. »
Le Caire enfin, où Slim part seul pendant plusieurs mois. Slim fréquente la mosquée de Sayyeda Zeineb, erre dans les cafés, rencontre une certaine Fayza, écrit ses cahiers sur l’amour mystique en convoquant Rumi, Sohrawardi, El Hallaj. La quête vacille entre islam soufi et tentation athée. « Il m’est arrivé, pendant la prière, de regarder au-dedans de moi, et c’était pas beau à voir », confie-t-il.
Ce n'est là que la surface
La force singulière du roman tient à sa mutation formelle. La première moitié entrecroise les voix de Wafa, Adel et Slim dans une polyphonie intime, ponctuée de scènes domestiques, de disputes, de réconciliations charnelles. Wafa tombe enceinte, épouse Adel malgré les réticences familiales, accouche d’une fille nommée Leila. Le quotidien s’installe : pizzeria où travaille Adel avec son frère Sami, visites chez Slim qui poursuit ses méditations solitaires, tensions avec les parents de Wafa qui surveillent leur fille comme « des radars ».
Puis le roman bascule. Une section intitulée « L’enquête » adopte la forme sèche des procès-verbaux d’interrogatoire, avec noms, prénoms, filiations, professions. Un inspecteur vaniteux convoque les proches de Slim : Hassan le menuisier pieux, Mustapha le cousin, Moh le serveur hostile, Fatimata une doctorante qui l’a brièvement fréquenté, Anissa la psychanalyste belle-mère d’Adel. Les témoignages se contredisent, dessinent un homme « maniaque », « infiniment séduisant malgré sa laideur », « perturbé », « inoffensif ». Une liaison secrète affleure, des pistes terroristes sont évoquées puis abandonnées, des pressions politiques s’exercent.
Ce dispositif permet à Hajar Bali de multiplier les points de vue sur un personnage qui échappe à toute saisie définitive. On a cédé à l’apparence des choses, suggère le texte ; ce n’est là que la surface. Le roman applique cette maxime à sa propre construction, refusant de livrer une vérité unique. L’enquête piétine, les certitudes se défont, et le lecteur reste avec des fragments, des hypothèses, des silences.
Partout le même ciel conjugue ainsi plusieurs registres : confession adolescente, méditation philosophique, chronique conjugale, dossier policier. Hajar Bali, qui avait exploré la guerre civile algérienne dans Écorces, sonde ici les années du Hirak et leurs lendemains désenchantés, à travers des personnages qui cherchent une issue sans savoir laquelle. Le ciel, partout le même, recouvre leurs errances comme une promesse indéchiffrable. Rarement un roman aura su entrelacer avec cette justesse l’intime et le politique : sous les hésitations amoureuses de trois êtres en quête de lumière, c’est toute l’Algérie du Hirak qui vibre, espère, puis se heurte au mur du réel.