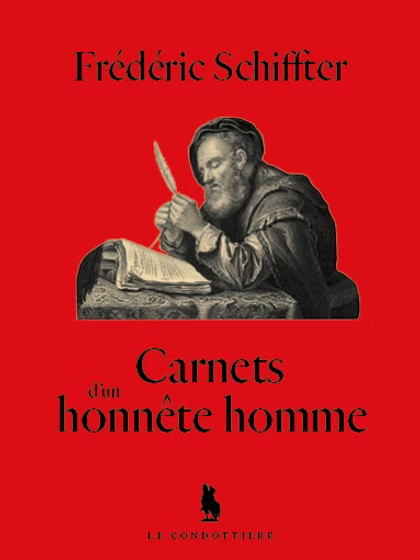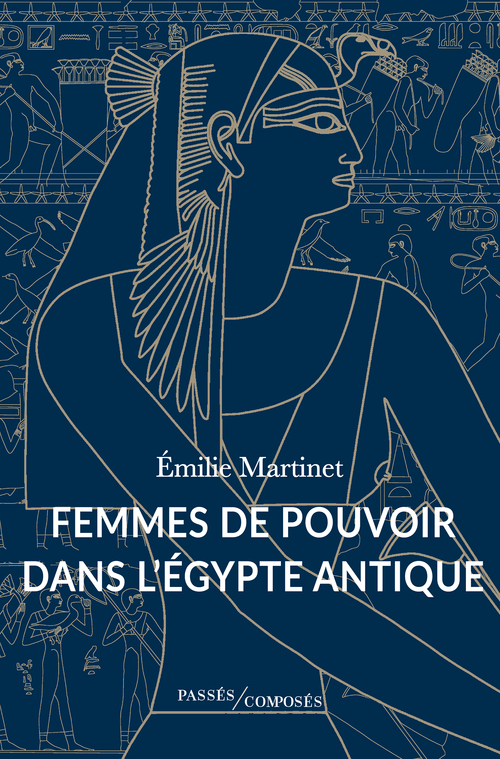Frédéric Schiffter, Carnets d’un honnête homme, Le Condottiere, 21/10/2025, 190 pages, 15€
Découvrez notre Podcast
L’élégance est une arme, le désenchantement une civilité. D’un trait de plume qui tient autant du scalpel que de la pointe sèche, Frédéric Schiffter rassemble ici des carnets où la pensée circule à découvert, libérée des lourdeurs du système et de la pose du philosophe-roi. Ici, nulle cathédrale conceptuelle, nul impératif de sauver le monde, nulle prophétie pour les lendemains qui chantent : seulement la voix claire d’un homme qui préfère la netteté à la posture, le doute à la doctrine. D’un souvenir d’adolescence dans les cinémas de Biarritz à une joute avec Orwell, de la verità de Machiavel à la mélancolie solaire de Gaston Lagaffe, ces pages dessinent une géographie intime où l’on croise Montaigne et Chamfort, où l’on s’assoit à l’écart des foules sentimentales. Un livre qui pense en traits, avance en détours, et laisse derrière lui une évidence troublante : la vraie élégance consiste peut-être, avant tout, à ne jamais se mentir.
Naissance d’une voix : se former à l’écart, apprendre le ton
Tout commence par une réticence fondatrice, une distance prise avec le vacarme de l’époque. Frédéric Schiffter ouvre ses carnets sur une auto-généalogie qui éclaire la genèse de son « honnêteté ». L’adolescent qui, dans les années soixante-dix, délaisse les gesticulations collectives et les kermesses idéologiques pour l’obscurité des salles obscures, pose déjà les jalons d’une méthode. L’honnête homme, cette figure que La Rochefoucauld définit comme celui « qui ne se pique de rien », naît chez lui d’une double école : la fréquentation des œuvres d’art et la solitude comme hygiène mentale. Frédéric Schiffter comprend très tôt que la littérature et la philosophie offrent un refuge bien plus sûr que les promesses intenables du monde réel. Elles servent, non à transformer le plomb de la réalité en or utopique, mais à se tenir droit dans le chaos.
Dans cette éducation au retrait, la figure de Monsieur Homais occupe une place cardinale. En convoquant le pharmacien de Flaubert, l’auteur dresse avec une jubilation féroce le portrait-robot de l’ennemi intime : le bête qui pense, l’affairé, celui qui transforme son arrière-boutique en laboratoire universel pour inonder le monde de ses certitudes morales. L’auteur voit dans ce bourgeois positiviste l’ancêtre direct de nos modernes « intellectuels », ces experts en indignations qui s’arrogent le droit de régenter les consciences au nom du Bien. Contre cette logorrhée de l’engagement, devenue la norme médiatique, le philosophe oppose la sécheresse salutaire du moraliste.
Sa lecture de George Orwell confirme cette exigence esthétique autant qu’éthique. Là où l’époque encense l’auteur de 1984 comme le prophète indispensable de nos temps de surveillance, le philosophe décèle le propagandiste politique prêt à sacrifier le style sur l’autel du message. Il lui préfère la noirceur de Jonathan Swift, dont les Voyages de Gulliver ou l’anarchisme atteignent une vérité anthropologique plus profonde par la grâce d’une misanthropie radicale et d’une imagination débridée. Car l’art ne sert pas ; il est.
La querelle, amicale mais ferme, avec Clément Rosset sur la question de la joie permet d’affiner cette position. Schiffter assume son « pessimisme chic » – étiquette qu’il retourne comme un compliment. À l’affirmation nietzschéenne d’une force majeure, d’une joie tragique d’exister, il oppose la réalité brute de la souffrance schopenhauerienne et la sagesse sans illusion de l’Ecclésiaste. L’existence humaine se déploie comme une tragédie jouée par des comiques, une rengaine où la conscience du malheur structure le réel bien plus sûrement que les artifices de l’allégresse. Depuis le péché originel, compris ici comme une vérité psychologique indépassable, l’homme demeure cet animal inquiet qui s’agite pour oublier sa condition.
Politique, pouvoir, masque : prudence, mensonge, et “manière”
Ce regard, Frédéric Schiffter le porte ensuite sur le terrain du politique et des relations humaines, convoquant deux maîtres du désabusement : Machiavel et Baltasar Gracián. Entre le Florentin et le Jésuite aragonais, une conversation s’installe sur l’art de survivre parmi les loups. Le philosophe de Biarritz lit Le Prince comme un manuel de survie toujours actuel : gouverner les hommes exige de renoncer à l’idéal de transparence pour embrasser la verità effetuale, cette vérité effective où la force et la ruse tiennent lieu de vertus cardinales.
Mais c’est avec Gracián que l’analyse touche au sublime. Schiffter consacre des pages pénétrantes au « martyr de l’élégance », définissant celle-ci non comme une coquetterie de surface, mais comme une prudence incarnée, une armure de soie. Le « Discreto », l’homme de bon choix, survit en société grâce à la manière, ce masque nécessaire qui protège son intériorité des assauts de la vulgarité. L’élégance devient une éthique de la distance, une façon de tenir son rang tout en se dérobant aux emprises, de participer au jeu social sans jamais s’y laisser capturer.
Cette esthétique du retrait trouve son maître absolu en Montaigne. Frédéric Schiffter voit en l’auteur des Essais le compagnon idéal, celui qui marie le scepticisme ondoyant à l’acosmisme de l’Ecclésiaste. Montaigne refuse d’enseigner, de sauver, de construire ; il s’observe, note le branle perpétuel de ses humeurs, l’instabilité de son moi. Contre les philosophies qui promettent la sagesse ou la maîtrise de la mort – cette « hâblerie » stoïcienne –, Montaigne accepte la condition humaine dans sa précarité. Philosopher, ici, c’est renoncer à « apprendre à mourir » pour apprendre à vivre son « passage » en dilettante, en acceptant que la raison demeure un instrument faillible et que nous restons, pour l’éternité, des apprentis.
Figures-limites et sortie par le retrait : cruauté, illusions, farniente
L’ouvrage atteint une intensité particulière lorsqu’il aborde les figures ayant poussé la lucidité jusqu’au point de rupture. Chamfort, moraliste à la « cocarde de suicide », incarne cette tension extrême. Pris dans la tourmente révolutionnaire, tiraillé entre son dégoût de l’aristocratie et sa méfiance envers la plèbe, Chamfort paie le prix fort de son refus des illusions. Frédéric dépeint avec empathie le destin de cet homme d’esprit, tentant maladroitement de se tuer pour échapper à la Terreur, figure tragique d’une clairvoyance devenue irrespirable.
Cette lucidité s’étend à la question du mal. Arbitrant le duel entre Platon (le mal est une ignorance) et Saint Augustin (le mal est une volonté), l’auteur tranche en faveur de l’évêque d’Hippone. La méchanceté n’est pas une erreur de jugement, mais une volupté, la conséquence d’une nature corrompue par l’amour-propre. Il dissèque avec une précision clinique les trois types de contre-vérités – l’erreur, le mensonge, l’illusion –, démontrant que l’illusion, parce qu’elle s’enracine dans le désir et console, s’avère la plus indéracinable de toutes. C’est elle qui nourrit la superstition moderne par excellence : la croyance au Progrès. Contre les téléologies de Condorcet, Hegel ou Marx, qui cherchent désespérément un sens à l’Histoire, l’auteur réhabilite le hasard. L’histoire reste, selon le mot de Shakespeare, un récit plein de bruit et de fureur, raconté par un idiot, et qui ne signifie rien.
Pour clore ce bréviaire, Frédéric Schiffter choisit la voie la plus inattendue et sans doute la plus cohérente : celle du dilettantisme radical, incarné par Gaston Lagaffe. Le héros de Franquin, ce « desperado en espadrilles », devient sous sa plume l’allégorie involontaire de la résistance à l’aliénation du travail productif. Par sa passivité active, par ses siestes et ses inventions absurdes, Gaston sabote la logique de l’entreprise et rétablit les droits du songe.
L’ouvrage s’achève sur un « Petit abécédaire du farniente », coda où l’auteur distille, avec une légèreté souveraine, son art de vivre. Il y fait l’éloge de la nage, du coussin, de l’effacement, du « muser ». Contre la lourdeur des engagements et la vulgarité de l’action, Schiffter propose une « apanthropie » douce, une retraite choisie qui permet de goûter les rares plaisirs réels que la vie accorde : un rayon de soleil, un livre, le silence. Dans notre monde saturé de certitudes bruyantes, ces Carnets résonnent comme une invitation salutaire à cultiver son propre jardin, fut-il composé uniquement de doutes, de courants d’air et d’une imprenable liberté.