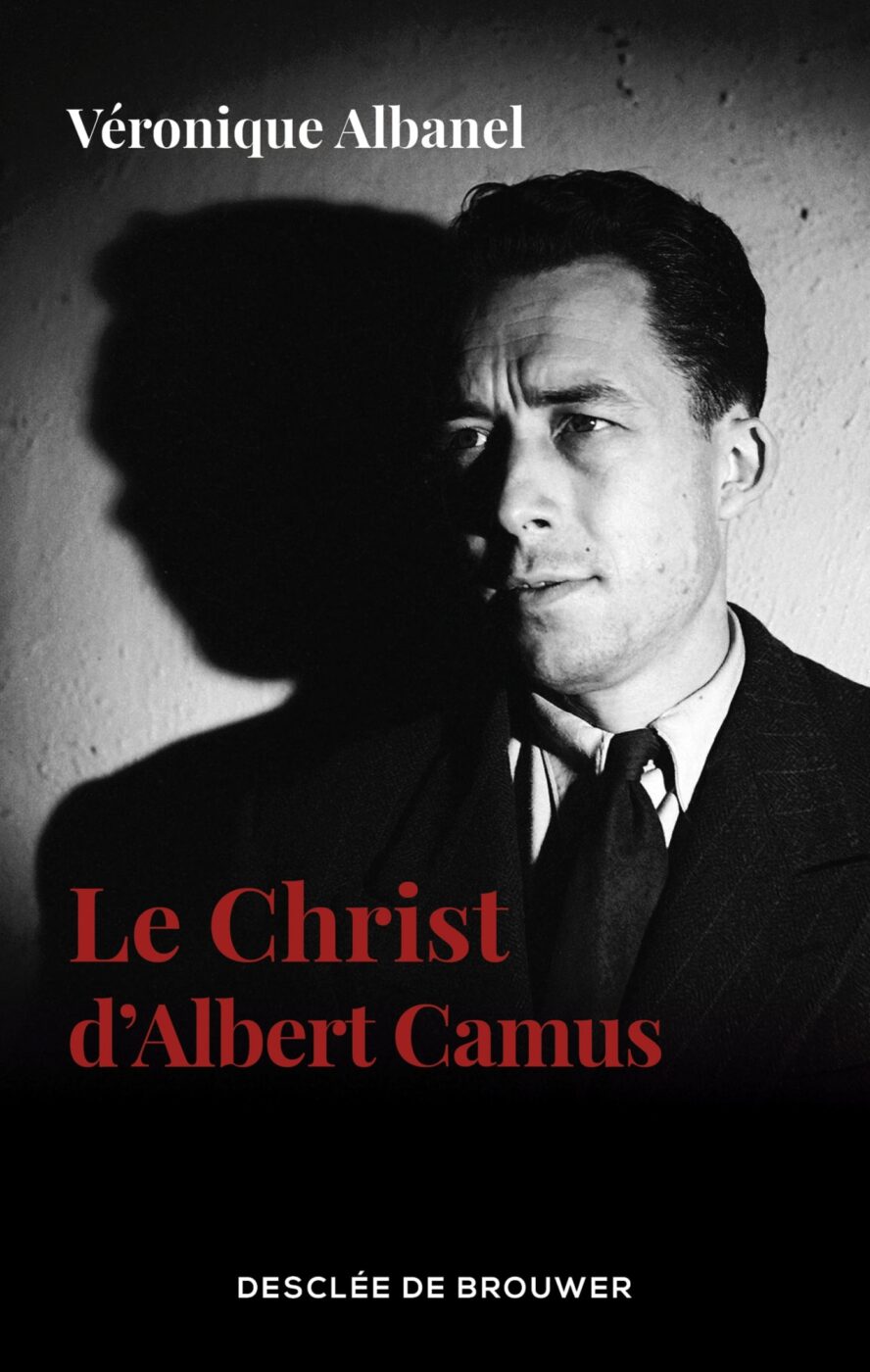Véronique Albanel, Le Christ d’Albert Camus, Ed. Desclée de Brouwer, 10/09/ 2025. 208 pages. 18,90€
Avec Le Christ de Camus, Véronique Albanel nous entrons au cœur de l’œuvre camusienne, et de ses paradoxes. Il y en a eu de nombreux tant dans sa pensée que dans ses engagements humanistes et politiques. Elle propose une lecture originale et minutieuse de la relation intellectuelle, morale et spirituelle qu’Albert Camus a entretenue avec la figure du Christ. L’axe principal de cet ouvrage est de répondre à une question sans doute ambitieuse, mais fondamentale. Comment un écrivain qui se déclare « incroyant, mais non athée » a-t-il pu vouer une telle admiration à la figure du Christ tout en rejetant fermement la Résurrection, la divinité de Jésus et l’espérance d’un Au-delà ? C’est un rapport singulier qu’Albert Camus entretint avec la figure du Christ tout au long de son œuvre. C’est que tente d’aborder cet essai avec une grande rigueur intellectuelle et une réelle finesse spirituelle.
Quel est le Christ de « L’homme révolté » ou du « Premier homme » ?
Véronique Albanel s’appuie sur une documentation riche : textes littéraires et philosophiques de Camus, Carnets, essais, correspondances, prises de position publiques. Cette approche textuelle serrée permet de montrer que la relation de Camus au Christ n’est ni superficielle ni marginale, mais récurrente et profondément structurante pour sa pensée. Elle identifie chez Camus, que le Christ est essentiellement un corps souffrant, et comme étant la figure par excellence de l’innocence persécutée, du condamné injustement, du pauvre solidaire. Cette lecture rejoint l’intuition que la figure christique peut représenter une critique radicale de toutes les formes de violence. Elle montre également que Camus développe une éthique exigeante : refus du meurtre, solidarité avec les humiliés, engagement pour la justice. Cette éthique, bien que non théologique, se nourrit de la compassion et de la dignité humaine qui deviennent des valeurs centrales. Cet essai s’inscrit à la croisée de la philosophie, de la Théologie et de l’histoire intellectuelle. Il prend pour objet un paradoxe bien connu mais rarement exploré avec une telle systématicité. Le projet de Véronique Albanel est de suivre au plus près des textes, des œuvres philosophiques et littéraires, le dialogue inachevé que Camus a entretenu avec le Christ tout au long de sa vie.
Le Christ d’Albert Camus n’est pas celui de la victoire pascale, mais celui de la Croix
La thèse principale de l’ouvrage peut se formuler ainsi : Camus s’arrête délibérément au Christ de la Croix. Il reconnaît dans le Christ supplicié une figure exemplaire de l’innocence persécutée, de la solidarité avec les humiliés et du refus du meurtre, mais refuse la Résurrection qu’il perçoit comme une rupture introduisant une espérance métaphysique dangereuse. Cette espérance, selon lui, risquerait de justifier l’injustice historique et de détourner l’Homme de sa responsabilité. C’est le Christ supplicié qui l’intéresse : innocent broyé par l’injustice, solidaire de tous les humiliés, compagnon des condamnés et des pauvres. La Résurrection constitue pour lui une rupture. Elle introduit une espérance qu’il juge dangereuse, car susceptible de détourner les Hommes de la responsabilité terrestre et de justifier l’injustice présente au nom d’un Salut futur. En ce sens, Camus demeure profondément marqué par une morale de l’immanence. L’auteure analyse le rapport camusien au corps et à la souffrance en éclairant la place de la chair dans cette fascination pour le Christ : le corps meurtri, malade, humilié devient le lieu même de la vérité humaine. La maladie de Camus, sa pauvreté originelle, son attachement à sa mère silencieuse, mais aussi son admiration pour l’art chrétien italien (Giotto, Piero della Francesca) nourrissent cette vision d’un Christ profondément incarné, débarrassé de la Toute-puissance. Si Dieu est tout-puissant c’est qu’il est en Amour, en charité et en miséricorde. Cette centralité de la souffrance dans cette appropriation camusienne du Christ est au cœur de cette réflexion. Marqué par la maladie, la pauvreté et la mort, Camus reconnaît dans la chair meurtrie le lieu d’une vérité irréductible. Le Christ devient ainsi le témoin par excellence de la condition humaine, non comme Sauveur transcendant, mais comme frère en souffrance.
Que reste-t-il du Christ lorsque la Résurrection est refusée ?
Albert Camus, tel que le restitue l’essayiste, répond sans ambiguïté : il reste un homme juste, innocent, solidaire des souffrants, un homme, et non le Fils de Dieu qui détruit la mort. À cet endroit exact se situent à la fois la force et la limite de la position camusienne. Il reprend implicitement la critique paulinienne du scandale de la Croix, tout en refusant son dépassement pascal. Or, pour la Tradition chrétienne, la Croix n’est pas seulement le lieu de la solidarité divine avec la souffrance humaine. Elle est inséparable de la Résurrection comme affirmation que l’injustice et la mort n’ont pas le dernier mot. En s’arrêtant à la Croix, Camus absolutise la compassion mais prive celle-ci de toute espérance eschatologique. Il refuse toute justification du Mal, y compris religieuse. Il redoute que la promesse de l’Au-delà ne serve à excuser la violence, et son refus de l’immortalité vise d’abord une éthique de la responsabilité immédiate. Une morale sans résurrection peut-elle soutenir durablement le poids de la souffrance innocente ? Camus affirme qu’il faut continuer à aimer et à lutter « même dans la défaite », mais cette exigence repose entièrement sur la seule force humaine. D’un point de vue philosophique, est-ce que le refus camusien de la Résurrection n’est pas moins un rejet du dogme qu’une incapacité à penser une espérance non aliénante. La Résurrection chrétienne ne nie pas la souffrance ni l’histoire, mais affirme que la justice et l’amour ont une portée qui excède l’échec visible. Il oblige la Théologie à se justifier moralement, et cette dernière doit aussi l’interroger sur les limites d’une éthique sans transcendance.
La Résurrection comme ligne de fracture théologique
Véronique Albanel met en lumière avec une grande précision une figure christologique paradoxale : un Christ vénéré, aimé, imité, mais privé de résurrection, donc privé de toute fonction sotériologique au sens chrétien. Cette lecture, fidèle à l’œuvre de Camus, oblige la théologie à un examen critique : peut-on encore parler du Christ lorsque la résurrection est récusée ? Et que devient le salut lorsque la grâce est évacuée au profit d’une morale purement humaine ? La Résurrection constitue pour Camus un point de rupture infranchissable. Non pas par simple incrédulité factuelle, mais pour des raisons éthiques. La Résurrection introduit, selon lui, une promesse d’au-delà qui risque de désamorcer l’indignation devant l’injustice présente. Elle menace de convertir la révolte en résignation et la compassion en attente. D’un point de vue théologique, cette position revient à dissocier radicalement la Croix de la Résurrection, là où le christianisme les pense comme un unique Mystère pascal. Camus accepte la Croix comme révélation d’une solidarité radicale de Dieu avec les victimes, mais refuse la Résurrection comme victoire sur la mort. Il en résulte une christologie tronquée : le Christ est réduit à la figure du Juste souffrant, analogue à Job ou aux martyrs de l’histoire, mais il ne sauve pas. La Tradition chrétienne, de saint Paul aux Pères de l’Église, n’a jamais pensé la Croix indépendamment de la Résurrection. « Si le Christ n’est pas ressuscité, vaine est notre foi » (1 Cor 15,14) ne relève pas d’un dogmatisme abstrait, mais d’une affirmation sotériologique : sans Résurrection, la Croix demeure une défaite exemplaire.
Camus rejette la Résurrection au nom de la justice en accusant l’espérance chrétienne de relativiser l’histoire, de détourner l’Homme de sa responsabilité. La Résurrection n’est pas une consolation ajoutée à la Croix ; elle est la contestation radicale de la mort infligée à l’innocent. Elle ne justifie aucune injustice. Elle les condamne toutes, en affirmant qu’aucune d’elles n’est définitive. Refuser la Résurrection, c’est affirmer que les victimes n’auront jamais raison, que leur cri ne recevra jamais de réponse, que l’histoire des bourreaux demeure la seule efficace. La critique camusienne refuse la Résurrection parce qu’il y voit une promesse dangereuse. Elle risquerait de relativiser l’injustice présente, de déplacer l’espérance hors de l’Histoire, et de rendre tolérable ce qui ne doit jamais l’être. Elle deviendrait une fuite hors du monde. L’histoire du christianisme montre combien la promesse de l’Au-delà a parfois servi d’alibi à l’oppression. Or, la Résurrection n’est pas une compensation. Elle est une contestation radicale du Mal qui n’excuse rien, mais juge tout. Elle affirme que la mort infligée à l’innocent n’est pas la vérité ultime du monde. Théologiquement, elle n’annule pas la Croix ; elle la justifie. Elle ne détourne pas de l’Histoire. Elle l’ouvre à une promesse de justice que l’histoire seule ne peut produire. Refuser la Résurrection au nom de la justice, c’est risquer de condamner définitivement les victimes à n’avoir jamais raison. Camus ne reconnaît au Christ aucune fonction salvifique. Le Christ camusien n’arrache pas l’Homme au Mal ; il l’accompagne dans son malheur. Cette position revient à substituer au Salut chrétien une éthique de l’exemplarité. Le Christ ne sauve pas. Il montre comment vivre et mourir. En effet, il refuse une anthropologie de la dépendance, qu’il perçoit comme humiliante. Il préfère une morale sans pardon, sans rachat, sans seconde chance transcendante. Or, la démarche salvifique laisserait l’Homme seul face à l’irréversibilité du Mal. La souffrance innocente demeure sans réponse, sinon celle d’une solidarité humaine toujours menacée d’épuisement. Le Christ devient alors un compagnon de route, non un rédempteur.
La question de la Grâce constitue sans doute le point le plus critique du dialogue entre Camus et le christianisme. Camus rejette la Grâce non comme don gratuit, mais comme alibi. La Grâce serait une manière de se décharger de sa responsabilité, de s’en remettre à un Salut immérité au lieu d’assumer jusqu’au bout la tâche humaine. Camus pense à une morale de lucide : aimer sans espérer, lutter sans être sauvé, refuser le meurtre sans garantie ultime. D’un point de vue théologique, cette position inverse radicalement la logique chrétienne. La Grâce n’est plus ce qui libère l’Homme de sa culpabilité et de sa finitude, mais ce qui l’infantilise. Camus rejette la Grâce parce qu’il la perçoit comme une abdication. Elle n’abolit pas la liberté ; elle la rend possible. Être sauvé gratuitement lui semble incompatible avec la dignité humaine qui risquerait d’infantiliser l’Homme et de dissoudre la révolte dans le pardon. Est-il le lieu d’une déresponsabilisation ? Elle est ce qui rend possible l’impossible. Elle n’excuse pas le Mal ; elle ouvre un avenir là où tout semble clos. C’est la différence entre Pierre qui crut à un avenir quand même et toujours possible, et celui de Judas qui n’ayant plus d’espoir et considérant que tout était clos décida de se suicider dans « le Champ du potier » en se pendant à une branche d’un arbre. Elle ne supprime pas la lutte ; elle la soutient lorsque les forces humaines s’épuisent. Le tragique ne sauve personne, pas même le Juste…
Le Christ de Camus : un scandale pour la Théologie
Camus ne se situe pas hors du christianisme, mais sur sa frontière la plus brûlante. Son Christ sans résurrection agit comme un révélateur critique. Il oblige la Théologie à justifier l’espérance pascale face à l’histoire des victimes, et à montrer en quoi la Grâce n’abolit pas la révolte, mais l’accomplit. Une foi sans résurrection est-elle encore chrétienne, et une morale sans Grâce est-elle encore habitable ? Camus répond négativement à la première, mais laisse planer un doute sur la seconde. Son Christ, profondément humain, est peut-être moins une alternative au Christ de la foi qu’un miroir tendu aux chrétiens, les sommant de prouver, par leurs actes, que la Résurrection n’est pas une fuite hors du monde, mais une promesse de justice pour les crucifiés de l’histoire. La fidélité obstinée d’Albert Camus à la figure du Christ oblige la Théologie à sortir de ses positions dogmatiques. Il ne refuse pas la foi, mais toute consolation qui trahirait les victimes de l’Histoire. La Théologie doit accepter la confrontation sur les lieux mêmes de la rupture : la Résurrection, le Salut et la Grâce.
Camus reconnaît dans la Croix un événement de vérité radicale
Le Christ crucifié révèle un Dieu solidaire des humiliés, un Dieu qui ne se tient pas du côté des puissants, mais du côté des victimes. Cette lecture rejoint une intuition centrale de la théologie chrétienne : la Croix n’est pas un accident, mais le cœur de la Révélation. Camus rappelle avec force que toute théologie qui dissocie Dieu de la souffrance humaine devient idéologique. En ce sens, sa critique de l’Église lorsqu’elle bénit la violence ou justifie l’injustice rejoint une exigence prophétique interne au christianisme lui-même. On a pu repérer certaines attitudes non-chrétiennes durant la Guerre civile espagnole, la Seconde Guerre mondiale ; et dans une moindre mesure avec la Guerre d’indépendance en Algérie. Cependant, la Croix, isolée de la Résurrection, demeure une défaite. La Théologie chrétienne ne peut s’arrêter à la simple exemplarité du Christ souffrant sans renoncer à son propre fondement. La Croix seule ne sauve pas. Elle révèle, mais elle n’accomplit pas. La Croix est un passage. Elle est une pâque… Camus accepte que Dieu souffre, mais refuse que Dieu vainque la mort. Et, pourtant n’entend pas le Nouveau Testament nous rappeler au sujet des Fins dernières… « Mort où est ta victoire ? ». Un cri au cœur de la Semaine sainte ? ! ? Or, un Dieu qui souffre sans vaincre reste solidaire, mais impuissant. La foi chrétienne affirme au contraire que la solidarité de Dieu va jusqu’à la transformation du réel. La Croix absolutisée est une Théologie de la défaite. La Croix est séparée de ce qui lui donne sens car pour les chrétiens, elle n’est jamais autosuffisante ; isolée, elle ne révèle pas Dieu. Elle révèle l’échec, et non le Salut. Elle manifeste l’injustice. En absolutisant la Croix, Camus transforme le christianisme en une mystique de la souffrance sans issue. Le Christ devient le modèle des vaincus, et non le vainqueur de la mort. Or, un Dieu qui souffre sans sauver n’est plus le Dieu chrétien. Pour les chrétiens, la Croix sans résurrection est théologiquement nihiliste.
Pour Camus, le Christ n’est pas un Sauveur, mais un modèle
Il ne délivre pas l’Homme du Mal. Il lui apprend à ne pas devenir meurtrier. Le Salut, entendu comme rédemption, est remplacé par une éthique de la fidélité et de la mesure. Cette position a une force morale indéniable. Elle empêche toute déresponsabilisation. Rien n’est pardonné d’avance, rien n’est compensé après coup. Il faut aller plus loin avec le dépôt de la foi, et en ce sens le christianisme ne peut se réduire à une morale, même sublime. Il naît précisément de la confession inverse. L’Homme ne peut pas se sauver lui-même. La sotériologie chrétienne ne nie pas la responsabilité humaine ; elle affirme son insuffisance face à l’ampleur du Mal. Sans salut, la faute demeure irréversible, la blessure sans guérison, et l’histoire sans réconciliation. Le Christ camusien accompagne l’Homme ; le Christ chrétien le relève.
Le Christ de Camus, tel que le révèle Véronique Albanel, n’est pas un faux Christ. Il est un « Christ-frontière »
Il oblige la Théologie à se purifier de toute complaisance envers la violence et de toute espérance désincarnée. Mais il demeure, du point de vue chrétien, un Christ inachevé. La Théologie peut entendre l’objection camusienne sans y céder : sans résurrection, la justice reste protestation ; sans Grâce, l’amour reste héroïsme ; sans Salut, la fidélité reste tragique. Le christianisme ne nie rien de la Croix que Camus honore, mais il affirme que la Croix n’a de sens que si elle ouvre à une vie plus forte que la mort. Il y a sous le rai de la porte que vit Saint Maximilien Kolbe dans sa prison de Pawiak l’espérance d’un Au-delà. Une espérance à vivre dans la Résurrection. La foi chrétienne ose encore l’espérer. Le christianisme n’affirme pas que l’Homme avait seulement besoin d’un modèle, mais besoin d’être libéré. En refusant toute sotériologie, Camus condamne l’Homme à une morale stérile. Le Bien ne triomphe jamais, il résiste seulement. Le Mal n’est jamais vaincu, il est seulement refusé. Cette position est théologiquement désespérée. La foi chrétienne propose une espérance que Camus refuse par principe.
Il vénère le Christ contre le Christ
Il aime en lui ce qui confirme son humanisme et rejette ce qui le conteste. Il accepte un Dieu faible, mais refuse un Dieu vivant. Il honore la Croix, mais refuse qu’elle ouvre un avenir. Le Christ camusien est un Christ neutralisé : inoffensif métaphysiquement, irréprochable moralement, mais incapable de sauver qui que ce soit. Le Christ camusien ne sauve pas. Il inspire. Il témoigne. Il accompagne. Cette réduction du Salut à l’exemplarité morale constitue le cœur de la rupture. Face à lui, la Théologie chrétienne ne peut transiger. Ce qui est en jeu n’est pas une nuance d’interprétation, mais la substance même de la foi. Sans résurrection, la foi est vaine. Sans la Grâce, l’Amour est écrasant, et sans Salut, la justice est tragique. On ne peut pas découper la figure du Christ en éléments isolables, ce qui pose problème sur le plan théologique. Dans la Tradition chrétienne, la Croix et la Résurrection ne sont pas deux éléments séparables mais intimement unis dans le Mystère pascal. Ainsi, l’interprétation camusienne ressemble à une création ex nihilo d’un « Christ sans résurrection », une figure qui, du point de vue chrétien, n’est plus le Christ total. Il préfère une morale d’immanence : une révolte constante sans recours à une espérance métaphysique. Cela fait sens dans la logique camusienne du refus du suicide existentiel : la révolte est digne parce qu’elle est assumée sans promesse d’au-delà. Cependant, on peut contester ce choix philosophique comme une impasse morale, car il renonce à concevoir une notion de rédemption qui dépasse la seule répétition de la résistance au mal. La Théologie chrétienne considère comme un parfait équilibre, en Christ (c’est toute l’Histoire du Salut qui tend vers cela), qu’il faut considère à la fois une « Théologie d’En Bas » et une « Théologie d’En Haut ». Pareillement, on ne peut pas prendre seulement la part de la Patrologie grecque et ne pas aussi intégrer la Patrologie latine. Il y a là un Tout à unifier.
Critique radicale de Camus en direction de l’Église
L’essai met également en lumière la critique virulente que Camus adresse à l’Église lorsqu’elle trahit et se compromet le message du Christ en se compromettant avec les pouvoirs violents. La dénonciation du Franquisme, la peine de mort, la bénédiction des bourreaux deviennent des lieux de rupture où Camus oppose le Christ des prisons au Christ des dévotions imposées. L’auteure montre que cette critique ne procède pas d’une hostilité superficielle, mais d’une fidélité paradoxale à l’exigence christique elle-même. Le livre insiste sur le cœur de la pensée camusienne : le refus absolu du meurtre. Camus rejette la Grâce et le Salut, mais il radicalise la responsabilité humaine. L’amour, la solidarité, la compassion deviennent des impératifs sans garantie métaphysique. L’auteure parle d’une « mystique sans Dieu » ancrée dans l’Histoire et tournée vers les victimes.
Camus refuse la Transcendance parce qu’il craint que l’Espérance d’un Au-delà ne relativise l’urgence de la justice ici-bas. On peut se demander si une éthique radicale sans espérance n’est pas, en fin de compte, une morale tragique sans promesse effective, qui risque d’appauvrir la figure du Christ plutôt que de l’approfondir. L’ouvrage montre que Camus rejette explicitement la Grâce et le Salut dans leurs sens traditionnels. Véronique Albanel restitue ce rejet sans toujours en montrer les implications philosophiques et existentielles : si l’on refuse la grâce, quelle place reste-t-il pour le pardon, la réconciliation et la restauration humaine ? L’argument est décrit, mais les conséquences ne sont pas entièrement explorées. Peut-être manquerait-il à cet ouvrage une articulation théologique entre les éléments de la foi explicitée dans le Credo. Au terme de la lecture, on pourrait craindre de faire du philosophe un théologien sans qu’il le soit réellement présentant une figure de Christ qui n’a rien à voir avec le Christ de la Foi. Le Christ qu’il vénère n’est pas, au sens strict, le Christ du christianisme. Il s’agit d’un Christ amputé de sa résurrection, donc privé de toute puissance sotériologique, réduit à une figure morale et tragique.
Le livre est nécessaire pour quiconque souhaite comprendre comment Albert Camus a pensé la figure du Christ hors des catégories dogmatiques habituelles. C’est une lecture riche pour les philosophes, les historiens des idées et les lecteurs sensibles aux enjeux éthiques du XXᵉ siècle. Du point de vue de la théologie chrétienne, l’ouvrage reste une reconstruction intéressante. Le livre de Véronique Albanel est plus une étude herméneutique qu’une réconciliation entre Camus et la foi chrétienne. Il ouvre une nouvelle fenêtre de compréhension. Albert Camus reste d’une grande actualité, et il semble qu’il revienne en force… pour notre plus grand bonheur.