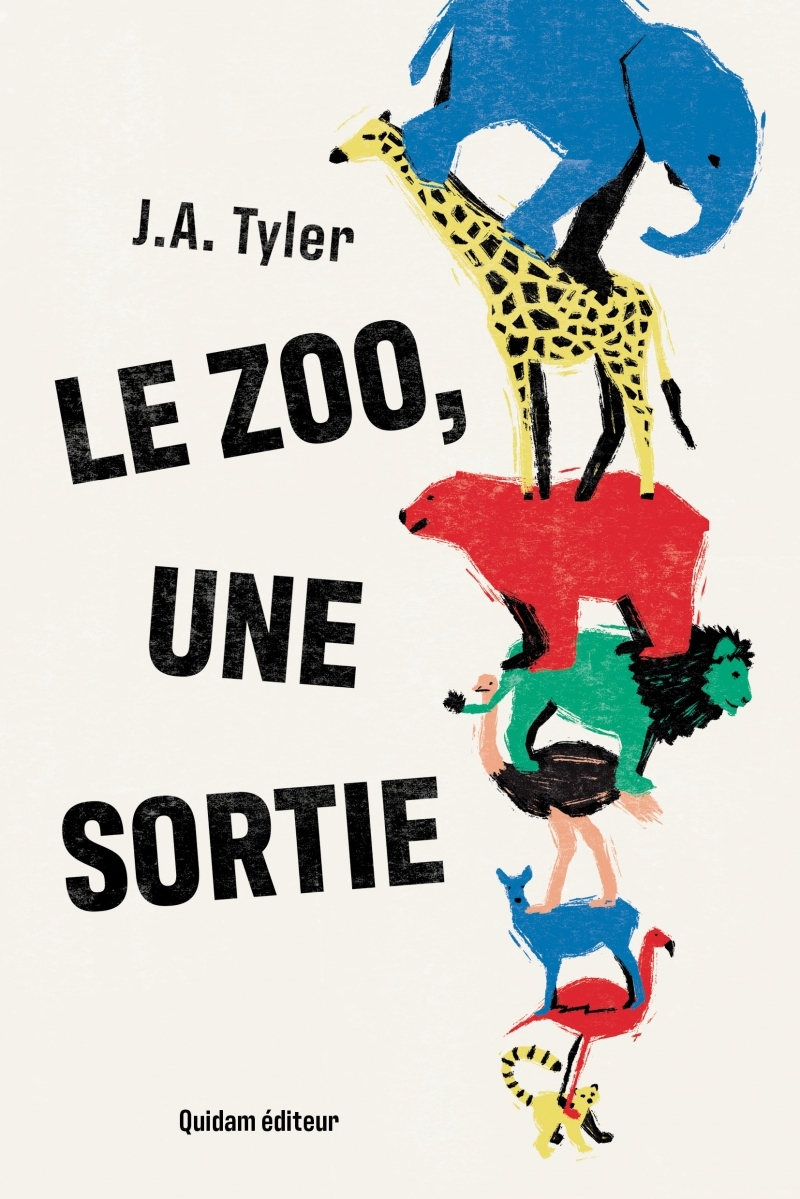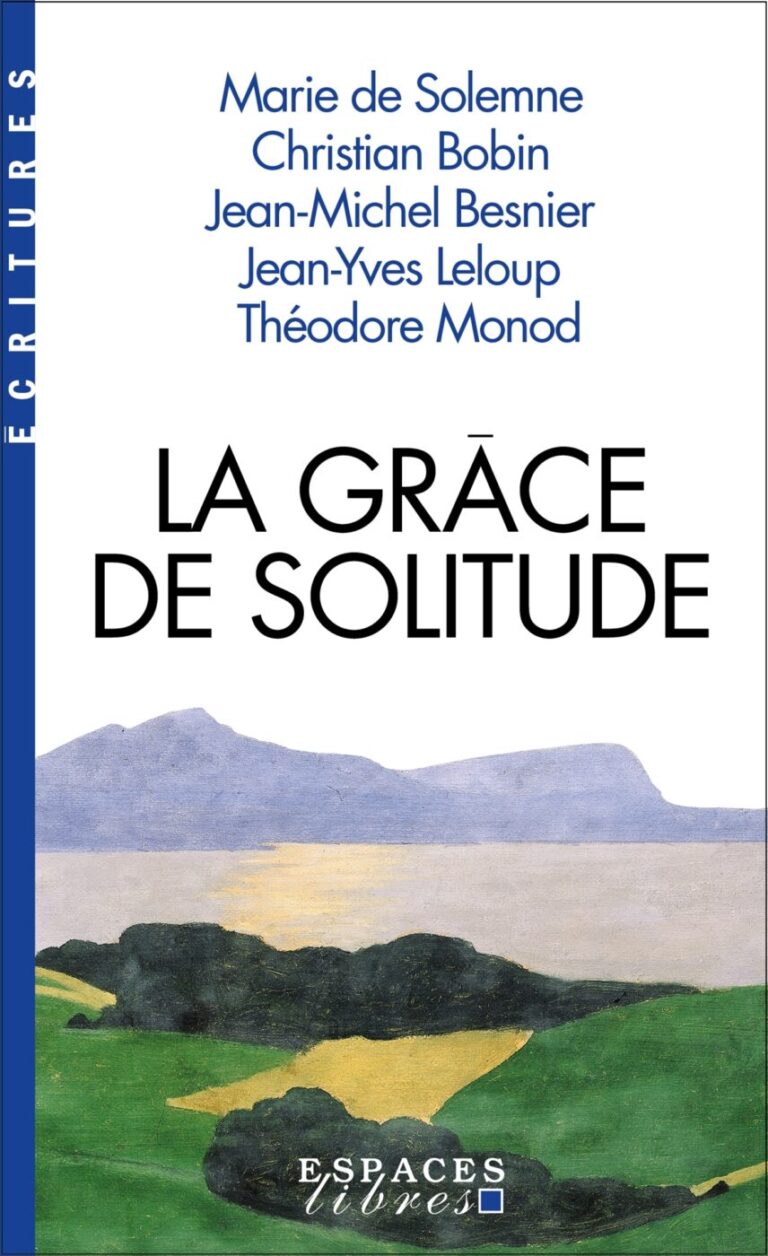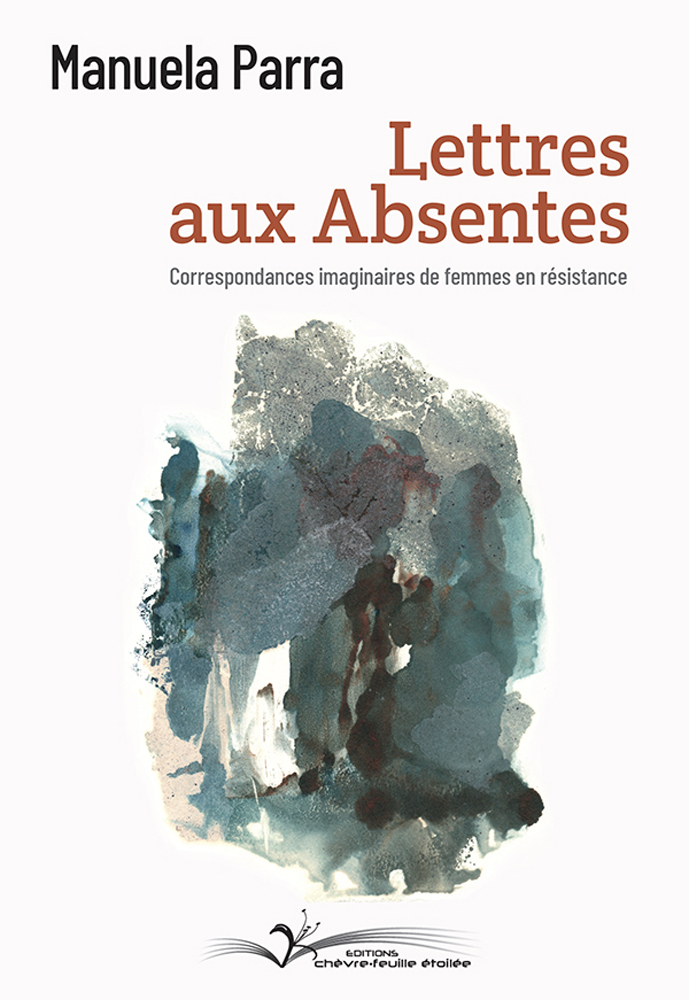J.A. Tyler, Le Zoo, une sortie, traduction de l’anglais par Stéphane Vanderhaegue, Quidam éditeur, 09/01/2026, 200 pages, 20 €
Une famille ordinaire : un père, une mère, leur fils unique Jonah. Une sortie banale : le zoo municipal par une journée ensoleillée. Pourtant, dès les premiers barreaux, dès le premier enclos, quelque chose craque sous la surface. Derrière chaque animal observé affleurent les fractures d’un foyer aux abois, les peurs d’un enfant qui apprend à déchiffrer la violence comme d’autres déchiffrent l’alphabet. J.A. Tyler transforme cette promenade familiale en cartographie de l’innommable.
La syntaxe de l'effroi
Le Zoo, une sortie s’ouvre sur les lions. Jonah pose ses mains sur les barreaux, observe le bâillement du fauve, cette gueule capable de tout avaler. “Jonah, il pourrait t’avaler si tu fais pas gaffe” lance le père, et déjà le lecteur perçoit dans cette phrase anodine l’amorce d’un mécanisme de terreur. J.A. Tyler construit son roman en chapitres-animaux où chaque enclos devient prétexte à la remontée d’un souvenir, d’une menace, d’une violence sourde. Le muntjac fait affleurer une mémoire familiale trouble, le tigre fait dévier la sortie vers une inquiétude plus noire, le renard arctique invisible réfléchit une absence qui hante la maison. Ces glissements narratifs, d’apparence désordonnés, tissent la logique mentale d’un enfant qui ne cesse d’associer le présent immédiat aux terreurs familières.
La voix de Jonah porte le roman tout entier. J.A. Tyler capte le débit mental d’un enfant de sept ou huit ans, ses phrases qui rebondissent, hésitent, reviennent sur elles-mêmes. “Je fais ça des fois quand papa il parle. J’utilise la paume de mes mains que je colle dessus et comme ça j’entends plus rien.” Cette syntaxe heurtée, ces répétitions, ces approximations grammaticales ancrent le lecteur dans la conscience enfantine, dans ce flux où se mêlent observation immédiate et réminiscence traumatique. Les loutres qui bougent sans cesse réfractent l’agitation que la mère attribue à Jonah, alors même que l’enfant se fige dans le silence pour survivre. L’aigle aux ailes rognées qui tente de s’envoler et retombe cristallise l’impossibilité de s’échapper.
Au fil de la déambulation, le portrait du père se précise par touches successives, accumulation de fragments qui composent peu à peu la figure d’un homme ravagé. Ses explosions verbales ponctuent chaque page : “Ce putain de ballon va te fendre le visage en deux”, “Mais bon sang arrête de tripoter ton col”, “Putain qu’est-ce que tu racontes, toi ?”. La violence du père toxique demeure psychologique, verbale, mais elle sature l’espace familial jusqu’à l’asphyxie. Il ne frappe pas, il menace. Il évoque les os qui peuvent se briser comme les branches d’un arbre, le ballon qui pourrait fendre un visage en deux, les dents du lion capables d’avaler un enfant. Ces prophéties d’accidents transforment le monde en piège permanent.
Jonah apprend à décoder les humeurs paternelles comme un animal reconnaît les signes avant-coureurs du danger. Devant les otaries qui tournent en rond, l’enfant observe comment son père fait exactement la même chose dans leur maison minuscule, tournant en boucles furieuses avec ses mots qui “viennent se coincer dans mes oreilles même quand je me les bouche“. La chevalière que le père fait tourner sur son doigt, bleu puis argenté, bleu puis argenté, devient le symbole de cette circularité sans issue. La mère apparaît en creux, silencieuse, impuissante. Elle tente parfois de protéger Jonah d’un regard ou d’un “Bon sang”, mais ces interventions demeurent timides, inefficaces. Quand elle observe son mari, elle le regarde “comme si elle le voyait pas, comme s’il y avait toujours quelque chose derrière lui, plus loin”, comme si elle cherchait déjà une sortie impossible.
Bestiaire des cages invisibles
Plus la visite avance, plus les souvenirs remontent. Le puma caché dans l’herbe évoque une photographie où un fauve invisible guettait un enfant et sa mère sur un sentier de montagne. “Il y a des choses qui sont cachées, c’est ça que je vois. Même quand j’ai envie d’oublier.” Cette phrase résume le projet du roman : montrer comment le trauma demeure tapi derrière chaque apparence normale. Les serpents verts camouflés dans les feuilles en plastique, les crocodiles dont seuls les yeux émergent de l’eau pour regarder “là où ma maman elle dit que se trouve mon cœur”, les chauves-souris suspendues dans le noir artificiel : chaque animal cristallise une modalité de la peur.
Le zoo lui-même devient métaphore de l’enfermement familial. Les animaux tournent en cage, les parents tournent en rond dans leur maison trop petite, Jonah tourne en boucle dans ses terreurs nocturnes. Les barreaux qui séparent les visiteurs des fauves séparent aussi l’enfant de toute possibilité d’échapper à son environnement. Les flamants roses debout sur une seule patte cristallisent cet équilibre précaire, cette fatigue accumulée sans espoir de repos. “Moi si j’étais fatigué, je me tiendrai pas sur une seule jambe. Ça rendrait cette jambe encore plus fatiguée, et donc il faudrait changer de jambe”.
La traduction de Stéphane Vanderhaeghe est excellente. Rendre la voix enfantine en français sans tomber dans l’affect ou la caricature relève de l’exploit. Le traducteur préserve les maladresses syntaxiques, les répétitions, les hésitations qui font la vérité de cette parole, tout en maintenant une lisibilité qui permet au lecteur de ne jamais décrocher. Les dialogues des parents, émaillés de jurons et de phrases inachevées, sonnent juste dans leur brutalité quotidienne. Cette langue orale, cette syntaxe brisée deviennent le vecteur même du trauma : le langage porte les cicatrices.
J.A. Tyler publie avec Quidam Éditeur, maison qui défend une littérature exigeante. Après Mariette Navarro, Justine Arnal ou Erwan Larher, l’éditeur poursuit sa ligne éditoriale : donner voix à des écritures qui prennent des risques formels pour sonder les zones obscures de l’expérience humaine. Ce roman de J.A. Tyler révèle un écrivain capable de transformer un matériau narratif minimal en lecture qui saisit à la gorge. Sans effets spectaculaires, sans pathos démonstratif, il sonde les mécanismes de la violence ordinaire et ses répercussions dans la psyché enfantine. La structure en chapitres-animaux impose sa logique implacable : chaque enclos devient un miroir où se reflète une facette de l’horreur familiale. Au terme de cette sortie au zoo, le lecteur ressort avec la certitude que certaines cages n’ont pas de barreaux visibles, et que les plus redoutables sont précisément celles qu’on habite sans pouvoir les nommer.