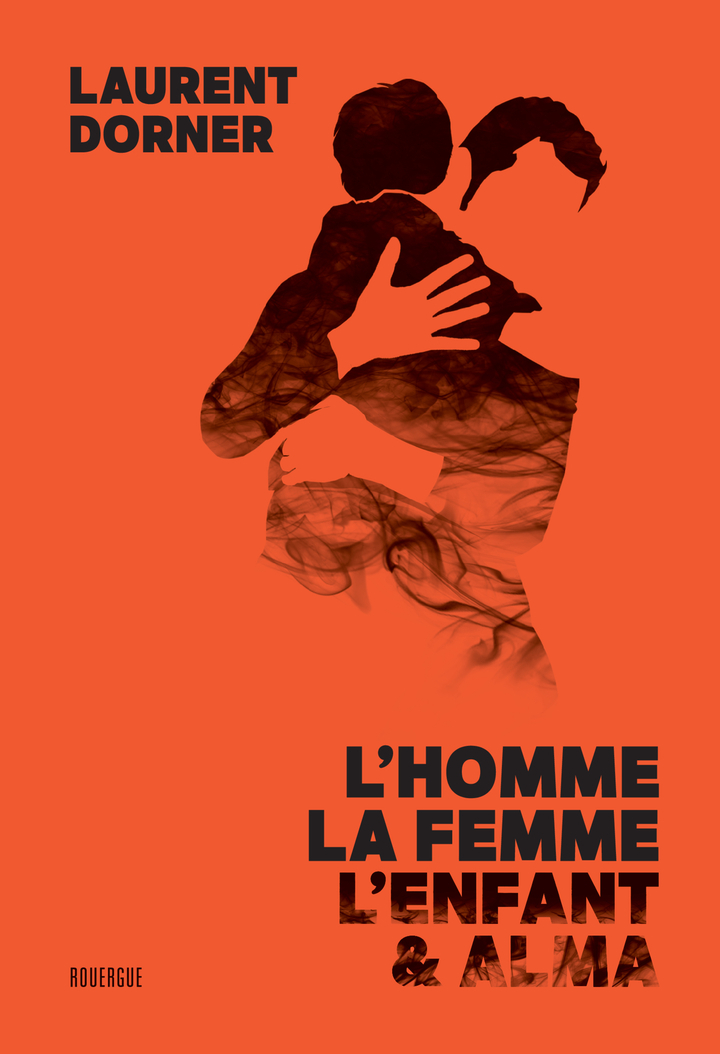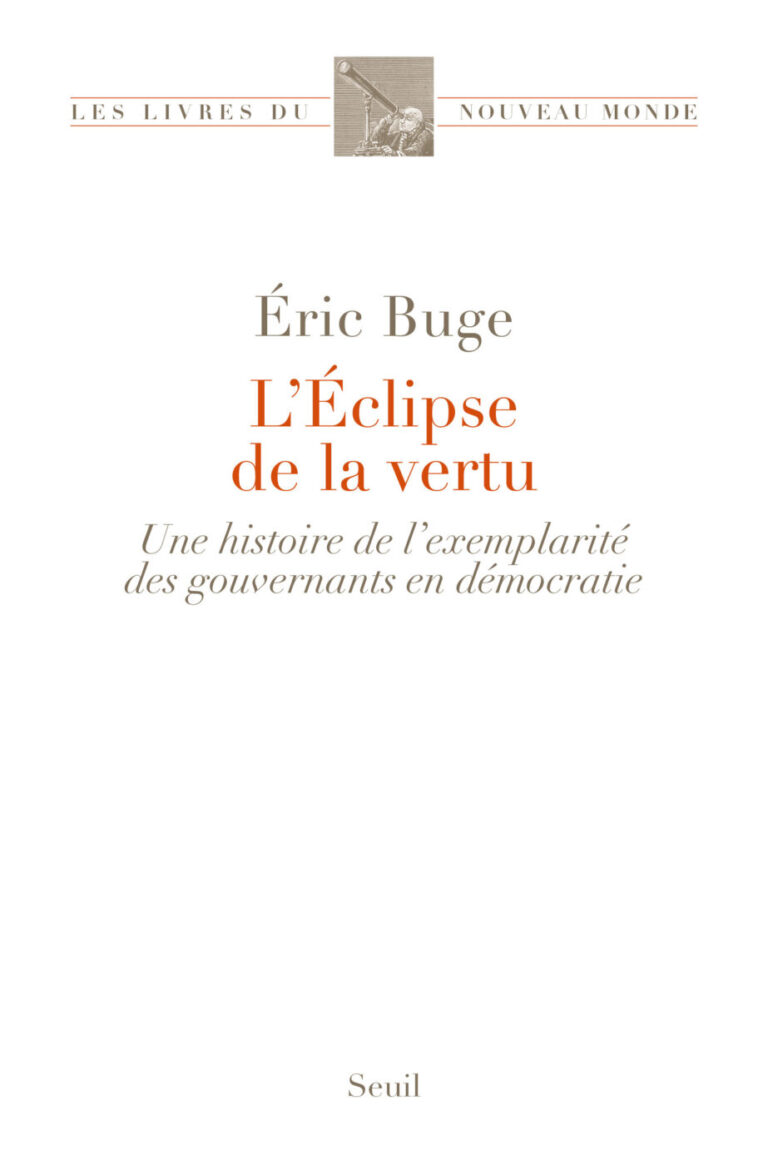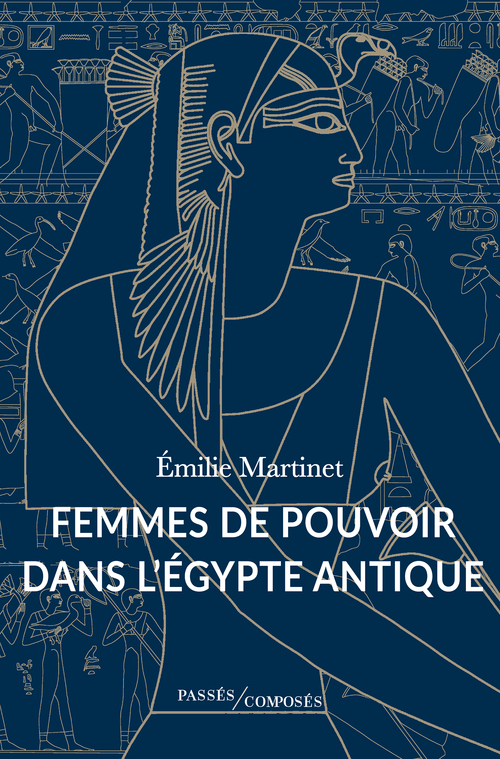Justine Arnal, Rêve d’une pomme acide, Quidam éditeur, 22/08/2025, 228 pages, 20€
Découvrez notre Podcast sur cet ouvrage
Avec Rêve d’une pomme acide, Justine Arnal livre un récit vertigineux, intime et polyphonique, où les voix de femmes blessées s’entrelacent dans la langue rugueuse de la mémoire familiale. Héritière d’une lignée de femmes alourdies par les silences, les larmes et les non-dits, l’autrice tisse une fresque troublante, portée par une écriture incantatoire et des images puissantes. Ce livre n’est pas un récit du deuil : c’est une plongée dans les eaux troubles de ce qui précède le désastre, et de ce qui le survit.
Chronique d’un foyer ordinaire
Le roman s’ouvre sur une scène inaugurale en trompe-l’œil, celle d’une fin de journée d’été accablante où « les corps ont gonflé ; partout, les gestes s’égarent, les têtes s’oublient ». Tout semble ordinaire : une mère, Élisabeth, lave la vaisselle, un père, Éric, s’apprête à regarder un match de football décisif, et trois sœurs s’effacent déjà derrière les murs de leurs chambres. Mais cette banalité est un leurre, un vernis craquelé sous lequel couvent les frustrations et l’ennui. Chaque détail anodin est chargé d’une tension sourde qui annonce l’effondrement à venir, préparant le lecteur à comprendre que le drame n’est pas l’exception, mais la conséquence logique de ce quotidien asphyxiant.
Dans ce décor, les personnages apparaissent d’abord comme des archétypes : Élisabeth est la femme au foyer dont les désirs s’éteignent dans l’eau de vaisselle ; Éric, le patriarche obsédé par le contrôle et les « couilles en or » des footballeurs, incapable de voir la détresse qui l’entoure. Les trois sœurs, observatrices muettes de ce naufrage, incarnent chacune à leur manière les stades de la blessure et de la lucidité. Pourtant, Justine Arnal les rend irréductibles à ces schémas. Elle leur insuffle une vie intérieure complexe, faite de rêves fugaces, de révoltes silencieuses et de perceptions aiguës, qui transforme le drame familial en une tragédie intime et universelle.
Le titre lui-même agit comme une clé symbolique. La « pomme » renvoie à l’enfance, au jardin, mais aussi au fruit défendu, à la connaissance et à la chute. Son « acide » est la saveur de l’amertume, la morsure du désenchantement qui traverse les générations de femmes. Enfin, le « rêve » désigne autant l’évasion onirique que la dissolution des frontières entre le réel, le souvenir et le fantasme. Ce titre polysémique contient toute la densité du roman : un récit sur la perte de l’innocence, où le féminin est une saveur à la fois vitale et douloureuse.
Le chœur brisé des femmes
Rêve d’une pomme acide progresse moins par son intrigue que par la manière dont les voix narratives s’enchevêtrent. Le récit éclate les perspectives : la narration à la troisième personne qui sonde l’esprit d’Élisabeth alterne avec la voix d’une narratrice, l’aînée des sœurs, qui tente de reconstituer le puzzle de sa mémoire. Ce chœur de voix féminines est régulièrement coupé par des fragments poétiques ou des dialogues énigmatiques, créant une structure qui mime le fonctionnement du souvenir, avec ses ellipses, ses retours en arrière et ses fulgurances.
Des motifs récurrents irriguent le texte, devenant des métaphores obsédantes. Le bac à sable de l’enfance, où les jeux finissent par creuser jusqu’au vide, devient le portail vers une réalité autre, inquiétante et magique. Les patates, corvée culinaire de la grand-mère, symbolisent le poids de la lignée, le devoir de nourrir qui s’épuise dans la répétition. Les géraniums, détestés par la mère, incarnent une certaine laideur provinciale, un ordre factice contre lequel son désir de beauté se heurte. À travers cette mémoire des objets, la romancière révèle la puissance poétique du quotidien le plus trivial.
Tisser un récit de fragments et d’échos
Cette narration dialogique s’étend au-delà des personnages pour converser avec une constellation de figures littéraires et philosophiques. Les citations qui ouvrent chaque partie ne sont pas des ornements, mais des fondations thématiques. En convoquant Alejandra Pizarnik et sa vision de l’écriture comme reconstruction d’un corps en ruines (« Écrire c’est chercher dans le tumulte des brûlés l’os du bras qui pourrait correspondre à l’os de la jambe »), Justine Arnal inscrit d’emblée son texte dans une poétique de la réparation. De même, la voix de Marguerite Duras, omniprésente en esprit, ancre le roman dans une exploration de la mémoire et de l’absence. Le combat d’Audre Lorde contre les « anciens fantômes de toi qui sont des silhouettes de moi » éclaire la lutte de la narratrice pour se définir face au spectre de sa mère. La présence du jeûneur de Kafka vient souligner l’aliénation et la grève silencieuse au cœur de ce foyer, tandis que Patricia Janody justifie la structure onirique et vacillante du souvenir, où l’on ne se réveille « jamais complètement ». Ces voix tutélaires forment une sororité intellectuelle et spirituelle qui guide le lecteur, offrant des clés d’interprétation et confirmant que ce drame intime s’inscrit dans une longue histoire de la parole empêchée.
Le style de l’œuvre reflète cette complexité. L’autrice emploie une forme kaléidoscopique où se mêlent des fragments d’autofiction, de longues séquences narratives, des listes – comme les sujets de l’émission Aujourd’hui Madame – et des poèmes en vers libres. Cette hybridité stylistique empêche le lecteur de s’installer dans une lecture confortable, le forçant à rester actif, à chercher du sens dans les interstices du texte. La forme épouse son sujet : raconter une histoire fragmentée par le deuil et le silence.
Tisser un récit de fragments et d’échos
Plus qu’un énième roman familial, ce livre tisse ce que l’on pourrait appeler une « petite mythologie » du foyer contemporain. C’est un conte cruel sur l’échec d’un certain modèle familial, où la maison, loin d’être un refuge, se révèle une prison où les désirs sont méthodiquement étouffés. Justine Arnal interroge ce qui fait tenir – et ce qui fait imploser – la cellule familiale lorsque les non-dits et le refoulement deviennent la principale règle du jeu.
Le texte propose également une relecture féministe puissante du récit de filiation. Il ne s’agit pas seulement de raconter le destin d’une mère, mais de comprendre comment sa douleur se transmet, comment ses filles deviennent les héritières d’une loyauté invisible à la souffrance. Le travail de la narratrice consiste précisément à rompre ce pacte silencieux, à trouver un langage pour dire ce qui a été tu et, peut-être, à inventer une autre manière d’être femme, sœur et fille. La langue littéraire devient alors un outil d’émancipation.
In fine, Rêve d’une pomme acide est une œuvre ouverte, qui résiste à toute interprétation univoque. Naviguant entre le réalisme d’un drame domestique et la poésie d’un rêve éveillé, le livre plonge son lecteur dans un état de suspension fertile. Il le laisse avec des questions qui résonnent longtemps après la dernière page : Qu’est-ce qu’un héritage ? Comment se libérer des fantômes familiaux sans les renier ? Et comment faire parler le silence, pour que la vie, enfin, recommence ?