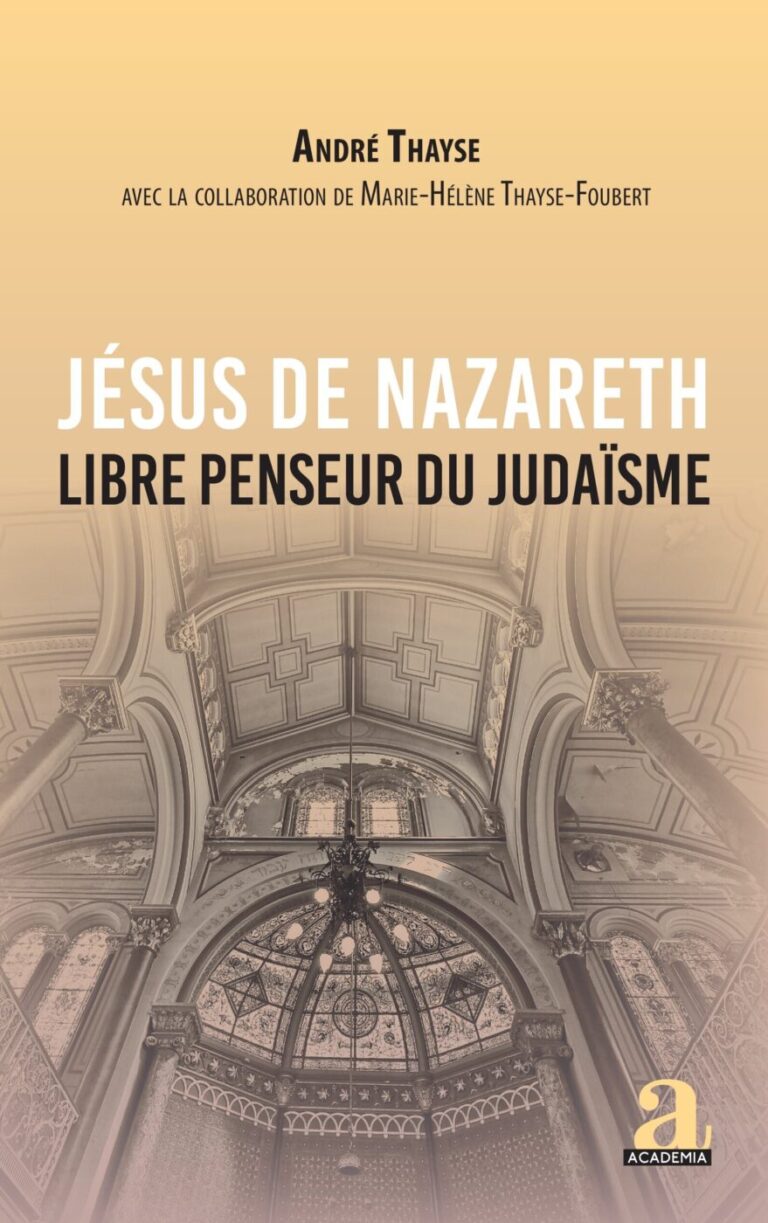Vanessa de Senarclens, La Bibliothèque retrouvée. Une enquête, Éditions Zoé, 28/08/2025, 256 pages, 20 €
Seize tiroirs de fiches cartonnées, 16 000 cotes soigneusement rédigées au crayon gris, et plus un seul livre au bout. Quand Vanessa de Senarclens, universitaire genevoise mariée au dernier fils d’une famille de la noblesse poméranienne, ouvre les cartons oubliés dans le hangar de son beau-frère, elle découvre le fantôme d’une bibliothèque fondée en 1750 par un chambellan de Frédéric II, dispersée une nuit de mars 1945 sous les obus soviétiques. De ce catalogue orphelin, elle tire une enquête à travers cinq pays et deux siècles et demi de silence : celle des héritiers qui n’ont jamais voulu parler, celle d’une province où l’antisémitisme fit ses ravages avant même la guerre, celle des livres eux-mêmes, qui refont surface là où personne ne les attendait.
L’étrangère, le deuil empêché et le travail d’archive
Ce qui frappe d’emblée, c’est la franchise avec laquelle Vanessa de Senarclens assume son extériorité. Genevoise, issue d’un pays “resté notoirement spectateur des catastrophes du vingtième siècle”, mariée au plus jeune des trois fils de Ferdinand von Bismarck-Osten, elle entre dans cette histoire par la marge. Sa belle-famille cultive un rapport paradoxal à la mémoire : Ferdinand, revenu d’un camp de prisonniers soviétique en 1948, avait tu le passé poméranien dans un silence que la conscience de la faillite allemande rendait moralement nécessaire ; “pour rien au monde, il n’aurait voulu être associé aux discours revanchistes”. Fritz, l’aîné, héritier légitime selon le droit de primogéniture, laisse les cartons de Plathe dormir dix ans entre une tondeuse et deux vélos rouillés. L’oncle Hannibal débarque avec deux pies mortes et une carabine à côté de la théière. Les stores se baissent au moment du Carnaval rhénan. Vanessa de Senarclens compose avec ces détails un tableau d’exilés qui ont transplanté leurs mœurs sans reconstituer leur monde, ni solder les comptes de leur classe avec l’histoire.
Cette extériorité confère à la narratrice une liberté méthodologique que le livre revendique. L’enquête se heurte aux archives disséminées entre la Pologne, la Russie, l’Allemagne, Yad Vashem ; aux fonds de la Gestapo poméranienne, captifs à Moscou et “plus que jamais inaccessibles depuis la guerre contre l’Ukraine” ; au système des Bundesarchiv, baptisé “Invenio” alors qu’il semble “conçu pour décourager l’utilisateur”. Vanessa de Senarclens fait de ces obstacles la matière même de son récit, à la manière de W. G. Sebald dont l’ombre plane sur ces pages : la recherche n’aboutit jamais tout à fait, le document manque, le témoin est mort. Ce n’est pas un défaut ; c’est la condition de toute restitution honnête.
Fonder, transmettre, détruire
Le fondateur de la bibliothèque, Friedrich Wilhelm von der Osten, chambellan de Frédéric II, transplante à Plathe l’esprit des Lumières berlinoises après quatre années à la cour de Potsdam. Une tabatière en or, transmise de génération en génération avec des “gestes solennels et des paroles chuchotées”, fournit le premier indice. La narratrice la soumet à l’expertise d’un historien de l’art dans la cafétéria de la Staatsbibliothek, “autour d’un mauvais plat du jour engouffré sans y prêter attention” : raccourci temporel vertigineux entre le rococo frédéricien et le prosaïsme d’une cantine berlinoise. Vanessa de Senarclens sonde ensuite quatre générations d’héritiers qui conservent la bibliothèque sans la lire : August rêve de fabrique de sucre, Carl estampille les volumes d’un tampon à l’encre bleue jugé “consternant de laideur”. “À la manière d’un tubercule enfoui sous un sol gelé en hiver, la bibliothèque résiste”, perchée en haut de l’escalier, traversée par le seul bruit d’une vrillette forant son tunnel dans le papier.
C’est Karl von Bismarck-Osten qui reprend le flambeau au début du vingtième siècle : aile construite en 1910, catalogue systématique, “œuvre de sa vie”. Mais Vanessa de Senarclens pose aussi, avec une rigueur salutaire, la question de ce que Karl n’a pas vu, ou pas voulu voir. Tandis qu’il complétait ses fiches bibliographiques sur la guerre de Trente Ans, le Gauleiter Schwede-Coburg faisait de la Poméranie la première province “judenfrei” du Reich. En 1933, les groupuscules SA défilaient dans la rue principale pour terroriser les seize Juifs de Plathe ; le gouvernement appelait au boycott des deux commerces de Siegmund Arndt et Walter Hirsch. En 1942, les 6 317 Juifs de Poméranie avaient tous disparu : “exilés, déportés, assassinés”. Karl, “sombre et parfaitement lucide” selon sa voisine Barbara von Thadden, captait la BBC en secret et savait que “la guerre était inévitable parce qu’Hitler la voulait absolument”. Mais qu’a-t-il fait de ce savoir ? “À quoi lui ont servi tous ses livres dans l’épreuve de la dictature ?”, demande Vanessa de Senarclens, qui laisse la question ouverte avec une probité intellectuelle d’autant plus appréciable qu’elle écrit depuis l’intérieur de cette famille.
Violences, résurgences, restitutions
Le livre ne voile rien de la brutalité qui suit l’effondrement. Vanessa de Senarclens restitue l’avancée soviétique en s’appuyant sur le journal de Käthe von Normann : pillages systématiques, exécutions sommaires, viols quotidiens couverts par l’euphémisme de “traitements honteux”. “Komm, Frau” revient en boucle “comme la formule maléfique d’un conte cruel”. Ernst et Ellen von Zitzewitz, dont les noms figurent sur le plat en argenterie des noces de Karl, sont exécutés le 16 mars 1945, leurs corps exposés à l’entrée de leur domaine. Hélène von Thadden, restée sur place jusqu’en 1947, recense 182 morts pour la seule année 1945, dont 61 enfants. Vanessa de Senarclens déploie un sens de l’équilibre qui refuse la complaisance victimaire comme l’euphémisation : elle rappelle que la commission ayant documenté les expulsions fut taxée de projet réactionnaire, “mais c’est trop simple”.
Face à cette destruction, les résurgences d’objets acquièrent une force singulière. Un psautier luthérien revient de Suède, trente ans après le pillage, accompagné d’une lettre d’excuses. Des chemises cartonnées surgissent sous un linoléum de Leipzig. Les Mémoires de Frédéric II refont surface dans un “Café Bonjour” d’autoroute, quand les petits-enfants de Karl et ceux du capitaine A. se retrouvent autour d’un livre en cuir rouge, soixante-dix ans après. Karl, qui comptait les années depuis le 3 mars 1945 et écrivait en 1951 que ses descendants seraient “pauvres et à jamais apatrides”, n’aura pas vu la numérisation de son catalogue en 2014, ni les expositions polonaises autour de ces livres “post-allemands”, ni la visite de son petit-fils Matthias à la bibliothèque universitaire de Lodz en 2022, où la bibliothécaire avait disposé au centre d’une salle interdite au public sa photographie de 1944 parmi ses livres. “Le passé se terre dans les interstices les plus improbables”, écrit Vanessa de Senarclens, “il peut être empêché, il peut être tu, ramené à presque rien, mais il finit par refaire surface.” Son enquête en administre la preuve, en ne dissociant jamais la beauté de ce qui persiste de la lucidité sur ce qui a rendu la perte possible.
Les bibliothèques meurent d’indifférence
Vanessa de Senarclens signe avec La Bibliothèque retrouvée un livre qui invente sa propre forme. L’universitaire y apporte la rigueur de ses recherches, la patience de qui a traqué des cotes dans cinq pays, reconstitué des généalogies à partir de fiches au crayon gris ; l’écrivaine plie cette érudition à une narration qui sait ralentir sur un détail (la vrillette dans le papier, le gong annonçant le déjeuner) et accélérer quand l’Histoire fait irruption. Vanessa de Senarclens prouve qu’il est possible d’écrire sur la perte d’un monde aristocratique sans nostalgie de classe, sur la destruction allemande sans complaisance victimaire, sur les Lumières sans hagiographie. Elle interroge les silences de sa propre belle-famille avec la tendresse de celle qui comprend et la fermeté de celle qui refuse l’oubli. C’est un livre profondément européen, hanté par les frontières redessinées et les noms de villes que Google Maps ne retrouve plus ; un livre qui rappelle que les bibliothèques ne meurent pas quand on brûle leurs livres, mais quand personne ne cherche à savoir ce qu’ils contenaient.