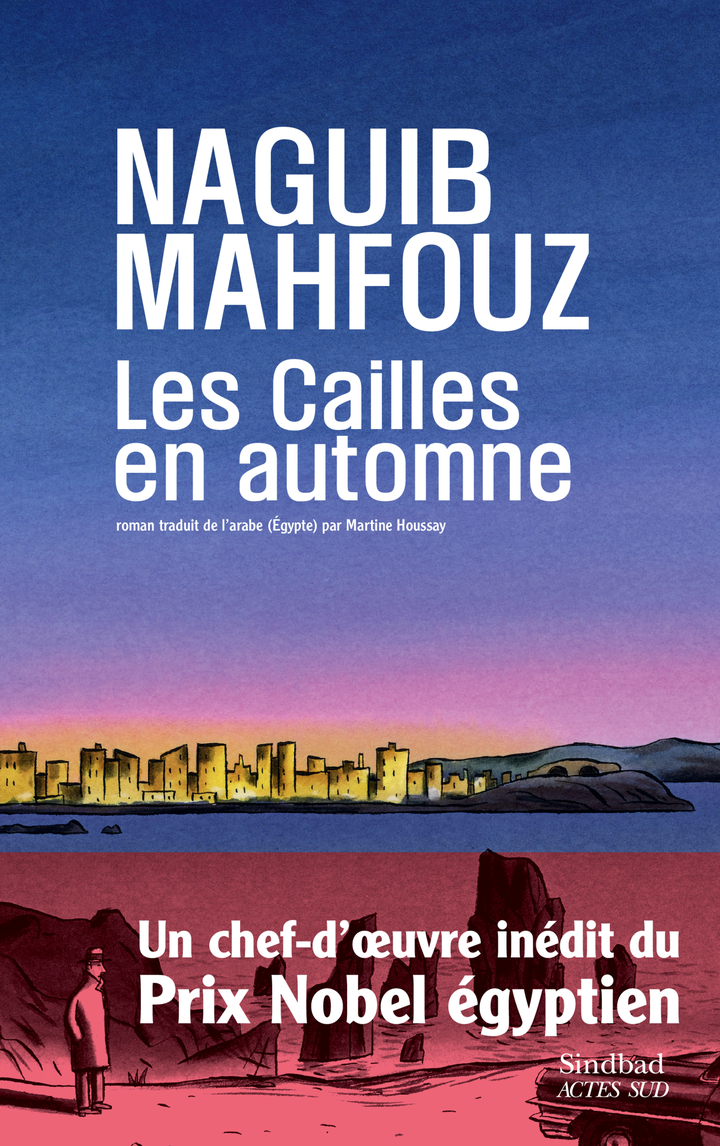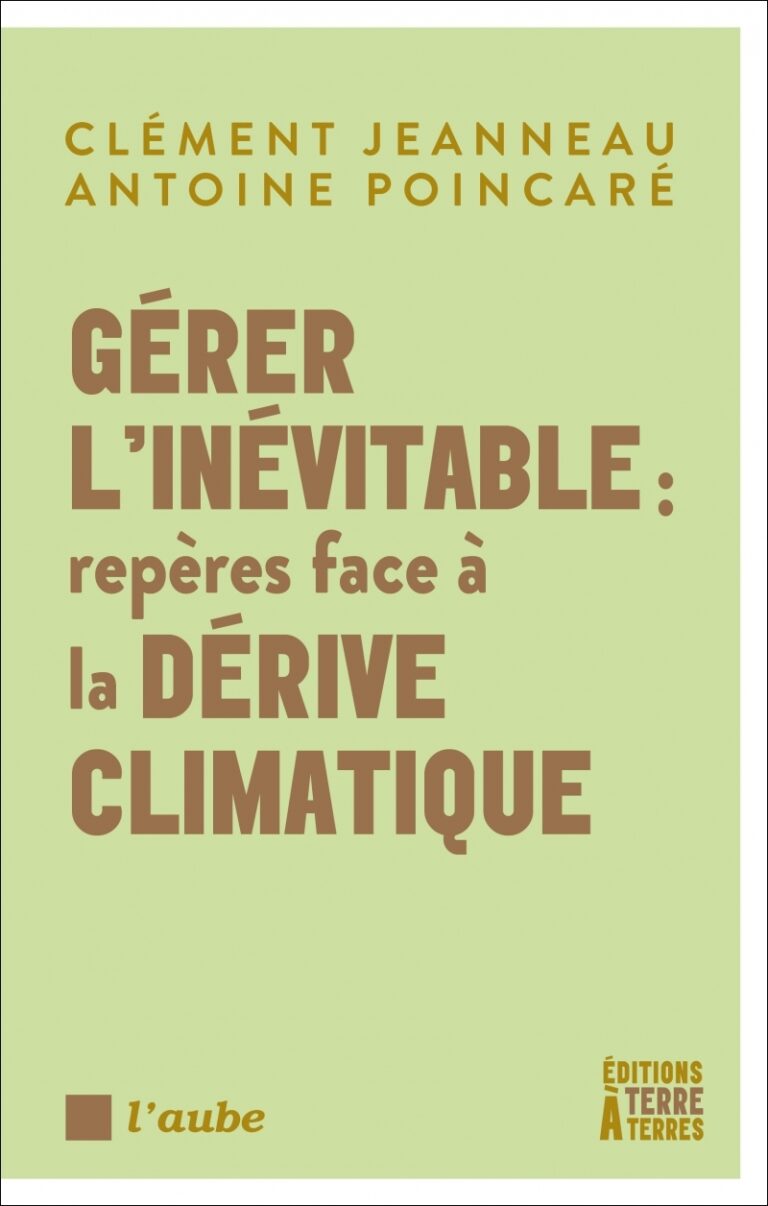Alain Cluzet, Les villes face au populisme. La bataille culturelle est engagée, Éditions de l’Aube et Terre à Terres, 09/01 2026, 200 pages, 19€
Quarante mille normes ISO, 300 millions de dépressifs recensés par l’OMS, un manque de nature qui pèse pour 40 % dans le malaise psychique des Français selon Santé Publique France : Alain Cluzet, docteur en urbanisme et ancien directeur général des services de grandes collectivités territoriales, déploie dans cet essai dense les fils entremêlés d’une crise que le populisme révèle sans la résoudre. Son pari : la ville, organisme vivant, peut encore fabriquer du commun là où la modernité a semé la fragmentation.
Ruine de l’âme, naufrage du commun
Le populisme, soutient Alain Cluzet dès les premières pages, n’est “juste le thermomètre, une réaction de repli compulsif, de désarroi face à la perte de repères, à la violence des mutations et à la ségrégation ainsi engendrées par la modernité”. Symptôme, et non cause. La pathologie, il l’identifie dans les promesses trahies d’un projet moderne qui a substitué l’uniformisation à l’universalisme, l’individualisme consumériste à la liberté émancipatrice, la toute-puissance technologique à la raison critique. Le progrès continu, cette eschatologie laïque héritée des Lumières, s’est fracassé sur les charniers du vingtième siècle ; Alain Cluzet convoque Rabelais (“Science sans conscience n’est que ruine de l’âme”) et Thomas Hobbes (“l’homme est un loup pour l’homme”) pour rappeler que les penseurs les plus lucides avaient pressenti cette autodestruction. L’essai engage un dialogue serré avec Hartmut Rosa : Alain Cluzet reprend à son compte l’idée que “la tentative de maîtrise totale du monde est une folie”, et prolonge le diagnostic vers la postmodernité. Là où d’autres célébraient la déconstruction comme un affranchissement, Alain Cluzet décèle un nihilisme qui, en abolissant tout héritage culturel, a livré des millions d’individus à ce qu’il nomme l’“auto-construction” identitaire : une identité bâtie sur le vide, incapable de se projeter dans un récit collectif. Le philosophe Günther Anders avait résumé la mécanique intime de cette déshérence : “Je hais, donc je suis quelqu’un.” Formule glaçante que Ginette Kolinka, rescapée des camps, complète d’un avertissement sans appel : “La haine, c’est déjà un pied à Auschwitz.”
Le monde aplati, la terre dévastée
Le deuxième temps de l’essai arpente les territoires dévastés par la convergence de la technologie, de la globalisation et de la destruction du vivant. Alain Cluzet rappelle que Meta affiche 400 % de marge bénéficiaire pour 60 milliards de dollars de profit net en 2024, que les normes ISO croissent au rythme de 30 % par an, que les données mondiales seront multipliées par vingt d’ici 2030. L’accumulation chiffrée, vertigineuse, traduit le sentiment d’emballement que l’auteur rend palpable page après page. Bill Joy, dès l’an 2000, condensait l’angoisse en une formule : “Why the future doesn’t need us.” Alain Cluzet la prend au sérieux sans verser dans la technophobie ; il distingue les usages émancipateurs des dispositifs de contrôle social, citant Singapour et ses robots patrouilleurs, Shenzhen et sa reconnaissance faciale, le projet avorté de Google City à Toronto, 80 hectares truffés de capteurs où le citoyen devenait cobaye.
La singularité de l’essai réside dans l’articulation, encore trop rare dans la littérature sur le populisme, entre fracture sociale et fracture écologique. Alain Cluzet convoque Claude Lévi-Strauss pour rappeler que “les hotspots de biodiversité sont aussi ceux où la diversité culturelle est la plus riche”, et qu’une destruction entraîne l’autre. Il souligne que la “perte de repères bioculturels est un facteur de fragilité aussi considérable qu’ignoré”, s’appuyant sur les données de Santé Publique France qui mesurent à quarante pour cent la part du manque de nature dans le malaise psychique. Le sprawl, l’étalement urbain planétaire, dévore les espaces préservés. Jérôme Fourquet, après avoir longuement analysé la composante des votes depuis trente ans, fournit à Alain Cluzet des chiffres accablants : le vote pour le Rassemblement national représente 11 % chez les plus diplômés mais 36 % chez les moins diplômés aux ressources plus modestes. Vincent Jarousseau, qui a passé dix ans “à la rencontre de la France qui vote RN”, confirme l’ancrage territorial de cette fracture : c’est dans les périphéries reléguées, dénaturées, privées de médiations culturelles, que le populisme recrute avec le plus de vigueur.
Où l’air de la ville rend libre
Le troisième mouvement porte la proposition. Alain Cluzet oppose au repli identitaire et à la fuite en avant technologique un concept forgé avec patience : la ville symbiotique. Le terme, emprunté à la biologie, désigne une association où chaque organisme conserve son identité tout en tirant bénéfice de la relation. “La ville est un organisme vivant, pas un support neutre sur lequel expérimenter sans contrôle”, écrit Alain Cluzet, récusant la smart city techniciste (“simple réceptacle des principales innovations dont nous devenons les simples testeurs”) autant que la ville-marchandise livrée aux investisseurs, dont Venise, vidée de ses habitants par le tourisme de masse, fournit l’exemple le plus douloureux. La symbiose, ici, ne concerne pas seulement les rapports entre cultures ou entre technique et société ; elle engage un rapport au vivant. Alain Cluzet prolonge Michel Serres, dont le Contrat naturel de 1990 proposait de refonder nos obligations envers la nature, et le déplace vers ce qu’il appelle un “contrat citadin” : la ville comme lieu où se négocie, concrètement, l’équilibre entre densité urbaine et présence du vivant, entre performance économique et lenteur du lien.
Pour Alain Cluzet, la ville comme bien commun s’ancre dans la pensée d’Elinor Ostrom, prix Nobel d’économie, qui a démontré la légitimité de l’action collective face aux défaillances conjuguées du marché et de l’État. Alain Cluzet mobilise Marcel Mauss pour affirmer que “la ville est un fait social total”, et c’est la dimension culturelle qui constitue le cœur de la bataille annoncée par le sous-titre. Le péril, à ses yeux, réside moins dans le choc des civilisations que dans ce qu’il nomme le “choc des incultures” : l’absence de toute culture à laquelle se référer, le vide où s’engouffrent la peur et la haine. La créolisation chère à Édouard Glissant, métissage lent mûri sur cinq siècles dans les Caraïbes, ne saurait être transposée à des flux migratoires accélérés ; Alain Cluzet lui préfère la symbiose, qui exige le temps long de l’échange et la fabrication patiente de repères partagés. L’essai invite, dans une formule empruntée à Richard Sennett, à “embrasser la lenteur, les incohérences et l’hétérogénéité”, contre la logique de performance qui écrase le délibératif.
Paraphrasant Max Weber, Alain Cluzet conclut que “l’air de la ville doit continuer à rendre libre”. Par l’ampleur de sa vision (philosophie, technologie, écologie, urbanisme, culture), la précision de ses analyses territoriales et la richesse de ses références internationales (NEOM, Dubaï, Séoul, Toronto, Venise), Alain Cluzet écrit l’essai qu’un urbaniste praticien adresse à une époque qui a dissocié ce qu’elle aurait dû conjuguer : la raison et le sensible, le local et le global, la culture et la nature, l’urgence d’agir et la patience de comprendre. Un livre qui ose penser la ville comme l’espace concret où pourrait se recoudre, fil à fil, le tissu déchiré de nos sociétés.