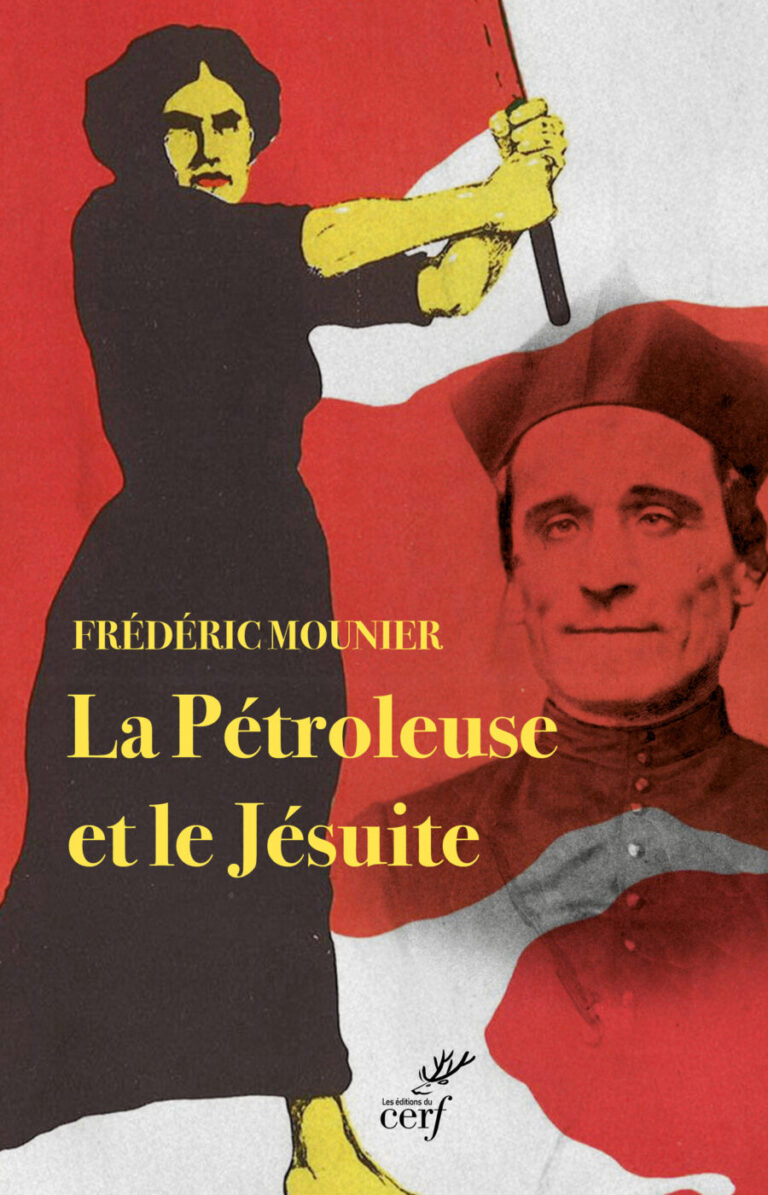Chimamanda Ngozi Adichie, L’inventaire des rêves, Gallimard, 27/03/2025, 656 pages, 26 €
Dans ce roman aux allures de confession croisée, Chimamanda Ngozi Adichie livre quatre récits qui s’imbriquent sans se confondre. L’inventaire des rêves est le journal de quatre femmes d’orgine africaine abîmées, fières, lucides, qui affrontent l’exil intime autant que géographique. Quatre récits, quatre angles sur les rêves déçus, les silences maternels, les corps meurtris. Et peut-être, une tentative d’écrire une réconciliation avec soi. C’est dans le silence d’une maison américaine, soudain trop vaste sous le poids du confinement mondial, que naît cette interrogation sublime de simplicité qui innerve tout le roman : être connue, enfin, pour ce que l’on est. Une quête de reconnaissance qui se déploie comme un fil d’or à travers la polyphonie des voix de Chiamaka, Zikora, et Kadiatou, ces héroïnes dont les destins convergent vers ce point névralgique où la vulnérabilité devient une force créatrice.
Des fantômes et des femmes
Chimamanda Ngozi Adichie orchestre une fresque où l’intime révèle le tumulte du monde. Chia, la narratrice principale dont le récit encadre les autres, est cette intellectuelle et voyageuse issue d’un milieu nigérian aisé. Le confinement pandémique devient pour elle le creuset d’une introspection féroce. La stase forcée l’oblige à dresser cet inventaire des amours avortés, des ambitions déviées, des maternités différées. Ses désirs inassouvis deviennent les fantômes qui peuplent son quotidien suspendu. C’est par son regard, empreint d’une mélancolie lumineuse, que nous découvrons les autres femmes. Zikora, son amie, brillante avocate dont l’armure professionnelle craquelle sous le poids de l’horloge biologique ; et Kadiatou, sa « femme de chambre » guinéenne, dont la dignité silencieuse abrite des blessures d’une violence insoupçonnée. L’auteure ne dépeint pas des figures archétypales, mais des femmes traversées par des contradictions vivifiantes : elles sont fortes et brisées, drôles et tragiques, pétries de désirs et paralysées par leurs peurs. Des femmes terriblement humaines.
Le roman d’un corps exposé
L’art de la romancière réside dans le tissage subtil des narrations, où chaque histoire éclaire les autres par un jeu de miroirs saisissant. Les ruptures amoureuses, que ce soit celle de Chia avec l’intellectuel toxique Darnell ou l’amant éphémère et marié, ne sont pas de menues péripéties. Elles sont des lieux d’analyse de la construction identitaire, de la performance du désir et de la violence des attentes sociales. L’écriture de Chimamanda Ngozi Adichie explore ici une mémoire corporelle, celle des blessures qui s’inscrivent dans la chair autant que dans l’esprit. Ce même corps qui devient le théâtre d’une épreuve initiatique pour Zikora. La scène de son accouchement, d’une crudité et d’une puissance magnifiques, incarne la solitude ontologique de la femme face à la douleur. La froideur du corps médical, la brutalité des mots — « Vous ne progressez pas » — face à la tempête organique qui la dévaste, tout cela est restitué avec une économie de moyens qui en décuple la force.
Dire Nafissatou Diallo, écrire la honte
Le récit de Kadiatou, quant à lui, forme le cœur politique du roman. Inspiré de l’affaire Nafissatou Diallo, son histoire dépasse le fait divers pour toucher à l’universel. L’agression sexuelle dont elle est victime est le catalyseur qui libère une voix trop longtemps tue. Chimamanda Ngozi Adichie nous offre un portrait d’une dignité bouleversante. Celui d’une femme migrante, mère, dont le combat pour la justice la confronte aux silences de son propre passé. L’injustice qu’elle subit active une honte paradoxale, celle que ressentent si souvent les victimes. La romancière la formule avec une acuité poignante : « Il n’avait rien fait de mal, c’était à elle qu’on avait fait du mal, et pourtant elle ressentait de la honte comme si en elle l’ordre des choses avait été profondément bouleversé ». Sa trajectoire devient une allégorie de la résilience, une manière de dire que la survie est, en soi, une forme de victoire. Entre ces quatre femmes se dessine une sororité implicite, non pas faite de grandes déclarations, mais tissée de douleurs partagées, de regards complices et de silences éloquents.
Du silence des mères à la parole des femmes
L’inventaire des rêves est un roman dont les résonances multiples invitent à une méditation sur la condition féminine à l’ère du capitalisme mondialisé. Que signifie, pour une femme, réussir sa vie aujourd’hui ? Faut-il choisir entre la carrière et la maternité, entre l’amour et l’autonomie, entre le silence protecteur et la parole qui libère mais expose ? Chimamanda Ngozi Adichie explore ces dilemmes avec une férocité douce, sans jamais céder au pathos ou au discours militant. Sa force est dans le dévoilement, dans l’art de rendre le politique à travers les pulsations de l’intime. Son écriture, toute en ruptures de ton, passe de l’humour mordant des conversations familiales à la douleur sourde des solitudes, et c’est dans cette oscillation que réside sa vérité. On pense à la sociologie sensible d’Annie Ernaux pour cette façon de sonder la mémoire individuelle comme un symptôme du collectif. On pense à Rachel Cusk pour la construction du moi par l’écho des autres. On songe aussi à Saidiya Hartman et sa notion de « fabulation critique », cette manière de peupler les vides de l’archive pour redonner une vie et une complexité à celles que l’Histoire a réduites au silence. Chaque femme de ce roman est une archive vivante, porteuse de ses propres silences et des histoires non racontées des générations qui l’ont précédée.
À travers la quête de Chia, Chimamanda Ngozi Adichie interroge le rôle même de l’écrivain. Peut-on inventer une fin à une histoire qui n’est pas la sienne ? Peut-on, par la fiction, réparer une injustice ? Le roman laisse ces questions en suspens, préférant l’incertitude fertile du questionnement à l’assurance stérile des réponses. « Mais, au bout du compte, à quelle aune mesure-t-on ce genre de choses, et comment saurais-je si j’y suis parvenue ? » se demande Chia. C’est là toute la beauté de ce livre : une invitation à accepter que nos inventaires personnels, qu’ils soient de rêves, d’amours ou de regrets, sont toujours, et heureusement, incomplets. Ils sont la matière même de la vie qui continue, fragile, obstinée, magnifique.