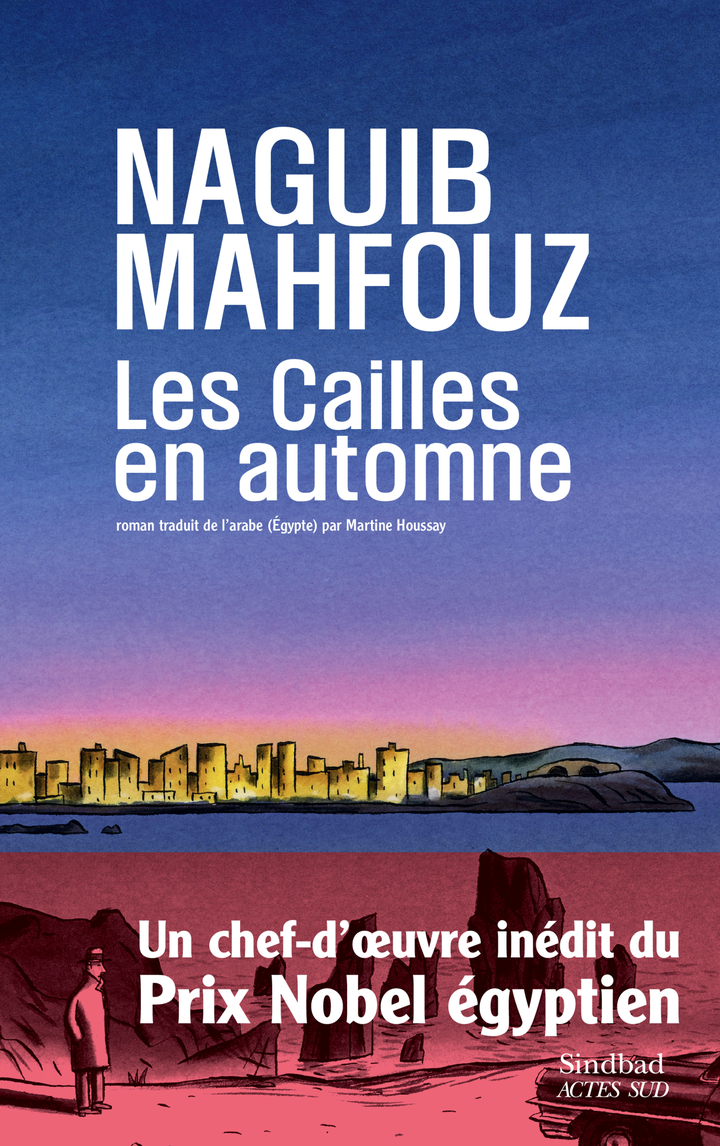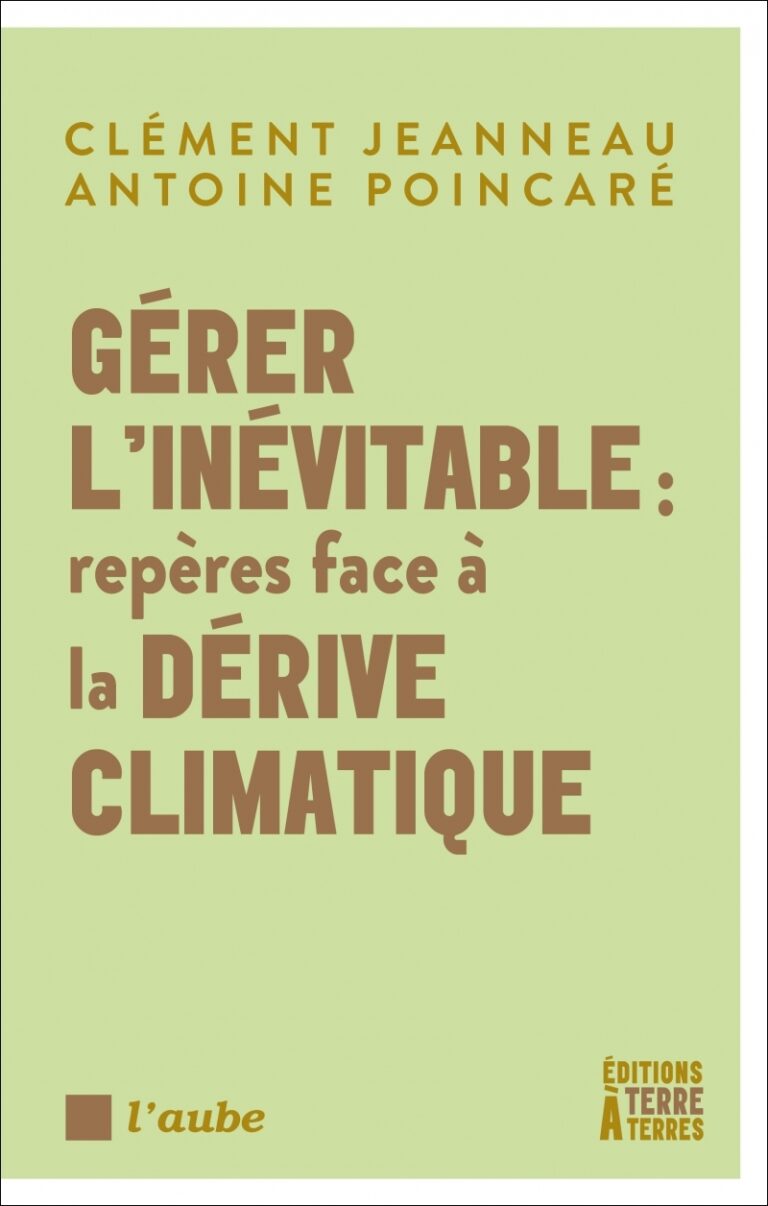Aliyeh Ataei, La frontière des oubliés : récits, traduit du persan par Sabrina Nouri, préface d’Atiq Rahimi, Gallimard, 13/04/2023, 1 vol. (148 p.), 18€
Si ses racines sont afghanes, sa nationalité est iranienne. Aliyeh Ataei est née à Darmian, région du Khorasan du sud en Iran qui jouxte la province de Farah en Afghanistan. Et son clan familial vivait des deux côtés de la frontière.
Aujourd’hui, après des études à l’université d’art de Téhéran, c’est dans cette ville qu’elle réside et a construit sa vie. Elle est nouvelliste pour des journaux anglais, poétesse, romancière, scénariste. Et c’est en persan qu’elle a écrit cinq romans, salués par la critique, couronnée de nombreux prix, tout particulièrement Eye of the dog, paru en 2019.
Nous devons à Sabrina Nouri cette belle traduction pour les éditions Gallimard de Koorsorkhi, paru en 2021.
En devenant La frontière des oubliés, le titre souligne d’abord, l’existence d’une réalité politique. Une ligne sur une carte a suffi à isoler deux pays, là où, jadis, un même peuple parlait une langue, le persan, partageait une riche culture, une religion et des traditions identiques.
Il souligne aussi une réalité humaine, dans ces zones frontalières où vivent des êtres forcément victimes, puisque déchirés dans leur identité, abandonnés, ailleurs, à une forme d’hostilité raciste ou laminés chez eux, par des décennies de guerre et d’occupation étrangère.
Sept récits constituent La frontière des oubliés. Tous sont doublement datés à l’aide des calendriers persan et occidental. Et leur agencement chronologique permet de reconstituer en une sorte de puzzle de la vie de l’auteure entre 1986 et 2017. À travers des épisodes déterminants, nous la suivons de l’enfance à son actuel statut d’écrivaine, d’épouse et de mère.
Parallèlement, ils permettent de suivre les soubresauts d’une histoire dramatique dont nous nous contentons depuis un demi-siècle de constater les dégâts.
Sept récits très personnels puisque tous sont ancrés aux souvenirs de l’auteure. Le plus intime étant le tout premier, où elle fait le récit de la maladie d’un père très aimé et prématurément perdu. Cet afghan, résident iranien, s’était engagé lors de la guerre contre l’Irak. Il revint de l’armée avec des troubles neurologiques qui affectèrent profondément sa vie et l’existence de sa famille.
Mais les sept récits mettent surtout en scène des femmes, exposées à la répression, à la barbarie ambiante mais aussi à des châtiments coutumiers ou à des haines de voisinage.
Et elles prennent vie pour le lecteur :
Mahboubeth, méprisée par sa belle-mère, décapitée, car soupçonnée de communisme par les partisans du commandant Massoud. Anar amputée de sa langue par les Talibans pour avoir voulu apprendre l’anglais à des enfants afghans. La tante Safia, marquée au tisonnier par son mari qui la rend responsable de la mort de leur fils. Malalaï, agressée avec l’auteure, dans une avenue de Téhéran, pour avoir revendiqué son identité afghane…
L’écriture de Aliyeh Ataei a une beauté formelle, âpre, incisive, sans concessions. Elle déroule les faits, lucide, sans pathos dans un constat d’une insupportable brutalité.
Si le mal est venu d’ingérences étrangères, il est aussi, pour le peuple afghan, une gangrène intérieure, qu’on peut voir exprimée de façon métaphorique par les rats ou les scorpions, tapis et dangereux.
Sa mission d’écrivain dans La frontière des oubliés, comme dans ses œuvres précédentes, est de porter témoignage au nom d’un peuple, de cette violence qui fait fi de tous les droits humains, qui marque indélébilement les corps, infléchit les vies, condamne à l’exil et renvoie à la question de sa propre identité.
Atiq Rahimi, écrivain et réalisateur, prix Goncourt 2008 pour Pierre de patience, a accordé une magnifique préface au livre d’Aliyeh Ataei.
Tous deux ont les mêmes origines. Ils connaissent l’exil au seuil d’un monde qui ne les reconnaît plus et partagent ce désir de le mettre en récit en interpellant les consciences. Ainsi exprimait-il sa propre quête dans La balade du calame parue en 2015 :
Mon pays a sombré dans la terreur de la guerre, dans l’obscurantisme, et, là-bas, j’ai perdu les clefs de mes songes, de ma liberté, de mon identité… Aussi l’ai-je quitté en espérant retrouver mes clefs, là où il y a de la lumière, de la liberté, de la dignité, tout en sachant que je ne les retrouverai jamais. Toute création en exil est la recherche permanente de ces clefs perdues.