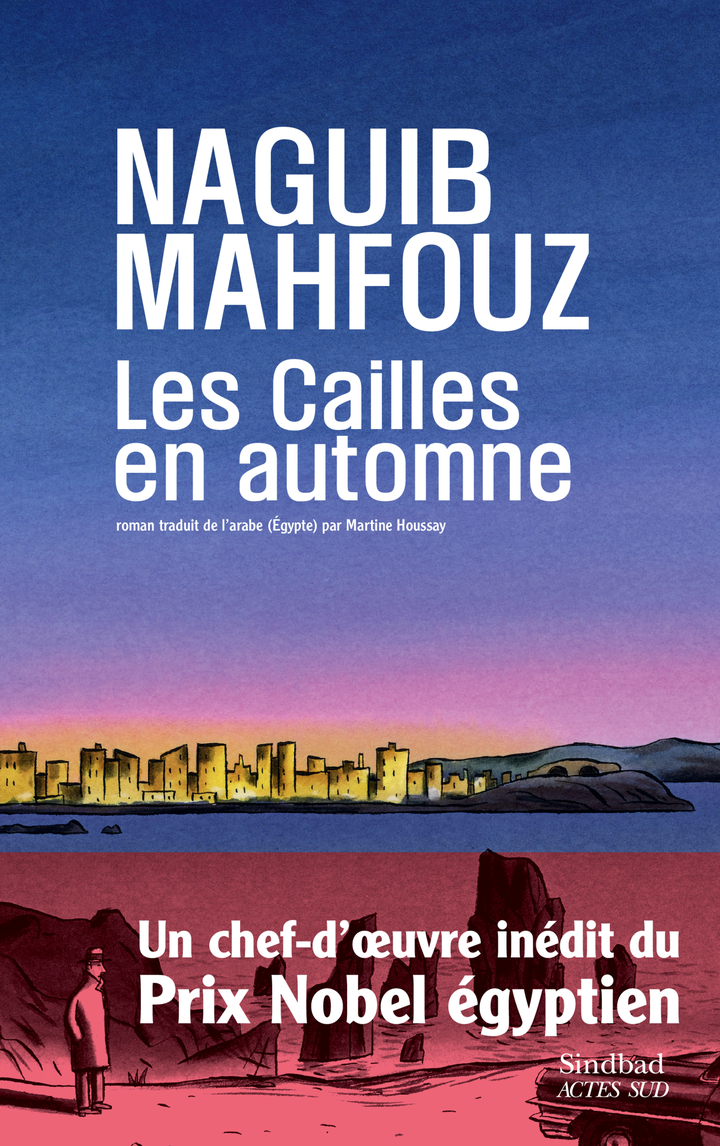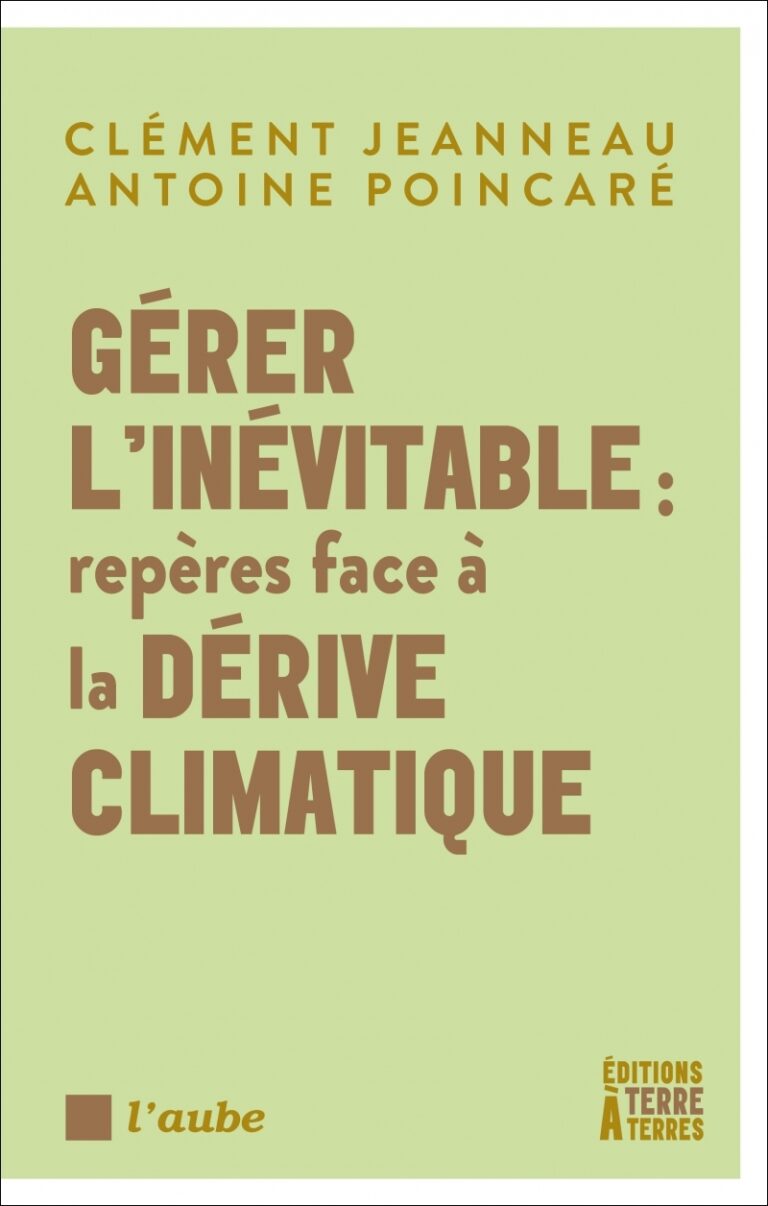Anne Savelli, Bruits, Actes Sud, collection Inculte, 07/01/2026, 384 pages, 23,50€
On ouvre Bruits comme on entrouvre une porte sur une ville déjà lancée à pleine vitesse. Il fait encore sombre, mais tout est en mouvement. Des pas qui martèlent les cages d’escalier, des sirènes qui découpent l’air, des voix qui s’interpellent, des machines qui ronronnent, des écrans qui crachent des informations contradictoires. Ici, le bruit n’est pas un décor. C’est une force, presque une matière, qui colle aux murs et s’infiltre partout, jusqu’à devenir le véritable moteur du récit.
Anne Savelli a imaginé un roman qui avance minute après minute, avec une précision presque vertigineuse. Cette contrainte n’a rien d’un gadget : elle fait ressentir, dans le corps du lecteur, la pression du temps contemporain. Tout se joue dans l’urgence, dans l’anticipation, dans la peur d’être en retard, d’être vu, d’être rattrapé. On n’a pas le confort des grandes ellipses, on n’a pas l’espace pour souffler. On est dans le flux, comme dans ces journées où l’on court sans savoir exactement vers quoi, et où l’on finit par confondre activité et nécessité.
Au cœur de cette mécanique, il y a une figure d’élan. Une enfant s’arrache au point de départ et se met à courir, non pas comme on fuit un simple danger, mais comme si le mouvement était la seule façon de rester vivante. Le roman ose un déplacement étrange, presque fantastique : plus elle avance, plus elle se transforme. Pas besoin d’en dire davantage pour sentir ce qu’Anne Savelli cherche. Cette course n’est pas une performance héroïque, c’est une traversée fragile. La ville n’est pas un terrain de jeu, c’est une zone d’exposition, un espace où les regards, les menaces, les règles tacites pèsent sur les corps. On apprend avec elle à décoder les signes, à lire les rues, à comprendre comment l’espace public distribue ses permissions et ses pièges.
Face à cette énergie, une autre présence offre un contrechamp saisissant : une femme immobilisée dans un lieu de soins, attentive à tout, poreuse au monde. Elle capte le vacarme comme une antenne. Autour d’elle, on entend les phrases administratives, les décisions prises à distance, les arrangements pratiques qui disent beaucoup de la manière dont nos institutions gèrent la fatigue, la vulnérabilité et le manque de moyens. Ce personnage devient un point d’écoute, un lieu intérieur où le bruit extérieur se transforme en images, en souvenirs, en dérives. Là encore, la romancière évite la facilité : ce n’est pas une figure symbolique plaquée, c’est un organisme sensible qui réagit à ce qu’on lui impose.
Bruits est aussi un roman du travail, et c’est là qu’il surprend par sa justesse. Une galerie de gens souvent invisibles traverse ces pages : employés de caisse, agents d’entretien, petites mains qui font tenir le décor pendant que la ville se raconte une autre histoire. Le texte s’approche des gestes répétés, des corps qui encaissent, de la dignité bricolée au milieu du bruit et des injonctions. On ressent la tension entre l’efficacité demandée et la vie réelle, celle qui déborde toujours. Et l’un des lieux les plus marquants du livre incarne cette tension : un établissement qui change d’identité selon l’heure, selon les usages, selon les clients, comme si les murs eux-mêmes devenaient interchangeables. Le même endroit peut être refuge, scène, piège, arrière-boutique, vitrine. Cette instabilité dit quelque chose de notre époque : la ville se reconfigure sans cesse, et ceux qui y travaillent doivent s’y adapter en permanence.
Ce qui rend le roman particulièrement vivant, c’est sa manière de faire entendre plusieurs registres à la fois. Il y a la vitesse, la peur, l’ironie, le quotidien, la rumeur. Les informations circulent mal, se contredisent, se gonflent, se déforment. On croit savoir, puis on découvre que tout était approximation. Anne Savelli compose une polyphonie où la vérité n’arrive jamais seule : elle est parasitée, saturée, contestée. Ce choix n’a rien de gratuit. Il rend palpable la manière dont nos vies sont traversées par des récits concurrents, et comment le vacarme sert parfois à couvrir ce qu’on ne veut pas entendre.
On pourrait croire qu’un dispositif aussi strict rendrait le livre froid ou mécanique. C’est l’inverse. Bruits est très conscient de sa fabrication, comme si l’autrice laissait affleurer, par endroits, l’atelier derrière la scène. Cela ajoute une dimension ludique et tendue à la fois : le roman s’observe en train de se construire, avec ses règles, ses risques, ses collisions de voix. Et c’est précisément ce mélange de rigueur et de sensibilité qui emporte.
Sans livrer de conclusion toute faite, Bruits laisse une impression rare : celle d’avoir traversé un espace sonore, social et mental où chaque vibration compte. C’est un livre qui ne cherche pas à rassurer, mais à faire sentir. Un livre qui rend le silence désirable parce qu’il montre à qui il manque le plus. Et quand on le referme, on écoute autrement la ville autour de soi, avec un peu plus de lucidité, et peut-être aussi un peu plus de colère.