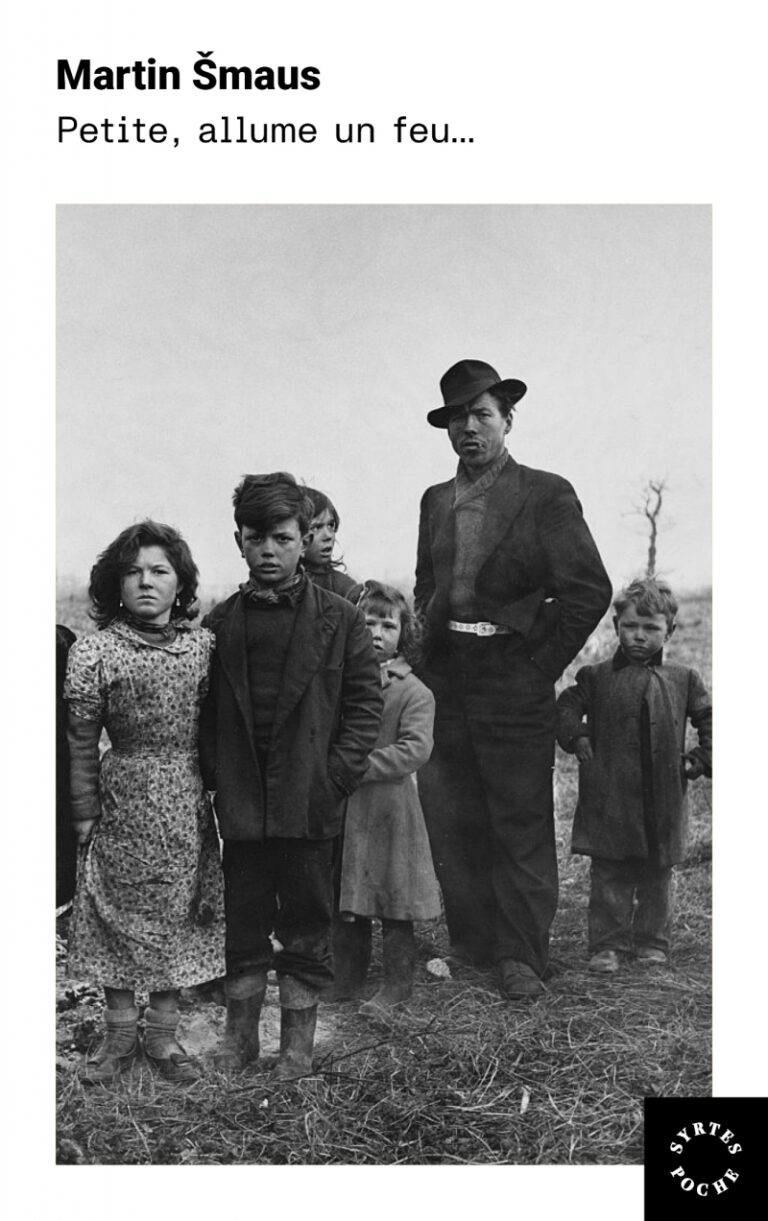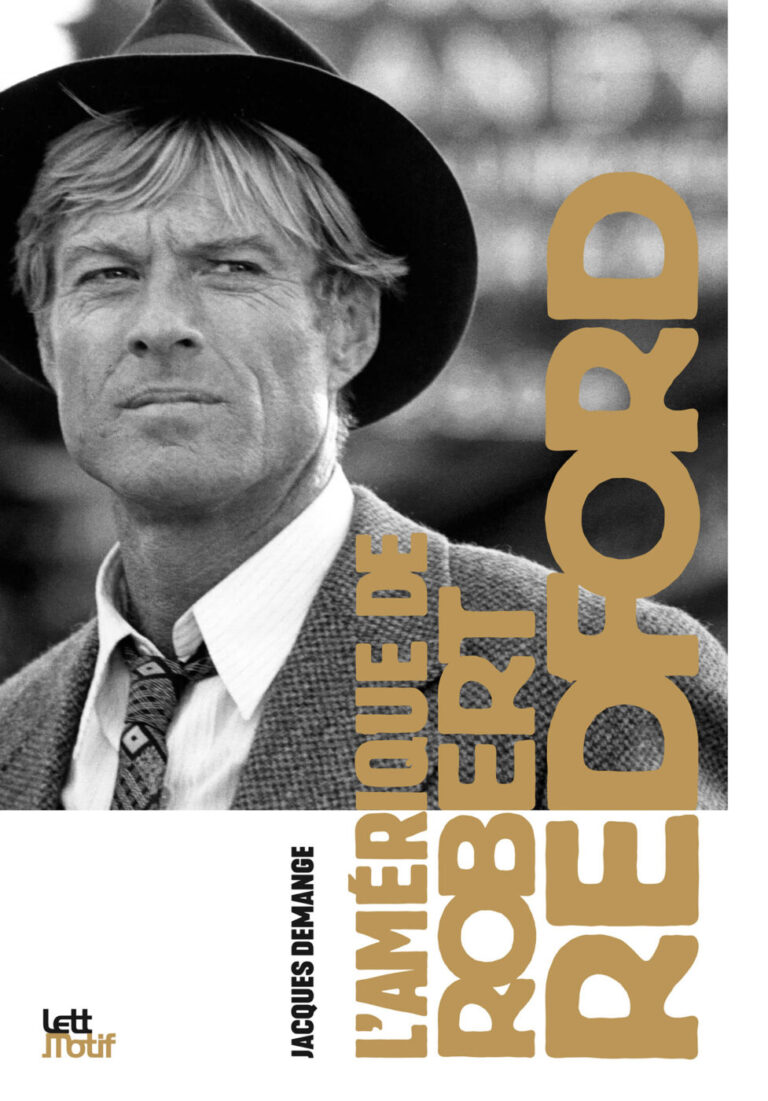Annette Wieviorka, Itinérances, Albin Michel, 08/01/2025, 592 pages, 25,90 €
Il y a des livres qui ne se contentent pas de raconter une histoire ou d’analyser un phénomène ; ils cartographient une vie, balisent une quête intellectuelle, dessinent la topographie mouvante d’un champ de savoirs en perpétuelle refondation. Itinérances, le recueil d’articles et de textes – certains remaniés, d’autres inédits servant de seuils et d’éclairages rétrospectifs – qu’Annette Wieviorka publie chez Albin Michel, appartient à cette catégorie rare. Rassemblant plus de quarante années d’écriture, de recherche et de réflexion, cet ouvrage n’est pas une simple compilation, mais la trace sédimentée d’un parcours singulier, celui d’une historienne dont le nom est indissociable de l’étude de la Shoah, de la mémoire juive en France et de la figure complexe du témoin. C’est aussi, par la force des choses, un fragment d’autobiographie intellectuelle, où l’intime affleure sous le savoir érudit, où l’engagement personnel nourrit, sans jamais la compromettre, la rigueur de l’analyse.
Le parcours engagé : des archives aux lieux, des lieux à la mémoire
Annette Wieviorka nous invite d’emblée à considérer ce volume comme un « libre parcours, revisitant les lieux de [s]es recherches, fréquentés par celles et ceux qui [l]’ont faite l’historienne que je suis ». Cette approche géographique et relationnelle structure l’ensemble. Des couloirs discrets du Centre de Documentation Juive Contemporaine (CDJC) naissant aux salles studieuses du YIVO à New York, des méandres des archives nationales rue des Francs-Bourgeois aux plaines mémorielles d’Auschwitz-Birkenau, en passant par l’espace symbolique et douloureux de l’hôtel Lutetia, chaque lieu est l’épicentre d’une strate de recherche, d’une interrogation spécifique, d’une rencontre déterminante.
Ce n’est pas une démarche abstraite. L’ancrage d’Annette Wieviorka dans ces lieux est palpable, sensible. Son récit des débuts au CDJC, rue Geoffroy-l’Asnier, est une évocation saisissante d’une époque pionnière, presque artisanale, où la mémoire de la Shoah se construisait dans une certaine indigence matérielle mais une grande ferveur humaine. Elle ressuscite l’atmosphère « bruyante, chaleureuse » de la salle de lecture, l’omniscience discrète de Madame Halperyn, la figure douce et déformée par l’arthrose de Monsieur Hessel – Ulrich, apprendra-t-elle plus tard, le fils d’Helen, l’héroïne de Jules et Jim. Ce ne sont pas des anecdotes, mais des fragments essentiels qui disent comment l’histoire s’incarne, comment les institutions naissent de la volonté et de l’engagement d’individus aux destins souvent marqués par la tragédie même qu’ils s’efforcent de documenter. Sa fréquentation précoce du YIVO à New York (chapitre II), lors d’un stage d’été pour apprendre le yiddish en 1980, motivée par le désir de lire les écrits de son grand-père Wolf Wieviorka, journaliste et nouvelliste yiddish déporté, illustre cette intrication constante entre le personnel et le professionnel. C’est là qu’elle découvre les Livres du souvenir, ces mémoriaux collectifs des communautés juives anéanties, corpus alors largement ignoré qui deviendra l’objet de son premier grand travail, co-écrit avec Itzhok Niborski. Chaque itinérance est ainsi une enquête, et chaque enquête, une manière de se situer, de retisser des liens, de retrouver ses racines ans un dialogue constant avec les archives, les témoins et les figures tutélaires de l’historiographie.
Trois chantiers majeurs d’une œuvre
Parmi la riche mosaïque de textes rassemblés ici, trois grands ensembles thématiques se détachent, qui constituent autant de contributions majeures d’Annette Wieviorka à la compréhension de notre rapport au passé.
La construction de la mémoire de la Shoah en France
Peu d’historiens ont exploré avec autant de persévérance et de finesse les processus complexes par lesquels la mémoire de la Shoah est passée, en France, d’une quasi-marginalité à une centralité parfois écrasante. Annette Wieviorka retrace cette genèse institutionnelle et intellectuelle, en revenant sur la création du CDJC, dès avril 1943 à Grenoble, par Isaac Schneersohn. Elle rappelle, à rebours d’une certaine vulgate, que l’objectif initial n’était pas l’écriture de l’histoire, mais la documentation à des fins utilitaires : « les Juifs de France seront là à la Libération. Ils devront être rétablis dans leurs biens et dans leurs droits ». C’était une vision ancrée dans le réel républicain, bien différente de celle, contemporaine, d’Emanuel Ringelblum archivant la vie et la mort du ghetto de Varsovie dans la certitude de sa destruction imminente. Annette Wieviorka démonte avec clarté le mythe d’un Schneersohn visionnaire de l’histoire, tout en reconnaissant le caractère « génial et visionnaire » de son projet ultérieur de Tombeau du Martyr Juif Inconnu, qui deviendra le Mémorial de la Shoah. Elle analyse les tensions initiales avec le jeune État d’Israël, qui revendiquait le « monopole de la mémoire et de la commémoration », et montre comment le Mémorial parisien, malgré les polémiques, s’est imposé comme un lieu central, non seulement français mais européen, de cette mémoire diasporique. L’historienne n’est pas seulement celle qui analyse a posteriori ; elle fut aussi actrice, présente dès 1985 au colloque fondateur de Bruxelles sur « Les Juifs entre la mémoire et l’oubli », où elle présenta son travail sur les Livres du souvenir.
La tension entre Histoire et Mémoire
Le second axe majeur qui traverse Itinérances est la réflexion sur les rapports complexes, parfois conflictuels, entre histoire et mémoire, notamment autour de la figure du témoin. Annette Wieviorka, dont l’ouvrage L’Ère du témoin fit date, revient ici sur ce moment où le survivant, jusque-là figure discrète, émerge au premier plan, porté par les procès (Nuremberg, Eichmann), les commémorations et une demande sociale croissante. Elle rend hommage aux pionniers, Léon Poliakov, Joseph Billig, Olga Wormser-Migot, qui, depuis les marges de l’université, souvent dans l’indifférence, ont rassemblé les premières archives, esquissé les premières synthèses. Elle confronte les approches d’un Raul Hilberg, centré sur la mécanique bureaucratique de la destruction vue par les bourreaux, et d’un Saul Friedländer intégrant les voix des victimes dans une narration polyphonique pour « tenter de comprendre l’inexplicable ». Son admiration pour Friedländer est manifeste, non seulement pour la puissance de son œuvre, mais pour la manière dont il intègre la subjectivité, la sienne propre et celle de ses acteurs, sans renoncer à la rigueur de l’analyse historique. C’est là une tension que l’auteure assume pleinement : comment l’historien, parfois lié personnellement au drame, peut-il maintenir la juste distance sans tomber dans la froideur, comment concilier l’empathie nécessaire et l’objectivité requise ? Son dialogue avec Simone Veil sur le « difficile retour » est exemplaire de cette posture : l’écoute attentive, la relance précise, la capacité à situer une expérience individuelle dans un contexte collectif, sans jamais réduire l’une à l’autre. L’histoire, chez Wieviorka, est toujours incarnée.
Les femmes dans l’historiographie
Un troisième fil, plus discret mais non moins signifiant, est celui de la place des femmes – comme historiennes, comme témoins, comme actrices de l’histoire. Annette Wieviorka elle-même, figure majeure dans un champ longtemps dominé par les hommes, incarne une trajectoire. Si elle n’insiste pas sur cet aspect, le recueil met en lumière des figures féminines importantes. Olga Wormser-Migot, dont elle retrace le parcours avec une empathie évidente, apparaît comme une pionnière sacrifiée, dont l’œuvre monumentale sur le système concentrationnaire nazi ne lui ouvrit jamais les portes de l’université, victime d’une affirmation erronée mais surtout d’un contexte peu favorable aux femmes dans le monde académique de l’après-guerre. On croise aussi la figure tutélaire de Rachel Ertel, défricheuse des études yiddish en France, ou celle, plus tragique, de Charlotte Delbo, dont « l’œuvre-témoignage » puissante est analysée comme une voix singulière, portée par la solidarité des femmes dans l’enfer de Birkenau. La question du genre n’est pas un axe central revendiqué, mais elle infuse le texte, rappelant combien l’écriture de l’histoire, comme l’histoire elle-même, est aussi une affaire de perspectives situées, de silences à interroger, de voix à réhabiliter. La nécrologie qu’elle consacre à Annie Kriegel) – « à contre-courant » – rend hommage à une autre figure féminine complexe et incontournable de l’historiographie française, elle aussi traversée par les tensions entre engagement politique, identité juive et rigueur intellectuelle.
Une mosaïque vivante : penser par fragments, écrire en mouvement
Au-delà de ces thématiques, la force singulière d’Itinérances réside peut-être dans sa structure même. En choisissant de rassembler des textes écrits sur une longue durée, ponctués de nouvelles introductions qui les resituent et les éclairent, Annette Wieviorka ne propose pas une somme figée, mais une pensée en mouvement, une œuvre-mosaïque dont les fragments se répondent, se complètent, parfois se nuancent. Cette forme hybride est particulièrement apte à rendre compte de la nature même de la mémoire et de l’historiographie de la Shoah : un champ labouré par les controverses, façonné par les contextes politiques changeants, constamment enrichi par de nouvelles archives, de nouveaux témoignages, de nouvelles interrogations.
L’écriture elle-même participe de cette dynamique. L’historienne alterne passages analytiques d’une grande clarté et moments narratifs où l’émotion affleure. Sa plume est précise, son érudition jamais pesante. Elle sait rendre vivants les débats historiographiques les plus complexes, faire sentir l’atmosphère d’un lieu d’archive, esquisser en quelques traits le portrait sensible d’une figure oubliée. Le lecteur chemine avec elle, partage ses découvertes, ses interrogations, ses admirations et parfois ses agacements. Il n’est pas face à une leçon d’histoire, mais convié à un dialogue, à une réflexion partagée sur la manière dont le passé travaille le présent, dont l’histoire s’écrit et se transmet.
Itinérances est une œuvre qui offre une plongée stimulante dans le laboratoire d’une historienne majeure. C’est aussi un hommage vibrant à une génération de pionniers, hommes et femmes, qui ont eu le courage d’affronter les silences et les tabous pour construire, pièce par pièce, la connaissance d’un événement qui continue de nous hanter. En suivant les « itinérances » d’Annette Wieviorka, c’est notre propre rapport à l’histoire, à la mémoire et à la transmission que nous sommes invités à interroger. Un voyage intellectuel et sensible, dont on sort enrichi, troublé, et reconnaissant.