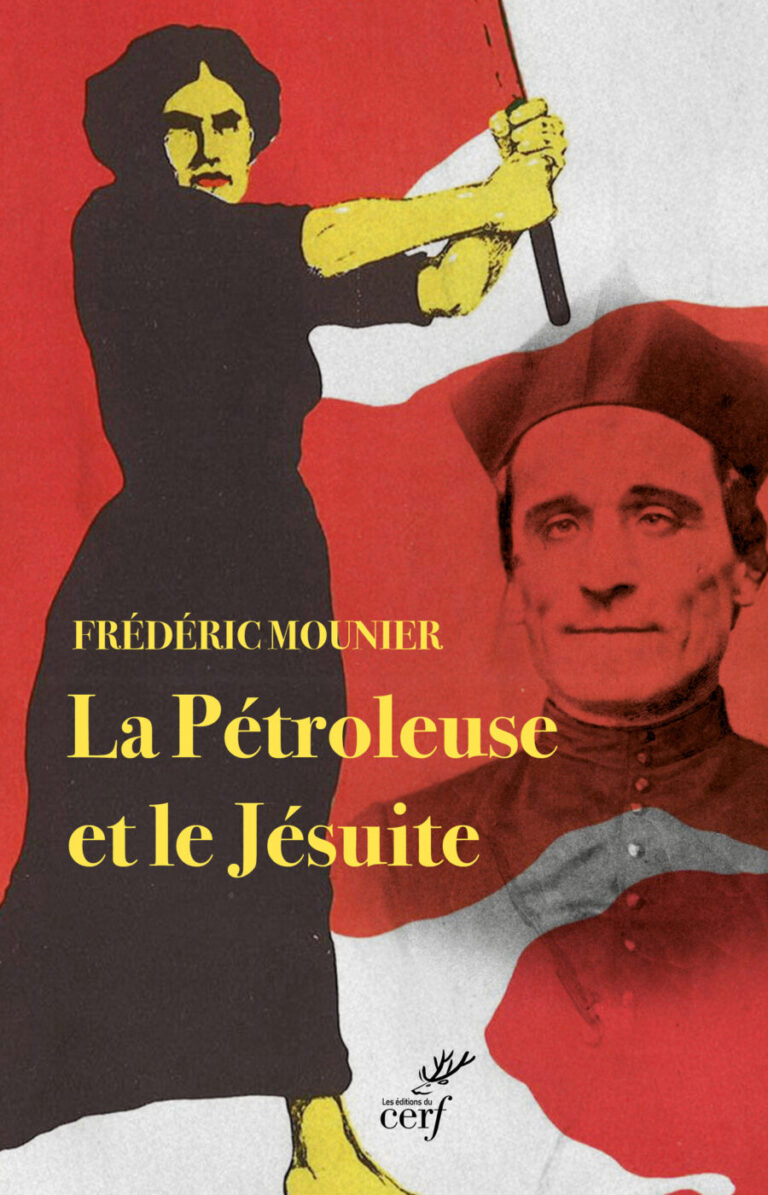Chronique Mare nostrum Marie-Pier Lafontaine, Armer la rage, Héliotrope, 07/02/2025, 114 pages, 15€
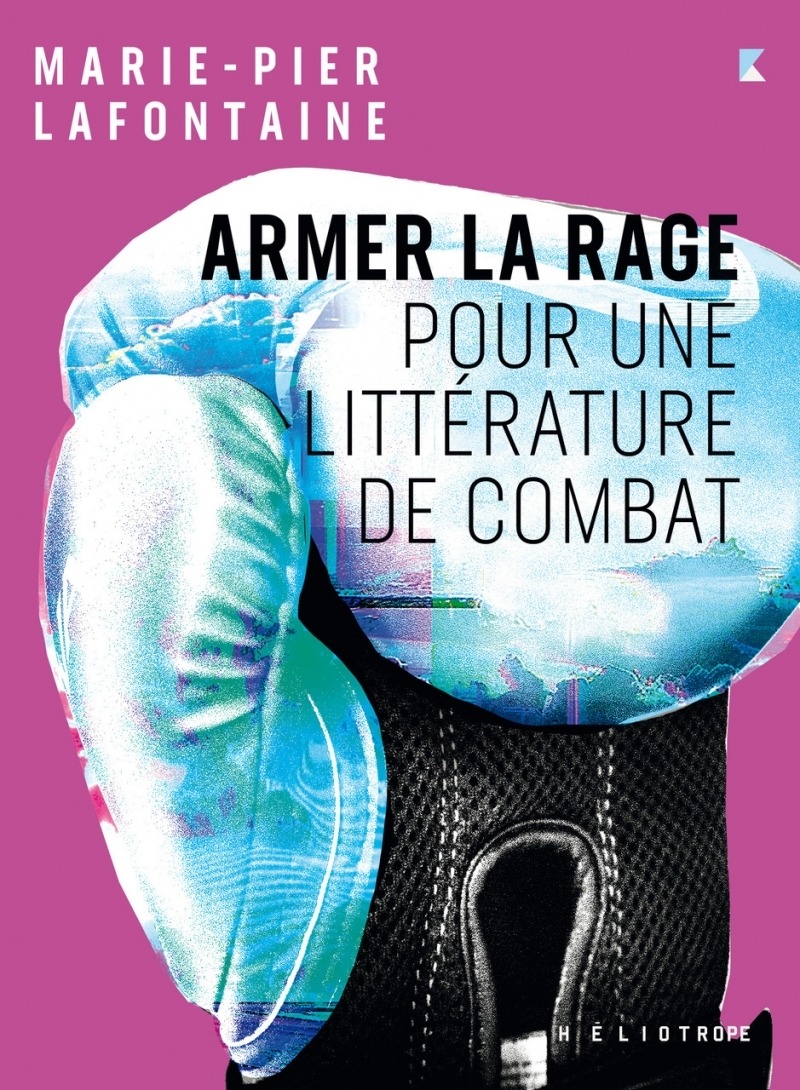
Marie-Pier Lafontaine, récompensée pour son audacieux Chienne, nous livre avec Armer la rage un texte où la chair vive de l’expérience personnelle vient percuter la théorie et la critique sociale. D’une agression dans le métro aux silences d’une enfance marquée par la violence, l’auteure tisse un récit-essai qui est à la fois une confession brute, une analyse rigoureuse des mécanismes du trauma et un appel vibrant à transformer la rage en une force littéraire subversive.
De l’agression singulière à la violence structurelle
L’architecture même d’Armer la rage révèle une vérité fondamentale sur la nature du trauma : il ne se raconte pas de manière linéaire. Lafontaine structure son essai comme une constellation de fragments qui s’éclairent mutuellement, reproduisant dans la forme cette logique de “l’écriture par fragments [qui] reprend la logique d’un état de stress post-traumatique“. L’agression dans le métro montréalais n’est pas un simple point de départ narratif ; elle devient le cristal révélateur d’une violence structurelle qui traverse l’existence entière de l’auteure.
Dès l’ouverture, Marie-Pier Lafontaine pose les termes d’un combat ambigu : “J’imagine cet essai comme un combat“. Cette métaphore guerrière, qui traverse l’ensemble du texte, ne traduit pas une posture héroïque simple, mais bien plutôt l’ambivalence profonde d’une rage qui oscille entre destruction et création. Car la boxe, espace privilégié de cette métamorphose, révèle autant la jouissance de frapper que l’angoisse de ressembler à l’agresseur.
L’épisode fondateur dévoile immédiatement les failles d’un système social qui préfère l’esquive à la riposte. Les conseils prodigués après l’agression – “ne plus prendre les transports en commun“, “porter une arme” – révèlent une logique perverse où la société restreint la liberté des femmes plutôt que de s’attaquer aux causes de la violence masculine. Mais Lafontaine va plus loin : elle montre comment cette logique de restriction s’intériorise, créant cette “hypervigilance” qui devient une seconde nature, une prison mentale aussi efficace que les barreaux réels.
Anatomie d’une rage impure
L’originalité troublante de Lafontaine réside dans son refus de l’édification. Sa rage n’est pas noble, sa résistance n’est pas pure. Elle assume pleinement l’obscurité de ses pulsions :
J’ai su au tout début de l’écriture du roman sur mon père que je devrais réintégrer l’enfant morte. Même si ça devait me submerger, même si je risquais de faire une dépression majeure. Même si ça devait me submerger, même si je risquais de faire une dépression majeure, j’ai su que je ne pourrais pas écrire sur mes souvenirs d’enfance sans accepter que j’avais été tuée à répétition.
Cette lucidité implacable traverse tout l’ouvrage, révélant une écrivaine qui refuse autant la complaisance victimaire que l’héroïsation de sa survie. Le désir de tuer le père, longuement développé, constitue peut-être le passage le plus saisissant de l’essai. Lafontaine ne se contente pas d’évoquer cette pulsion homicide ; elle la déploie dans toute sa complexité fantasmatique : “C’était une chose de m’imaginer découper, entre les cauchemars, sa peau, ses phalanges et sa langue“. Cette violence imaginaire n’est pas métaphorisée, n’est pas sublimée en “force créatrice” : elle demeure dans sa brutalité première, révélant combien la frontière entre victime et bourreau peut devenir ténue.
Cette ambivalence traverse également l’expérience de la boxe. Si l’auteure y trouve effectivement un espace de subversion genrée – “la posture à adopter est l’attaque” –, elle n’en occulte pas pour autant la dimension troublante. L’entraîneur qui reconnaît sa rage la renvoie immédiatement à sa généalogie de violence, réactivant cette “honte” qu’elle croyait avoir dépassée. La boxe devient alors autant révélation que piège : révélation de sa propre puissance, piège de la ressemblance avec l’agresseur.
La permanence du combat intérieur
Contrairement aux récits de résilience conventionnels, Armer la rage refuse toute téléologie de la guérison. Lafontaine insiste constamment sur la coexistence permanente du trauma et de la lutte, sur la cyclicité des rechutes et des ressaisies. “Malgré tout cela. Malgré une lutte de plusieurs années censée briser tous les reflets entre lui et moi, la honte demeure entière“, écrit-elle avec cette franchise désarmante qui caractérise tout l’ouvrage.
Cette permanence du combat intérieur trouve sa traduction la plus juste dans l’évocation de l’écriture. L’auteure démonte méthodiquement les mythes thérapeutiques qui entourent l’écriture du trauma : “L’écriture lie le Je à l’horreur de manière plus serrée encore, elle affûte ses crêtes, ses tranchants“. Cette lucidité désenchantée révèle une écrivaine qui a choisi l’écriture non comme consolation, mais comme perpétuel corps-à-corps avec ses démons.
L’enfance, évoquée par fragments douloureux, illustre parfaitement cette logique non-linéaire. Les souvenirs remontent par vagues, se télescopent, créent des “flash-back” qui abolissent la chronologie : “J’ai demandé à une collègue pourquoi mes frères hurlaient depuis aussi longtemps. Pourquoi aussi aigu, aussi fort. Ne les entendait-elle pas, elle aussi ?” Cette confusion temporelle, où le passé fait irruption dans le présent avec une violence intacte, traduit dans l’écriture même la logique traumatique.
Éloge de la permanence blessée
La force de Marie-Pier Lafontaine réside dans sa capacité à faire dialoguer l’intime et l’universel sans jamais instrumentaliser son expérience personnelle. Sa mobilisation des travaux de Cathy Caruth, Maria P. P. Root ou Judith Lewis Herman ne vise pas à légitimer son propos par l’autorité académique, mais bien à replacer sa singularité dans un cadre conceptuel plus large qui révèle les mécanismes sociaux à l’œuvre.
L’analyse du “trauma insidieux” – cette forme diffuse de stress post-traumatique qui touche toutes les femmes vivant dans une société patriarcale – permet de dépasser l’alternative stérile entre expérience individuelle et analyse structurelle. Lafontaine montre comment “la culture du viol est une culture qui demande aux femmes d’incorporer à répétition et en silence l’image de leur propre cadavre“, révélant ainsi la dimension politique de l’intime.
Cette articulation entre singulier et universel trouve son expression la plus aboutie dans la défense de la “littérature de combat“. Contre l’injonction académique qui voudrait séparer esthétique et politique, l’auteure revendique une écriture qui assume pleinement sa dimension subversive : “Écrire, peindre, sculpter, dessiner son expérience de l’inceste sont des manières d’opérer une brèche dans la réalité traumatique“.