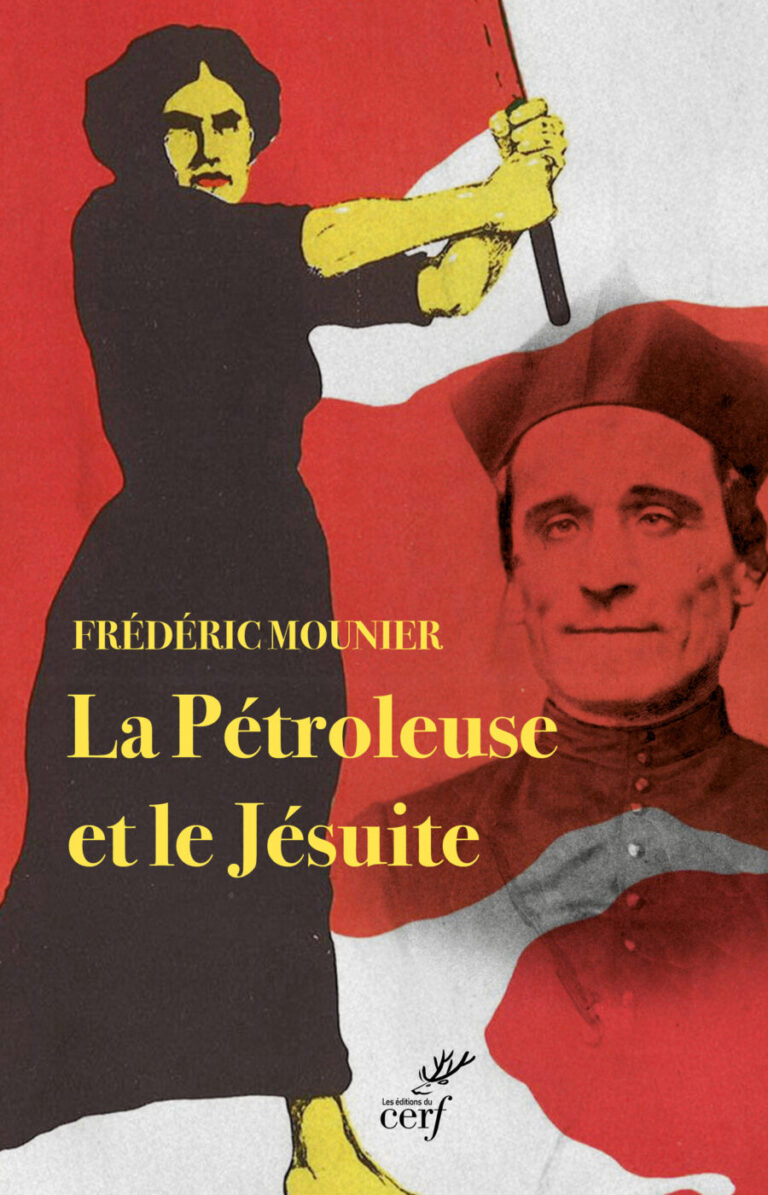Dimitri Chavaroche, Corps-à-corps. Le combat rapproché pendant la Première Guerre mondiale, Passés Composés, 05/11/2025, 256 pages, 23€
Sous les bois, la tranchée ennemie est à moins de vingt mètres. On y entend le bruit familier des soldats qui fourbissent leur arme ou qui raclent le fond de leur quart de soupe. Sans préparation d’artillerie, la patrouille s’élance. En face, la respiration haletante des coureurs et le martellement des brodequins sur le sol humide alertent les guetteurs. Trop tard ! Les poilus sautent dans le boyau, armés de poignards, de pistolets et de gourdins cloutés. Le corps-à-corps débute, sauvage, inhumain.
Dimitri Chavaroche dévoile l’horreur nue des tranchées
Docteur en histoire et enseignant, Dimitri Chavaroche s’est spécialisé dans la pratique du combat durant la Grande Guerre. Au travers de son ouvrage, agrémenté de témoignages des acteurs du drame, il décortique le processus qui mène le duelliste à sentir l’haleine de l’adversaire et à lui trouer la peau pour sauvegarder la sienne. Loin des poncifs longtemps magnifiés sur le combat à la baïonnette cher aux amateurs de sensations fortes, il démontre que le corps-à-corps n’est pas le but de la bataille mais bien sa dernière extrémité, autant pour celui qui donne la mort avec dégoût que pour celui, horrifié, qui la reçoit.
Si l’escrime à la baïonnette est enseignée avant la guerre, c’est que le commandement voit en cette arme le prolongement de l’offensive. Dans les combats de début 1914, alors que le front est fluctuant et que les positions oscillent tous les jours, il n’existe que deux moyens de s’emparer de celles de l’adversaire : le chasser par le feu de l’artillerie ou l’anéantir au corps-à-corps. Là, l’être humain fait place à la féroce créature qui lutte jusqu’au paroxysme afin d’infliger la mort avec le courage du désespoir.
Cet exercice, rendu difficile en raison de l’exiguïté de la tranchée, contraint le belligérant à utiliser tout ce qui se présente : pelle-bêche, pistolet et quelquefois la main nue. La fixation du front, et par là l’amélioration des lignes par le creusement d’abris, l’installation de postes de mitrailleuses et la fourniture de fils de fers barbelés, va mettre un terme, ou tout au moins le ramener à sa portion congrue de ce que les réalisateurs de films et les écrits sensationnels intitulent à grand renfort d’images : l’assaut à la baïonnette.
Hurlements, baïonnettes, boue : la vérité d’un assaut français
À partir de 1915, les Français tentent de reconquérir les portions de territoire sous contrôle des Allemands. Il est impensable de se satisfaire de la situation alors que les tranchées n’ont pas encore la consistance qu’elles connaîtront par la suite. Il faut donc en profiter à coups d’hommes. Après une concentration d’artillerie dont les effets matériels et humains, sont dévastateurs, les hommes s’élancent munis de leur fusil rallongé de la célèbre « Rosalie ». Au terme d’une course effrénée, le contact est établi avec l’ennemi abruti par les explosions mais qui fait quelquefois preuve d’une étonnante fermeté. Dans cet espace réduit au minimum, les uns et les autres, en proie à une peur atroce, entament leur descente aux enfers qui pour faire place nette, qui pour survivre à la vague. Le tout est immortalisé par le « bruit du corps-à-corps » : cris de détresse de celui qui se sait arrivé au bout de sa vie, grognements sourds des combattants emmêlés recherchant le point faible de l’adversaire, hurlements de fureur du vainqueur, délivré du poids de l’angoisse.
Malgré les grandes offensives, le front peut s’avérer être d’un calme relatif. Le no man’s land, souvent profond de plus de cent mètres, est un obstacle parfois infranchissable. Il est parsemé de petits postes dans lesquels les occupants guettent le moindre mouvement. Ils sont la proie des « coups de main ». En effet, le commandement, toujours à la recherche de renseignements frais, ordonne l’expédition de nuit au bout de laquelle une équipe de corps francs – lisez commandos – s’aventure sur le glacis jonché de cadavres en putréfaction dans le but de faire des prisonniers et de s’emparer de toute la documentation qui permettra de mieux connaître les intentions de ceux d’en face.
Guerriers de l’ombre : qui sont vraiment les corps francs ?
Pour réaliser cet objectif, le fusil et sa baïonnette sont superflus. Chaque militaire a une mission très précise : couper les barbelés, établir une communication avec l’arrière ou transporter une musette gonflée par les grenades. Cet artéfact, bien qu’arme de lancer, est utilisé au plus près de l’endroit où l’on joue sa vie. Au moment de se ruer à l’attaque, quelques coups de pistolet auront raison des ennemis les plus proches, permettant ainsi aux autres combattants d’agripper un adversaire et le traîner vers l’arrière, si tant est que ce dernier se laisse faire. À défaut, le couteau de tranchée du nettoyeur, muni d’un poing américain, ou le gourdin lesté d’une masse de métal aura raison du récalcitrant. Lorsque l’affaire se présente mal, il vaut mieux savoir boxer ou avoir suivi les cours rébarbatifs de Jiu Jistu, prodigués par des spécialistes à l’arrière.
Mais qui compose ces corps francs ? Des volontaires ? Des punis ? Il est évident que faire partie d’une patrouille nocturne n’est pas donné à tout le monde. Il faut une certaine dose de courage, voire de pragmatisme. En effet, aucun ordre de bataille ne mentionne une unité spécifiquement dédiée à ce travail. Le volontaire a toutes les chances d’échapper aux multiples corvées qui régissent la vie des tranchées. De plus, un coup de main réussi donne souvent droit à une récompense : une citation avec décoration suivie d’une substantielle permission. La haine suscitée par la perte d’un proche parent ou un frère d’arme particulièrement chéri peut engendrer un désir de vengeance que seule la patrouille peut atténuer. Le « volontaire désigné d’office » doit alors côtoyer des camarades prêts à tout pour recevoir leur dose d’adrénaline.
Entre la réalité du combat et l’article dans les journaux, le héros du coup de main doit être surpris par la lecture de l’article qui le glorifie car souvent, l’aventure ne s’est pas produite comme énoncée dans les lignes imprimées dans les magazines. Il n’en reste pas moins vrai que le corps-à-corps, au cours de la Grande Guerre comme dans les autres conflits, a généré dans notre imaginaire l’acception la plus attendue de l’affrontement guerrier.
Ce n’est pas un livre de guerre, mais un livre sur ce que la guerre fait de nous – et pour cela, il faut le lire.