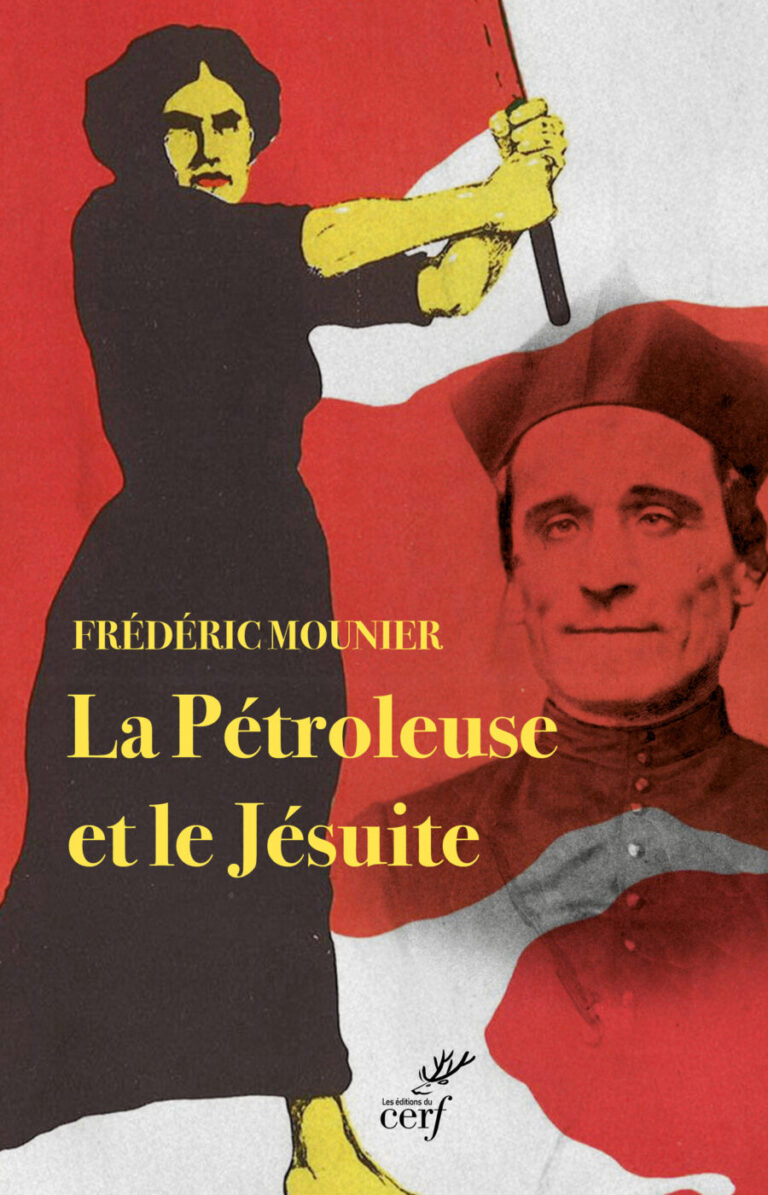La détention de Boualem Sansal, romancier algérien de stature internationale, constitue aujourd’hui l’un des symptômes les plus criants de la crispation mémorielle qui empoisonne les relations franco‑algériennes. Depuis son incarcération à l’automne 2024, l’octogénaire souffrant d’un cancer voit son œuvre – hymne obstiné aux libertés de l’esprit – réduite au silence derrière les barreaux. Nombre d’observateurs s’accordent : si Alger emprisonne l’écrivain, c’est aussi que, de l’autre côté de la Méditerranée, un cliquetis d’éloges mal digérés pour l’Algérie coloniale et de critiques fournit au régime un argument commode. Tant que la droite extrême française persistera à ressusciter l’ombre tutélaire de l’OAS et la mémoire coloniale, elle permettra aux autorités algériennes de brandir la posture victimaire et de transformer Sansal en otage idéologique. D’où l’impérieuse nécessité : pour libérer l’homme, il faut que les nostalgies réactionnaires se taisent enfin.
Le roman d’un asservissement
Boualem Sansal n’est ni un inconnu, ni un agitateur de circonstance. Lauréat du Grand Prix du roman de l’Académie française, traducteur de l’angoisse islamiste, chantre d’une Algérie ouverte aux vents contradictoires de l’Histoire, il a toujours revendiqué l’irrévérence comme devoir civique. Son œuvre, réquisitoire contre l’autoritarisme et le fondamentalisme, lui a valu l’accusation d’« atteinte à l’unité nationale ». Ironie tragique : l’écrivain, ex‑ingénieur formé en France, se retrouve aujourd’hui prisonnier d’une double méfiance – celle d’un pouvoir algérien prompt à voir dans toute plume critique la main de l’ennemi colonial, et celle, plus souterraine, d’une frange de l’opinion française qui instrumentalise sa parole pour régler ses comptes avec l’Algérie post‑indépendance, mais aussi l’Islam.
La rhétorique du ressentiment
La chronique politique récente l’a montré : dans certains cercles parlementaires et municipaux de France, une chanson ancienne, imprégnée de douleurs de pieds‑noirs et de rancœurs militaires, renaît avec obstination. Quand un député acclame « l’œuvre civilisatrice » de la colonisation, quand un maire Rassemblement National baptise une place pour exalter un membre de l’OAS, ou en juin 2022 organise un festival faisant de sa ville la « Capitale des Français d’Algérie », ils n’offrent pas seulement un spectacle désuet : ils réactualisent une blessure collective, rendent légitime la méfiance algérienne, et donnent poids à la propagande officielle d’Alger. Les tenants du pouvoir peuvent alors désigner Boualem Sansal – critique de leur autoritarisme, mais aussi figure adulée dans l’ex‑métropole – comme le cheval de Troie d’un ex‑colonisateur qui, « à peine repentant », ressasserait son passé impérial.
Un tir croisé qui condamne l’écrivain
Cette collusion objective entre l’extrême droite française et la gouvernance algérienne crée une asymétrie redoutable. D’un côté, l’écrivain paie le prix fort : sa santé décline, son œuvre est interdite, sa voix se dissout dans l’écho creux des cellules de haute sécurité. De l’autre, le régime algérien capitalise sur chaque saillie nostalgique entendue à Paris ou ailleurs pour renforcer sa position : comment, demande‑t‑il, négocier avec un État dont les représentations nationales tolèrent l’apologie d’une organisation terroriste – l’OAS – responsable de milliers de morts en Algérie ? Ainsi la sortie d’un politicien français, apparemment anodine dans la joute hexagonale, devient à Alger une caution morale pour persévérer dans la répression. Dans ces conditions, les appels du gouvernement français en faveur de l’écrivain tombent dans un climat hostile : comment convaincre Alger de faire un geste humanitaire, lorsque certains en France semblent regretter la colonisation ? Chaque phrase nostalgique côté français offre au régime du président Tebboune un prétexte de camper sur une posture de défi patriotique, rendant politiquement coûteuse toute concession, comme une grâce présidentielle.
L’étouffement de la parole libre
Il existe pourtant, dans l’histoire récente, des exemples où la révision d’une posture idéologique a ouvert les portes des prisons. Quand le général de Gaulle, en 1962, a rompu avec le fantasme de « l’Algérie française », il a créé la possibilité de libérations massives. De même, la préfiguratrice abolition de l’apartheid fut précédée d’un renoncement discursif au mythe de la suprématie blanche, qui permit la libération de Mandela. L’enseignement est clair : aucune délivrance ne fleurit sur le fumier de la nostalgie. Rappelons également qu’entre Sansal et Soljénitsyne se déploie un même champ de forces : la littérature comme levier d’insurrection intérieure et la mémoire falsifiée comme instrument de coercition. Soljénitsyne dut arracher la vérité des camps au brouillard idéologique soviétique ; Sansal, lui, affronte une double chape de plomb, national‑militaire à Alger, identitaire‑nostalgique en France. Dans les deux cas, l’écrivain se heurte à un pouvoir qui vampirise l’Histoire pour légitimer le présent, et c’est précisément pourquoi le silence impératif de l’extrême droite française devient la clef stratégique : en renonçant aux incantations sur l’Algérie française, on ôte au régime algérien l’argument‑écran de la « menace coloniale » et l’on restitue la confrontation à sa vérité nue – un homme libre injustement incarcéré pour délit de pensée.
Un devoir de silence, une urgence de justice
D’aucuns rétorqueront que le régime algérien resterait répressif, quoi qu’il advienne dans les tribunes françaises. L’argument est partiellement vrai ; la diplomatie comme la mobilisation citoyenne s’exercent à la marge – là où s’ouvrent les interstices du possible. Dissiper la suspicion coloniale, c’est au moins ôter au pouvoir algérien sa justification préférée ; c’est rabattre la cause Sansal sur son seul terrain légitime : celui des droits humains fondamentaux. Plus d’écran mémoriel, plus de prétexte historique ; reste le visage d’un vieil homme, malade, qu’aucune raison ne condamne, sinon la peur du verbe libre.
La nostalgie colonialiste affichée par la droite extrême française offre au régime algérien un prétexte en or pour maintenir Boualem Sansal en prison
À l’heure où l’Europe se proclame gardienne des libertés, laisser croupir Boualem Sansal revient à saboter ses propres principes. Mais s’émouvoir ponctuellement ne suffit plus : il faut assainir le champ discursif, faire taire l’extrême droite quand elle exalte l’OAS, rappeler que la colonisation fut un système d’oppression et que son apologie offense l’histoire autant qu’elle entrave la justice présente. Sans ce préalable, toute pétition, toute démarche diplomatique se heurtera à la citadelle d’un ressentiment entretenu. En finir avec la nostalgie de l’Algérie française est non seulement un devoir de mémoire, mais une condition pour avancer vers la justice et la liberté. Boualem Sansal, ainsi que tous les démocrates algériens, méritent que l’on fasse ce pas de courage politique. Cessons de regarder en arrière avec complaisance : c’est en regardant ensemble vers l’avenir, libérés du poids des discours coloniaux, que Français et Algériens pourront sauver une vie et écrire une nouvelle page d’histoire commune.
Il appartient donc aux responsables politiques, aux médias, aux intellectuels, aux citoyens, de réduire au silence – par le contre‑discours, l’argument, la désapprobation civique – les sirènes de la nostalgie coloniale. À ce prix seulement, pourra s’élever une voix claire, dépouillée des oripeaux du passé, pour exiger : « Libérez Boualem Sansal ! » Et lorsqu’enfin cette voix ne sera plus polluée par les clameurs d’une mémoire faussée, elle résonnera jusqu’aux geôles algériennes, porteuse d’un espoir qu’aucune frontière, aucune idéologie ne pourra durablement museler.