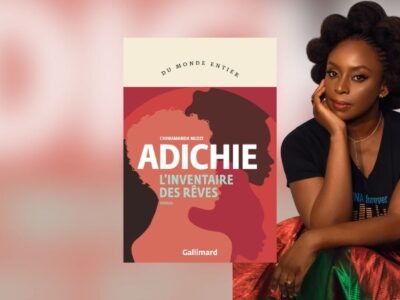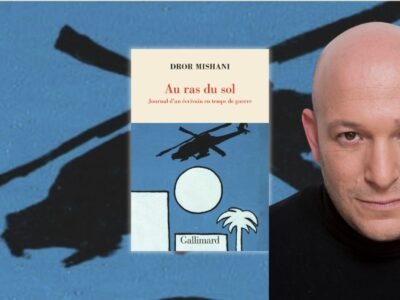Lavie Tidhar, Central station, traduit de l’anglais par Julien Bétan, Mnémos, 21/02/2024, 1 vol. (256 p.), 20,50€

Rarement une œuvre de science-fiction aura su, avec autant de virtuosité que Central Station de Lavie Tidhar, saisir l’essence protéiforme d’un futur aussi proche qu’insaisissable, où l’Humanité, écartelée entre Terre et Espace, Réel et Virtuel, se recompose dans la lumière crépusculaire d’un monde finissant pour mieux renaître aux frontières de l’inconnu. Véritable coup de maître, ce roman-mosaïque nous entraîne dans une odyssée subtile et puissante au cœur d’un univers foisonnant, dont l’apparente fragmentation spatio-temporelle se révèle, à mesure que l’on en arpente les méandres, comme la chambres d’échos d’une quête universelle et intime.
C’est que derrière le chatoiement de son décor – ce gigantesque spatioport de Central Station qui tisse une toile d’araignées entre les derniers lambeaux d’une Tel Aviv en déshérence et les colonies spatiales en plein essor – Tidhar orchestre une méditation profonde et lucide sur la place de l’Homme dans le ballet étourdissant des mondes qu’il s’invente et qui le fuient. À travers les destins en apparence disloqués d’une galerie de personnages inoubliables, se dessine en filigrane le portrait d’une humanité ivre de ses rêves, qui “continuait à avancer, suivant la piste lumineuse” des étoiles comme Vlad et son fils Boris marchant dans la nuit, “jusqu’à ce qu’ils arrivent sains et saufs à la maison“.
Frontières poreuses et identités mouvantes : l'altérité au cœur du réel
C’est que dans l’univers paradoxal et envoûtant de Central Station, toutes les frontières vacillent et se confondent, à commencer par celles qui séparent le centre de la périphérie, la norme de la marge, le soi de l’autre. Déjà, le cadre même du roman hybride avec virtuosité les poncifs du genre, puisque “Tel Aviv Nord, [où] les Juifs vivaient dans leurs gratte-ciel” jouxte “”Jaffa, au sud, [où] les Arabes avaient repris leur vieille terre près de la mer”, tandis que s’incrustent dans ses interstices ces “quartiers adaptoplantes” qui “poussaient comme des mauvaises herbes autour de Central Station“.
Mais c’est surtout dans le kaléidoscope bigarré de ses personnages que l’auteur dynamite avec jubilation les carcans identitaires, faisant dialoguer humains, “robotniks” et entités digitales dans un joyeux charivari où les vampires de données (strigoi) côtoient les “Autres”, ces “étranges intelligences numériques désincarnées”. Tout se passe comme si, par-delà l’illusion trompeuse des apparences, Tidhar nous invitait à embrasser la part d’altérité tapie au fond de nous, à l’instar d’Achimwéné qui, bien que dénué de nodule, “savait que toutes les enfances avaient une fin” et rêvait de “voir à quoi ressemblaient les autres mondes“.
Car il y a fort à parier que les multiples visages de l’Autre qui hantent Central Station sont autant de miroirs tendus à nos propres chimères et que, comme le souligne avec une infinie délicatesse le robo-prêtre R. Ustine, “nous sommes tous des machines“, pétris de cette même quête éperdue d’amour et de transcendance. Ainsi, lorsque la jeune Carmel, pourchassée par sa condition de Shambleau qui la force à se nourrir d’autrui, trouve refuge auprès d’Achimwéné le simple humain, leur union improbable scelle le triomphe paradoxal d’un amour plus fort que le déterminisme des genres et des espèces.
Vertiges de la mémoire et échos de l'intime : les fils qui nous relient
Mais la force hypnotique du roman de Lavie Tidhar tient aussi et surtout à son art consommé de la “mémorable”, qui transmute le motif de la réminiscence en outil d’exploration métaphysique. Telle la mystérieuse “Folie de Weiwei”, cette mémoire ancestrale infectant tel un virus l’esprit de ses héritiers, le texte ne cesse de mettre en abyme l’impérieuse nécessité et la douleur lancinante du souvenir. Des méandres psychiques de Vlad, rongé par le “cancer de la mémoire” qui le submerge de réminiscences, aux enfants nés dans les “labos d’enfantement” de Central Station, tous les personnages semblent comme écartelés entre le poids d’un passé omnipotent et les promesses d’un futur en perpétuel devenir.
C’est que la mémoire, dans ce qu’elle a de plus intime et de plus vibrant, est peut-être au fond le seul viatique permettant d’apprivoiser ce monde en pleine métamorphose et d’y tracer son sillon. Ainsi Boris, de retour d’une longue odyssée spatiale jusqu’aux confins du système solaire, éprouve, dans les bras de Miriam, “un sentiment qu’il ne pouvait décrire, mais qui ressemblait à de l’amour“, un amour qui a “toujours été là quand [il] était parti“. De même, lorsque Vlad se résout à “partir dans la dignité” grâce au Grand Huit Urbonas de l’euthanasie, c’est parce qu’il sait qu’il “vivra sous la forme d’un souvenir”, pour que “tous ceux nés à Central Station et au-delà puissent se rappeler à travers [lui] tout ce qu'[il a] vu”.
Ainsi se tisse, de réminiscences éparses en échos intimes, une vaste toile invisible qui relie les êtres par-delà le temps et l’espace, les arrimant à ce qui, en eux, transcende leur condition. Comme le résume avec une infinie délicatesse le sculpteur des dieux Eliezer, “nous rêvons le consensus d’une réalité“, un rêve collectif qui est peut-être au fond le seul rempart contre la dissolution de toute humanité.
Entre Odyssée galactique et espaces intérieurs : voyages métaphysiques
C’est qu’en définitive, la force tellurique qui innerve Central Station de part en part n’est autre que cette soif inextinguible de l’ailleurs qui, de tout temps, aura jeté les hommes sur les routes de l’inconnu, à la poursuite de leur propre horizon. Nul hasard dès lors si le roman s’ouvre sur le retour au pays de Boris, ce “docteur enfanteur” désabusé en quête de lui-même, ni si les épisodes les plus vibrants nous plongent dans les tréfonds psychiques de Carmel, d’Isobel ou d’Achimwéné, comme autant d’odyssées intérieures où se joue le destin de l’Humanité.
Car les véritables frontières que ne cessent d’arpenter et de repousser les héros de Tidhar sont celles, infinies et labiles, de leur propre conscience. Qu’il s’agisse des fulgurances hallucinatoires engendrées par la drogue, des simulacres fantasmagoriques de l’univers de “Guildes d’Ashkelon” où s’abîme Isobel ou des chimères que fait miroiter le “toktok blong narawan”, cette langue secrète des Autres, tous ne sont jamais que des visionnaires égarés au royaume des limbes, en quête d’une Vérité qui se dérobe. “La seule règle de l’univers, mon enfant, c’est le changement“, assène ainsi l’Oracle à Ruth, comme pour mieux souligner la vanité de tout point fixe dans ce maelstrom d’incertitudes.
Dès lors, c’est à une véritable révolution copernicienne que nous convie Lavie Tidhar, en substituant à l’illusion trompeuse d’un monde stable et ordonné la vision autrement vertigineuse d’un réel en perpétuelle métamorphose, dont l’apparent chaos n’est que le reflet de nos propres espoirs et leurres. “C’était un temps de ferveur et d’incertitude, un temps de haine et de paix“, écrivait déjà l’historien Elezra au sujet d’une époque révolue. Gageons qu’en notre ère digitale où “le présent se fragmente“, seul le pouvoir visionnaire de la littérature saura encore, à l’instar de Central Station, nous offrir une boussole pour apprivoiser ” un futur [qui] se ramifie comme les branches d’un arbre”.
"Central Station" ou la mosaïque éclatée d'un Nouveau Monde
Au terme de ce périple envoûtant dans les arcanes d’une Humanité ivre de ses rêves et de ses chimères, force est de constater que Lavie Tidhar a magistralement relevé le défi qui est au cœur de toute grande œuvre de science-fiction : brosser le portrait saisissant et prémonitoire d’un futur qui, pour être encore à inventer, n’en contient pas moins, en germe, tous les frémissements et les doutes du présent.
Délaissant la tentation de la fresque historique ou du roman d’anticipation, l’écrivain a su trouver, dans l’entrelacs virtuose de destins singuliers lovés au cœur de cette Central Station mutante et tentaculaire, le prisme idéal pour saisir les contours d’un monde nouveau avec autant d’acuité que de poésie. De la famille Chong, dépositaire des secrets enfouis de l’ancienne Chine, aux enfants hybrides, nés d’une semence mi-humaine mi-divine dans les labos souterrains de la station, tous composent la mosaïque chatoyante et poignante d’une nouvelle Genèse où, sur les décombres utopies anciennes, s’invente l’avenir de notre étrange planète.
Servi par une langue somptueuse, qui n’est pas sans évoquer les fresques du “Cycle de Dune” ou les sortilèges de Ray Bradbury, Central Station s’impose comme le roman d’une génération en quête de repères, saisie dans ce moment fugace et crucial où “le monde était jeune“, où “les vaisseaux de l’Exode commençaient seulement à quitter le système solaire”. Puisse cette Odyssée des temps futurs être aussi la nôtre, et nous enseigner, à l’instar de Miriam, que “les histoires sont des mensonges“, mais que c’est dans la chaleur des êtres aimés et la douceur des rêves partagés que se forge, envers et contre tout, notre humanité.
Puissent les mots de Lavie Tidhar, semblables aux prières du robot R. Ustine s’élevant dans le ciel de Central Station, nous aider à apprivoiser ce nouveau monde qui est déjà le nôtre : “Notre créateur qui êtes dans le champ du point zéro, que vos neuf milliards de noms soient sanctifiés…“

Chroniqueur : Jean-Jacques Bedu
contact@marenostrum.pm
NOS PARTENAIRES
Faire un don
Vos dons nous permettent de faire vivre les libraires indépendants ! Tous les livres financés par l’association seront offerts, en retour, à des associations ou aux médiathèques de nos villages. Les sommes récoltées permettent en plus de garantir l’indépendance de nos chroniques et un site sans publicité.