Soufiane Khaloua, Chasseurs d’été, Agullo, 28/08/25, 252 pages, 22,90€
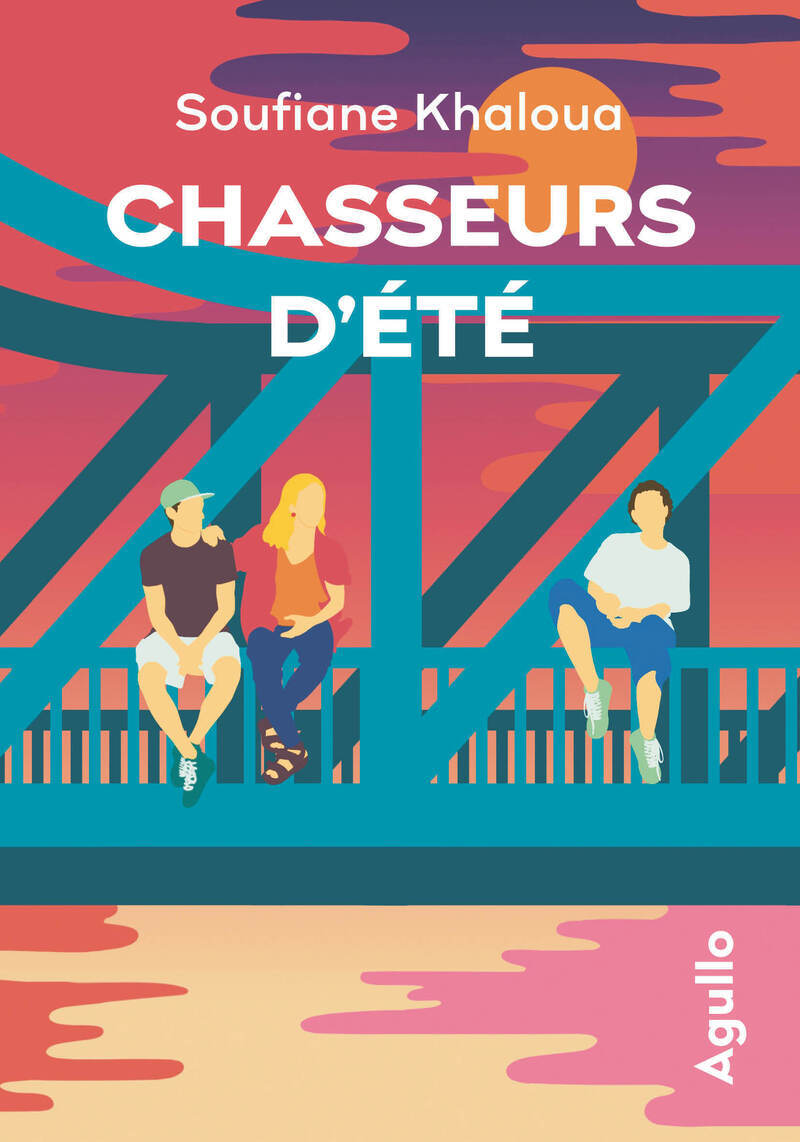
Une passerelle enjambe les rails. Entre Saint-Exupéry et le centre-ville de Bloignes, entre l’enfance et sa disparition, Soufiane Khaloua construit son roman comme on érige un monument aux disparus : Nelson et Naka, les deux fantômes qui hantent cette prose mémorielle. Chasseurs d’été s’inscrit dans la lignée des grands récits d’apprentissage français, quelque part entre Le Grand Meaulnes d’Alain-Fournier et L’Ami retrouvé de Fred Uhlman, mais avec cette urgence particulière du XXIe siècle où les territoires périphériques deviennent les nouveaux théâtres de l’épopée adolescente. Soufiane Khaloua rejoint ainsi la cohorte des voix contemporaines – Faïza Guène, Rachid Santaki, Kaoutar Harchi – qui cartographient les géographies intimes de la banlieue française, mais avec une ambition romanesque qui déborde largement le cadre sociologique.
La passerelle et ses fantômes
Bloignes existe. Ville fictive certes, mais dont chaque lecteur reconnaîtra la topographie : ces communes moyennes de province où la géographie sociale dessine des frontières invisibles mais infranchissables. La passerelle qui sépare Saint-Exupéry du centre-ville devient, sous la plume du romancier, le Styx contemporain, fleuve mythologique qu’on traverse pour passer d’un monde à l’autre. D’un côté, les HLM aux “murs couleur de l’urine“, les rumeurs de chiens sauvages lâchés la nuit, les drames qui s’accumulent comme des strates géologiques. De l’autre, la place de la Mairie transformée en agora enfantine, où les règles du football deviennent une constitution démocratique miniature.
Le roman explore avec une acuité remarquable les dynamiques de classe qui structurent l’amitié adolescente. Dan, le narrateur, fils d’une femme de ménage marocaine et d’un père absent parti sur des plateformes pétrolières, navigue entre deux mondes avec la conscience aiguë de sa position liminale. Cette tension sociale irrigue tout le récit, créant ces moments de gêne exquise – la honte anticipée que sa mère apparaisse avec son chariot de ménage devant ses amis bourgeois – qui révèlent la cruauté sourde des hiérarchies enfantines.
Les strates du temps retrouvé
Soufiane Khaloua déploie une écriture qui procède par saturation mémorielle, accumulant les détails sensoriels jusqu’à reconstituer la texture même du passé. Les bombers bleu électrique à l’intérieur orange, l’odeur de graillon qui imprègne éternellement le canapé de Sandrine, le bruit métallique du ballon contre la lampe derrière le banc-but : chaque détail devient une madeleine proustienne inversée, non pas déclencheur, mais résultat du travail de mémoire. La prose oscille entre lyrisme contrôlé et oralité assumée, créant cette musique particulière de la remémoration où le langage parlé affleure sous la phrase écrite.
L’architecture narrative épouse la discontinuité du souvenir. Les chapitres s’organisent selon une logique géographique et temporelle – “Bloignes, entre la passerelle et le canal“, “Hors de Bloignes”, “Un balcon sur la mer” – comme si l’espace était le seul repère fiable dans le chaos de la mémoire affective. Cette structure permet à Soufiane Khaloua d’orchestrer les ellipses et les révélations, maintenant jusqu’au bout le mystère de la mort de Nelson, ce “cadavre gonflé et flasque” repêché dans l’écluse.
Le vote du silence
Au cœur du roman palpite un secret – celui de la mort de Nelson – qui contamine progressivement tout le récit. Soufiane Khaloua transforme ce silence en matière romanesque, explorant la loyauté comme forme perverse de l’amour adolescent. Quand Naka révèle qu’il sait tout sur la mort de Nelson, mais qu’il a promis de se taire, le groupe d’amis vote démocratiquement pour respecter son silence. Cette scène, d’une puissance symbolique vertigineuse, interroge notre rapport contemporain à la vérité : que choisissons-nous entre la justice et l’amitié ? Entre la transparence et la protection de ceux qu’on aime ?
Le roman dialogue ici avec les grandes œuvres sur l’omerta adolescente, de Stand by Me de Stephen King au Silence de Shūsaku Endō, mais avec cette particularité française où le secret devient constitutif du lien social. La capsule temporelle que les adolescents enterrent sur une falaise bretonne contenant leurs “mauvais souvenirs“, devient la métaphore centrale du roman : ce qu’on enfouit ne disparaît jamais vraiment, il structure souterrainement nos existences.
La mélancolie des étés impossibles
Chasseurs d’été révèle Soufiane Khaloua comme un écrivain de la disparition. Non pas celle, brutale, de la mort, mais celle, insidieuse, de l’oubli progressif. Les personnages s’effacent peu à peu du récit comme ils s’effacent de nos vies : d’abord omniprésents, puis intermittents, enfin réduits à des rumeurs, des lettres du Japon, des silences. Le titre prend alors tout son sens : Nelson et Naka voulaient devenir “chasseurs d’été“, vivant dans un éternel présent ensoleillé en changeant d’hémisphère selon les saisons. Mais l’été qu’ils chassaient était peut-être celui de l’enfance elle-même, cette saison de la vie où l’amitié possède encore cette intensité absolue, cette gravité joyeuse que l’âge adulte dilue inexorablement.
Soufiane Khaloua nous offre un roman nécessaire sur ces amitiés fondatrices qui nous constituent avant de nous échapper, sur ces lieux – une place de mairie, une passerelle, un canal – qui deviennent les théâtres de nos mythologies intimes. Son écriture, traversée par les fantômes de Rimbaud dont les vers ouvrent le livre, porte cette mélancolie lumineuse des étés perpétuels qui n’existent que dans le souvenir. Un texte qui s’impose comme une cartographie sensible de l’adolescence française contemporaine, où la beauté côtoie la violence, où la loyauté devient piège, où grandir signifie apprendre à porter ses morts. Que les éditions Agullo, véritables archéologues des voix nouvelles, aient su déceler dans ce manuscrit la promesse d’une œuvre majeure témoigne une fois encore de leur flair éditorial singulier, cette capacité à reconnaître, dans le bruissement des récits contemporains, ceux qui sauront toucher au cœur l’époque et ses lecteurs.















