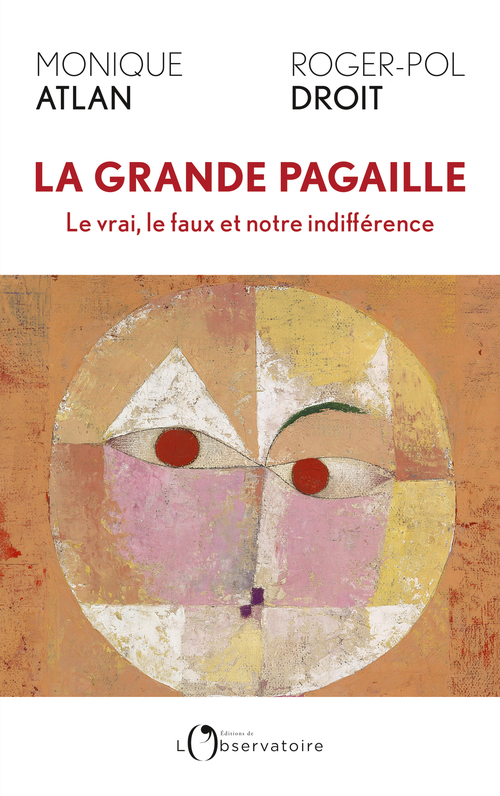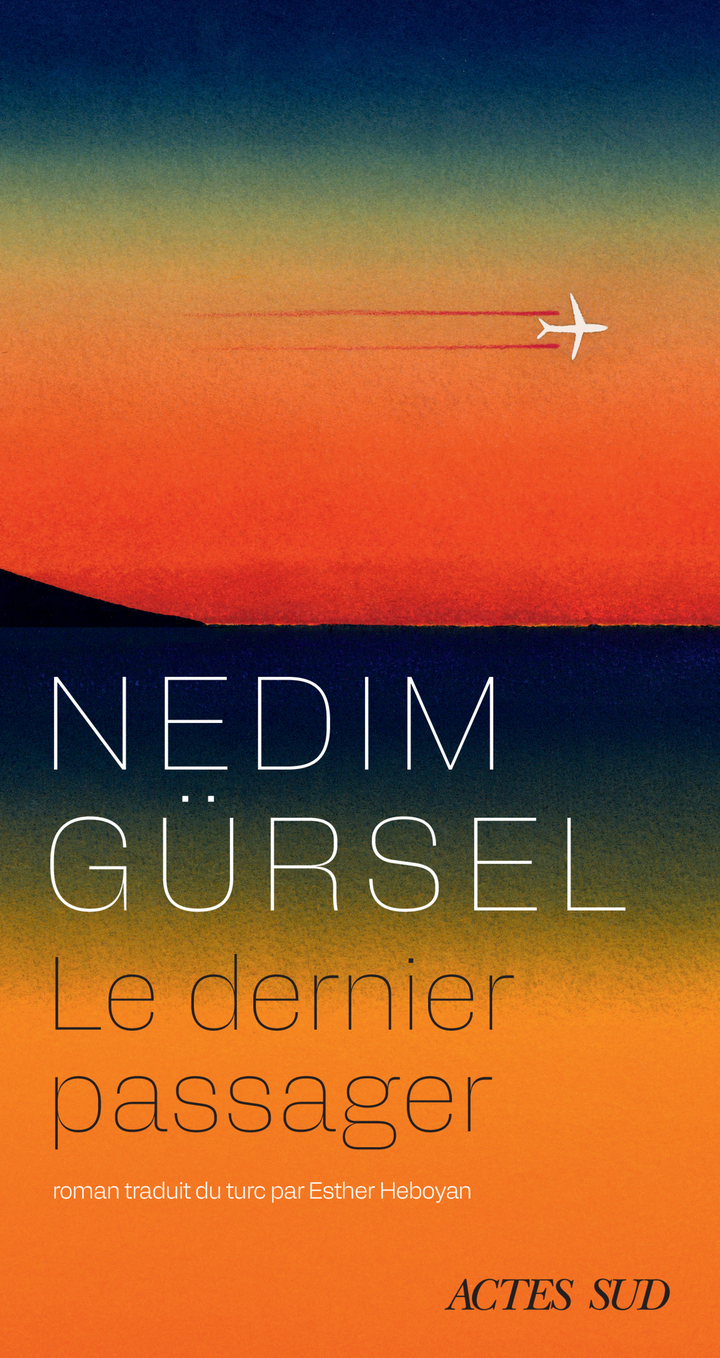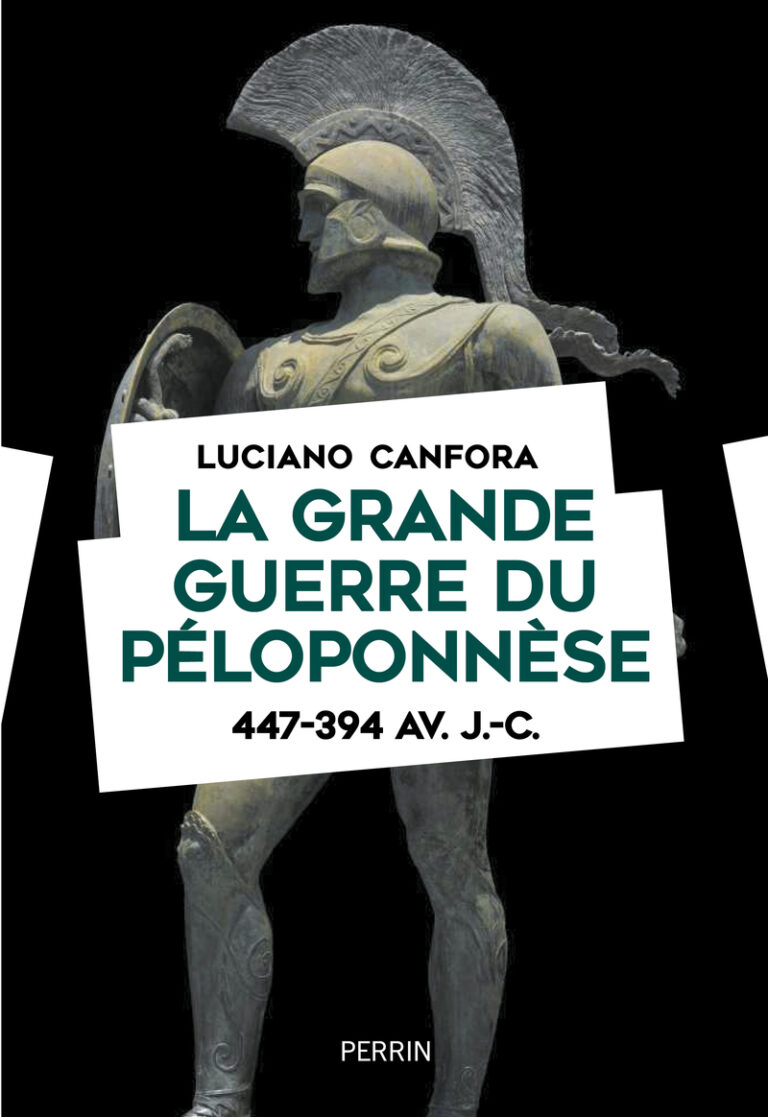Henri Gougaud, De ciel et de cendres, Albin Michel, 29/01/2025, 224 pages, 20,90€
Avant de nous quitter, laissant un vide incontestable dans le paysage littéraire et spirituel, Henri Gougaud avait écrit De ciel et de cendres un roman d’une grande profondeur. L’œuvre, profondément ancrée dans le Pays Cathare qu’il chérissait tant – étant né à Carcassonne en 1936 –, va au-delà de la simple reconstitution historique du Pamiers du XIVe siècle, à l’heure tragique de l’Inquisition. Elle est avant tout une magnifique démonstration de son talent de conteur, un art qu’il maîtrisait dont il était passé maîtret. Ce roman devient un voyage initiatique au cœur de la conscience humaine, un questionnement sur la foi et le doute, la liberté et l’oppression, la mémoire et l’oubli. Dans cette œuvre, l’histoire prend vie, les personnages partagent avec nous la même poussière et la même peur, et l’écriture elle-même se fait un acte de résistance face à l’absurdité du monde. C’est cette alchimie, entre la rigueur historique et la poésie du conteur, que nous allons explorer, tentant de saisir les résonances que cette œuvre continue de provoquer en nous, lecteurs d’aujourd’hui.
La chronique d’une conscience tourmentée
L’ombre de l’inquisition, bras armé de l’Église, s’étend sur la ville de Pamiers et de ses habitants, instaurant un climat de peur et de suspicion. Dans un monde où la dissidence religieuse est perçue comme une menace pour l’ordre établi, le tribunal inquisitorial, théâtre glacial de justice expéditive, devient le centre névralgique d’une lutte impitoyable contre l’hérésie. C’est dans ce contexte oppressant, où les dénonciations anonymes et les murmures étouffés nourrissent la paranoïa collective, que se déploie l’histoire de Jean Jabaud, greffier malgré lui d’une machine judiciaire implacable, témoin des vies brisées et des consciences torturées. Au service de l’évêque Jacques fournier (futur Benoît XII), il incarne le cœur du roman, le prisme à travers lequel nous percevons l’univers complexe et douloureux qui se déploie. Sa position est unique, presque inconfortable : il est au cœur de la machine inquisitoriale. Il assiste aux interrogatoires, aux tortures dont la violence sourde transparaît entre les lignes, aux condamnations prononcées avec une froideur administrative. Il est aussi celui qui consigne, qui met en mots l’indicible, transformant son écritoire en un champ de bataille où s’affrontent la vérité et le mensonge, la foi et le doute, l’espoir et le désespoir. Sa plume, trempée dans l’encre et le doute, devient l’instrument d’une chronique pas comme les autres : celle, souterraine et hésitante, d’une conscience en proie au tourment, loin de la version triomphante des puissants.
Henri Gougaud nous dépeint avec une subtilité remarquable les nuances de cette conscience en crise. Jean n’est pas un héros flamboyant, ni un révolté tonitruant. Il est un homme ordinaire, pris dans les rets d’une histoire qui le dépasse. Sa lucidité est une arme à double tranchant : elle lui permet de démasquer l’hypocrisie et la cruauté de l’Inquisition, mais elle le confronte également à l’absurdité de l’existence, à la vanité des certitudes. Son ironie, parfois grinçante, parfois désabusée, devient un moyen de survivre dans un monde où la raison semble avoir déserté les esprits. Pourtant, derrière cette carapace de scepticisme, on perçoit une tendresse, une humanité profonde, qui se manifeste dans sa compassion pour les victimes de l’Inquisition, son attachement à sa sœur Marie, sa fascination ambiguë pour Jacques Fournier. Jean Jabaud est un personnage complexe, tout en contradictions, à l’image de l’âme humaine elle-même. Sa chronique n’est pas un exposé didactique, mais un cheminement intime, sinueux, parfois douloureux, qui nous invite à nous interroger sur nos propres zones d’ombre, nos propres compromissions, et sur notre capacité à résister à la barbarie. Il est le témoin d’une époque révolue, mais ses questionnements résonnent étrangement avec les nôtres, dans un monde où les certitudes s’effondrent et où la violence, sous des formes nouvelles, continue de menacer notre humanité.
Le tribunal de l’inquisition : théâtre de l’absurde et du tragique
Le tribunal de l’Inquisition, tel que le dépeint Henri Gougaud, se révèle être un espace profondément théâtral, une scène où le pouvoir s’exhibe pour mieux se renforcer et se perpétuer. Il ne s’agit pas lieu de justice, mais d’un dispositif savamment orchestré, une machine à broyer les âmes et à fabriquer du consentement. Ses rouages sont précis et implacables. Les interrogatoires, les procès, les condamnations, tout est régi par un cérémonial précis, un rituel immuable qui frôle la farce macabre. L’auteur décrit les codes, les postures, les silences, les mots soigneusement choisis qui composent cette liturgie inquisitoriale. Il nous fait éprouver l’absurdité de ce système, où la logique est pervertie, où les mots sont vidés de leur sens, où la justice n’est qu’un simulacre, une caricature grotesque de son essence.
Le langage inquisitorial, ampoulé et tortueux, devient une arme redoutable. Il permet de piéger les accusés, de les enfermer dans des contradictions, de les réduire au silence. Les questions sont biaisées, les réponses interprétées à charge, la vérité n’a plus sa place. Ce qui importe, c’est la confession, extorquée par la menace, la peur, la torture. Et ces aveux, arrachés dans la douleur, ne sont que le reflet déformé des peurs et des fantasmes des bourreaux, une construction artificielle sans lien avec la réalité. Henri Gougaud nous montre comment un système, au nom d’une vérité transcendante et indiscutable, se met au service du mal, comment la foi peut se pervertir en fanatisme, comment la justice peut devenir un instrument d’oppression. Le tribunal de l’Inquisition devient ainsi le symbole d’un pouvoir nourri par la peur, le mensonge et la manipulation, un pouvoir qui étouffe la pensée libre et nie l’humanité de ceux qu’il juge et condamne. Ce théâtre de l’absurde résonne étrangement avec certaines dérives contemporaines, où la vérité est relativisée, où la parole est instrumentalisée, où la justice devient parfois un outil politique.
L’humanité face à la machine institutionnelle
Face à la machine implacable de l’Inquisition, les personnages du roman ne se résignent pas au silence ni à la passivité. Au contraire, ils déploient une étonnante capacité de résistance, une diversité de stratégies pour préserver leur humanité et affirmer leur liberté intérieure face à l’oppression. Certains, comme Raimond de Sainte-Foy, incarnent une résistance frontale, héroïque, un refus de se soumettre à l’injustice, même au prix de leur vie. Leur stoïcisme, leur dignité face à la torture et à la mort, sont des témoignages poignants de la force de l’esprit humain. D’autres, comme Pierre Clergue, le curé de Montaillou (hommage à Emmanuel le Roy Ladurie), choisissent une résistance plus souterraine et ambiguë, une forme de compromission qui leur permet de survivre tout en préservant tant bien que mal leur humanité. Ils jouent double jeu, naviguent entre les lignes, tentent de sauver ce qui peut l’être, même au prix de leur propre perte. D’autres encore, comme Béatrice de Planissolles, incarnent une résistance par l’évasion, par la recherche d’espaces de liberté et de refuges où l’amour, le désir et la vie peuvent encore s’épanouir. Leur fuite, leur errance, leur quête d’un ailleurs deviennent des métaphores de la difficulté de vivre libre dans un monde oppressant.
Et puis il y a Jean Jabaud, le narrateur, qui incarne une forme de résistance plus subtile, plus intérieure, mais non moins essentielle : celle de la conscience. Il observe, il témoigne, il écrit, et refuse de se laisser engloutir par la barbarie ambiante. Il est le gardien de la mémoire, celui qui préserve les traces fragiles des vies brisées, celui qui refuse que l’oubli recouvre les souffrances et les injustices. Son écriture devient un acte de résistance en soi, une tentative de donner sens à l’absurdité du monde et de préserver la flamme fragile de l’humanité. Dans ce roman sombre, l’amour, sous toutes ses formes, apparaît comme une force vitale, un antidote à la haine et à la violence. L’amour courtois, l’amour charnel, l’amour fraternel, l’amour filial, tous ces liens qui nous unissent aux autres forment des remparts contre la déshumanisation. Ils témoignent que, même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière peut encore jaillir et que l’espoir peut renaître.
La mémoire contre l’oubli
De ciel et de cendres n’est pas un roman qui apporte des réponses faciles, ni qui nous offre une vision optimiste de l’histoire humaine. Au contraire, il nous confronte à la part d’ombre qui est en nous, à notre capacité au pire, à notre vulnérabilité face aux systèmes de pouvoir. Mais c’est aussi un roman qui nous parle de la force de la conscience, de la beauté fragile de l’humanité, de la nécessité de se souvenir pour ne pas répéter les erreurs du passé. Henri Gougaud, avec son talent de conteur, nous a offert une œuvre bouleversante qui nous hante longtemps après l’avoir refermée. Il nous invite à ne jamais oublier, à rester vigilants, à défendre, coûte que coûte, la flamme fragile de l’humanité, car c’est peut-être là, dans cette mémoire vive, dans cette conscience en éveil, que réside notre seule véritable chance de salut. Et dans le silence que son absence laisse derrière lui, il est réconfortant d’imaginer qu’Henri Gougaud a désormais rejoint Bélibaste, le dernier Parfait Cathare qu’il avait si merveilleusement narré dans son plus célèbre roman, trouvant enfin, peut-être, les réponses aux questions qui l’ont si longtemps habité…