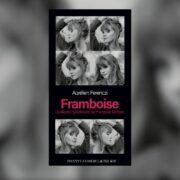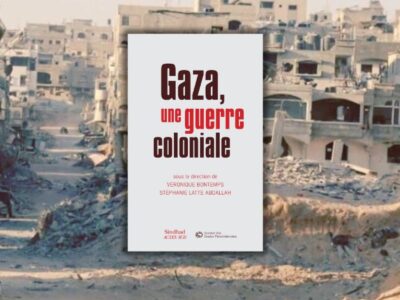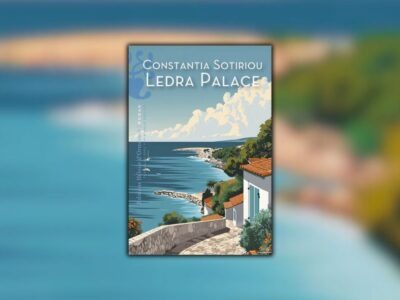Kim Fu, Cinq filles perdues à tout jamais, traduit de l’anglais par Annie Goulet, Héliotrope, 31/05/2024, 371 pages, 20€
Dès les premières pages, Kim Fu nous plonge dans l’atmosphère idyllique, presque trop parfaite, du camp de vacances Forevermore. Sous un ciel d’un bleu azur “qui n’a pas changé depuis six décennies”, des filles enjouées chantent l’hymne de la sororité, vêtues de leurs gilets de sauvetage orange, prêtes à se lancer à la conquête de la nature et de leur propre identité. On perçoit pourtant, dans le détail – “fermoirs brisés”, “coutures défaites” –, les failles sous ce vernis d’innocence, prémices d’une déroute à venir. L’expédition en kayak, présentée comme le point culminant de leur séjour, devient le moment de bascule, là où l’harmonie manufacturée s’abîme au contact du réel : “Ces fillettes âgées de neuf à onze ans y arrivaient turbulentes et capricieuses, et en repartaient compétentes et averties, de parfaites amatrices de plein air remodelées par la saine expérience de la nature et de la sororité.”
L’écriture réaliste et sans fioritures de Kim Fu saisit l’ordinaire et l’enthousiasme juvénile de ces jeunes filles, le mélange de compétition et de complicité – les bracelets d’amitié tressés, les alliances fluctuantes, le regard aiguisé qu’elles posent sur les corps et les personnalités – et l’inexpérience fondamentale qui les rend si vulnérables, proies faciles d’un destin capricieux
Échos de l'île : mémoires éclatées et miroirs déformants
La disparition inexpliquée de Jan et la violence des éléments laissent des traces indélébiles dans l’âme des survivantes. Plutôt que de brosser le récit chronologique de leur périple et d’insister sur les exploits – cueillette, pêche, fabrication d’un abri –, l’auteur opte pour un procédé audacieux : une narration éclatée où le récit fragmenté des quatre femmes s’interrompt et se reconfigure. Chacune des voix – Dina, Nita, Andee/Kayla et Isabel – porte le fardeau d’une histoire unique, la trace impalpable de leur épreuve fondatrice qui ressurgit à la manière d’un leitmotiv.
C’est par ce savant montage narratif que l’auteur nous conduit au cœur du trauma : le lecteur explore non pas le récit objectif et ordonné d’un événement révolu – comment tout s’est réellement déroulé, étape par étape – mais l’expérience subjective et fluctuante du souvenir, tel que reconfiguré par le temps et par l’impact profond que l’accident a eu sur leurs choix de vie. On peut aussi y lire la force inexorable d’une vision du monde : “C’était une humiliation floue, impossible à dénoncer, peut-être créée de toutes pièces.”
Le doute au cœur du récit
Chaque chapitre s’avère une pièce d’un puzzle dont l’image reste volontairement incomplète. L’absence d’un narrateur omniscient – la vision des monitrices, les motivations de Jan – laisse un vide vertigineux. Le lecteur doit interpréter, combler les lacunes et construire ses propres conclusions à partir de bribes d’informations éparses, d’indices troublants et des mémoires divergentes qui se répondent et se confrontent tout au long du récit. Ainsi, le doute plane sans cesse : les filles ont-elles réagi adéquatement face aux dangers, ont-elles commis des erreurs ? Pourraient-elles avoir mieux fait ? Ont-elles sciemment agi par sadisme ? Se sont-elles entraidées autant que l’histoire officielle le laisse entendre ? À travers ce procédé narratif, le lecteur lui-même se voit confronté au pouvoir du récit : quelle version croire ? Quelle importance, au bout du compte ? Ne peut-on concevoir l’abîme entre mémoire et réalité, trauma et reconstruction comme un élément essentiel de l’existence ?
L’impact du séjour à Forevermore sur la vie des femmes oscille entre refoulement, répétition de schémas, souveraineté retrouvée et culpabilité impalpable. Dina, convaincue que ses dons auraient pu la mener vers la célébrité, échoue à faire le lien entre ambition et effort, rebondissant de plan foireux en contrat douteux sans oser se remettre en question, jusqu’à l’imposture pathétique de sa brève carrière hollywoodienne, là où même le soleil est trop intense. L’écriture crue et ironique de Kim Fu saisit le ridicule et l’indignation de cette femme incapable d’embrasser la réalité : “La lumière du jour entrait timidement par une fenêtre rectangulaire percée haut dans le mur, mais ils arrivaient à peine à distinguer les traits de leurs visages.”
La fuite en avant d’Andee – “Kayla Allen, la fille qu’il faudrait prendre en pitié” – se transforme en piété obsessionnelle et en soumission masochiste : un désir compulsif de purification pour contrer le “péché originel” et le mauvais sort qu’elle s’inflige en s’unissant aux hommes dans un mariage sans amour. Ses efforts constants pour se rendre utile – ses chansons au ukulélé au café, sa vie quasi monacale à l’église –, s’apparentent davantage à la recherche d’une protection contre un destin violent et erratique qu’à un réel dévouement à Dieu, et ce besoin fondamental sera exploité par Éric, cet ersatz de prêtre à la figure “messianique“. Il devient, à ses yeux, le phare qui éclaire les ténèbres, un reflet inversé de Jan agonisant en silence : “Kayla avait attendu une éternité, s’était soumise de toutes les manières imaginables.”
Quant à Isabel – “elle avait à peu près la taille d’une élève de maternelle” –, la passivité qui lui permet de survivre à l’île, d’abord comme “spectatrice” du groupe puis auprès du cadavre de Jan, lui rendra possible sa succession d’amours médiocres : “Son attirance pour Elliott se teintait maintenant d’envie. Elle enviait sa fougue, son talent, son obstination.”
Son indifférence et sa propension à se camoufler, son silence stratégique se nourrissent d’une dévalorisation impitoyable dont l’ampleur étonne autant qu’elle répugne : une existence définie par l’absence de résistance. Elle ne lutte plus, ne combat ni le sort qui lui est infligé par les hommes ni les marques d’affection vides de sa famille et amies ; elle encaisse. Un lecteur généreux pourrait lire sa force dans sa résignation ; un lecteur cynique, un abject abandon. Dans les deux cas, Isabel s’avère aussi opaque qu’inoubliable.
Nita, la cheffe incontestée et tourmentée du groupe sur l’île, – “Nita Prithi, à la manière d’un petit caïd en prison” – s’attache à une rationalité désespérée pour trouver l’ordre au chaos. La douleur, les émotions complexes, toute manifestation de fragilité sont perçus comme des obstacles au bon fonctionnement du groupe, et Nita, de son air imperturbable, de ses yeux noirs “qui semblaient la traverser”, cherche des réponses rationnelles et refuse tout recours à l’imagination : “Le bureau était décoré de messages édifiants écrits sur des soleils de carton jaune, dans une calligraphie faite de boucles amples bien lisibles pour les enfants. L’ironie n’avait pas sa place ici.”
À travers l’amertume croissante, les limites auto imposées, l’amour sans émoi – d’un chien obsessionnel, d’un mari et enfants parfaits, interchangeables – , le récit de Nita évoque l’écho funeste d’un camp devenu lieu de contrôle absolu, un paradis utopique se révélant plus sinistre encore à l’âge adulte : la vie même comme un terrain clôturé sans porte de sortie.
Le malaise cinématographique au cœur du roman
Au-delà de l’analyse psychologique des femmes et des interprétations possibles de leurs destins – jusqu’à quel point les personnages peuvent être lus comme responsables, complices ou victimes de leurs expériences ? –, l’intérêt fondamental de l’œuvre réside dans le traitement du trauma et son expression à travers une forme narrative ingénieuse.
L’impression obsédante qui émane du roman n’est pas due aux descriptions horrifiques d’un passé révolu mais aux résonances implicites qui se répercutent d’un personnage à l’autre, d’une époque à l’autre : les détails frappants qui nous font sursauter. La lame brillante d’un couteau qui refait surface sous des formes diverses. Le rappel obsessionnel de ce qui n’est plus comestible. La chaleur d’un baiser fraternel se mutant en étreinte possessive et meurtrière. On pourrait rapprocher cette construction aux mécanismes complexes et déstabilisants des Mondes parallèles de David Lynch, ou encore à l’atmosphère sinistre et glauque des contes cruels de Flannery O’Connor. L’exploration des liens forgés dans l’adversité et leur impact indélébile sur les vies brisées – la force impalpable de la communauté et ses limites –, c’est peut-être là la leçon la plus poignante de Cinq filles perdues à tout jamais.

NOS PARTENAIRES
Faire un don
Vos dons nous permettent de faire vivre les libraires indépendants ! Tous les livres financés par l’association seront offerts, en retour, à des associations ou aux médiathèques de nos villages. Les sommes récoltées permettent en plus de garantir l’indépendance de nos chroniques et un site sans publicité.