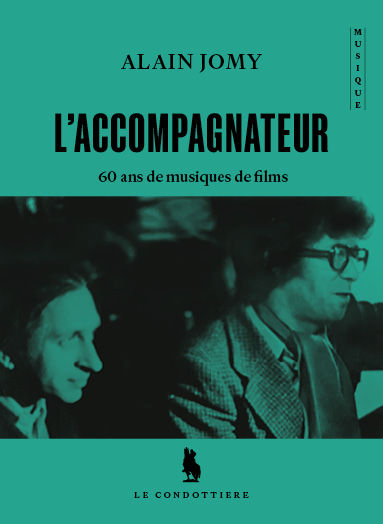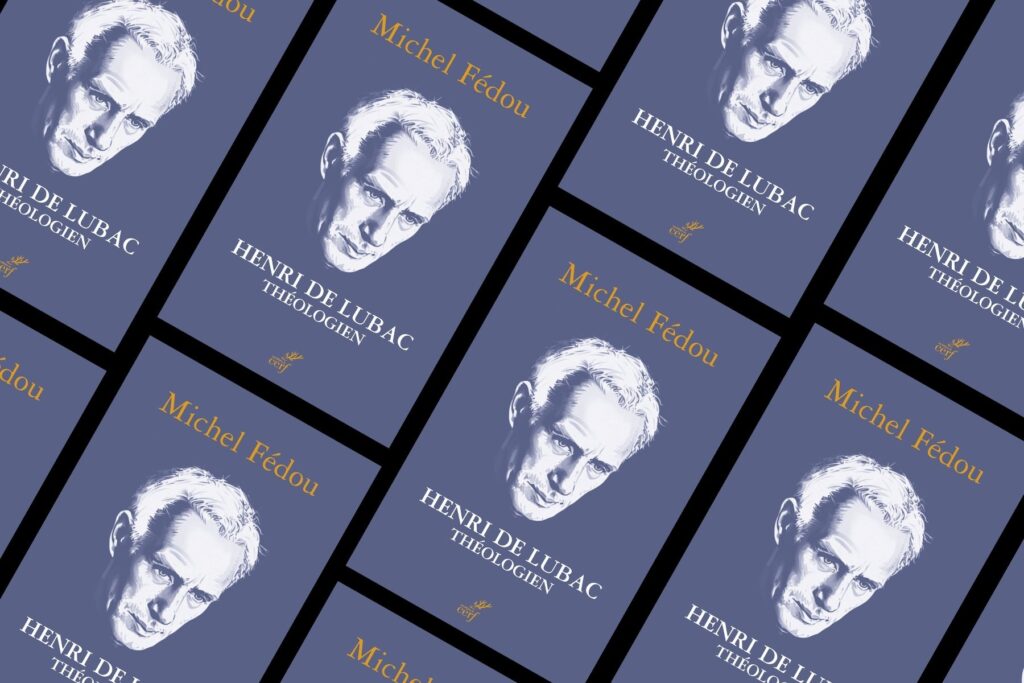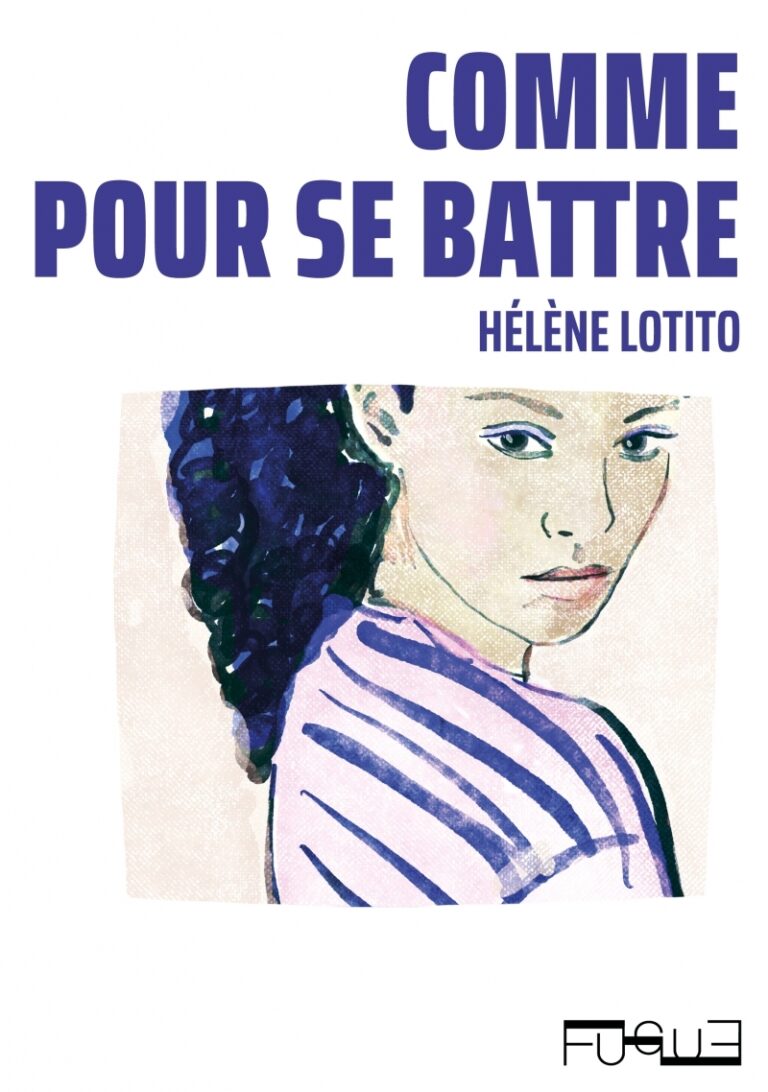Jean-Noël Robert, L’Éducation des jeunes Romains au temps de Cicéron, Les Belles Lettres, 22/08/2025, 240 pages, 23 €
Comment fabrique-t-on un Romain ? De la première berceuse grecque chantée par la nourrice jusqu’à la conquête du Forum par l’éloquence, le chemin initiatique du jeune Romain était une entreprise totale. C’est ce parcours que Jean-Noël Robert, latiniste et historien de la Rome antique, recompose avec un œil tantôt affectueux, tantôt acéré. Son ouvrage, L’Éducation des jeunes Romains au temps de Cicéron, s’impose comme une archéologie sensible des gestes, des mots et des rites qui, tous, concouraient à façonner une figure sociale idéale, largement aristocratique : le citoyen.
La chair et le marbre : sculpter le jeune citoyen
L’ouvrage de Jean-Noël Robert nous introduit d’abord au seuil de la domus, temple sacré et premier théâtre d’une autorité sans partage. C’est là que le jeune Romain se construit, dans un silence empreint de codes implicites. La pédagogie initiale se déploie par une immersion sensorielle et hiérarchique : le corps de l’enfant, cet être inachevé, infants (celui qui « ne prononce pas encore de paroles sensées »), devient la première matière à sculpter.
Cette formation est autant une caresse qu’une contrainte. La discipline physique, de l’emmaillotage rigoureux qui modèle les membres aux coups de la férule qui cinglent les mains, forge une maîtrise de soi essentielle. C’est par cette rigueur corporelle que se préfigure la grauitas (dignité, sérieux) du futur citoyen. La nourrice, souvent grecque, insuffle les premières mélodies, colorant déjà son oreille d’une culture qui sera plus tard un outil de distinction pour l’élite. Sous le regard vigilant du pater familias, grand-prêtre du culte domestique, l’enfant imite et reproduit les gestes rituels. Chaque mouvement, de la manière de franchir un seuil à la posture adoptée en public, grave en lui une grammaire de l’appartenance et une intégration silencieuse des hiérarchies.
Le Verbe et la Toge : quand la République dompte ses démons
À mesure que le récit avance, Jean-Noël Robert tisse une fresque complexe où les enjeux de cette formation se révèlent dans leur ampleur politique. Le passage de l’enfance à l’adolescence est magnifié par le rite de la prise de toge virile, cet acte symbolique qui arrache le jeune homme à l’univers domestique pour le projeter dans la lumière du Forum.
Cette entrée dans la vie civique est précédée par d’autres rites initiatiques, d’une sauvagerie maîtrisée, tels que les Lupercales, où de jeunes aristocrates nus et couverts de sang purifient la cité. L’ordre civique se nourrit paradoxalement de ce chaos primordial : en le canalisant rituellement, la cité réaffirme sa capacité à dominer les forces brutes.
Le long détour de la transmission s’organise alors. De l’école buissonnière où le magister inculque les rudiments, aux classes plus sélectes des grammairiens et des rhéteurs, se dessine une cartographie de l’autorité par le verbe. L’objectif ultime est l’eloquentia : maîtriser Homère, savoir articuler un discours, constitue le ciment invisible des hiérarchies et l’arme politique par excellence.
L’ouvrage expose le duel de titans qui se joue entre l’éducation traditionnelle, incarnée par un Caton pour qui le père est le seul précepteur légitime, et l’ouverture à l’hellénisme. Ici, la figure de la mère, loin de se réduire à « un ventre », peut jouer un rôle décisif. Cornélie, mère des Gracques, forme ses fils par la seule pureté de son langage. D’un côté la vertu rustique, de l’autre la culture raffinée ; deux visions de l’homme s’affrontent, révélant les fractures d’une République traversée par des questions de virilité, d’autorité et d’appartenance.
La troublante leçon de Rome
En refermant l’ouvrage, le lecteur comprend que l’éducation romaine constitue une puissante pédagogie de l’incorporation. Elle vise moins à instruire qu’à former, moins à remplir les esprits qu’à façonner les corps et les consciences pour qu’ils incarnent leur rang social.
L’analyse que propose Jean-Noël Robert, riche et nuancé, interroge la portée universelle de ce modèle. L’éducation romaine apparaît comme un système redoutablement efficace pour produire des administrateurs capables de gouverner un empire, mais elle expose également les fondements d’une société qui érige l’inégalité en principe et la parole en instrument de pouvoir. Les leçons implicites qui traversent ce livre résonnent avec une acuité particulière aujourd’hui. Pour Jean-Noël Robert, ce retour aux sources n’est pas un simple exercice d’érudition ; c’est un miroir philosophique tendu à nos propres crises éducatives, comme il l’explore dans ses réflexions contemporaines telles que Témoin de la déséducation nationale (2017).
À l’heure où les systèmes éducatifs cherchent leur boussole, Rome nous renvoie l’image d’une civilisation qui avait ordonné sa pédagogie tout entière autour d’une idée claire du citoyen qu’elle souhaitait voir advenir. Cette architecture formative, dans sa rigueur et sa logique implacable, constitue peut-être la plus profonde et la plus troublante des leçons romaines.