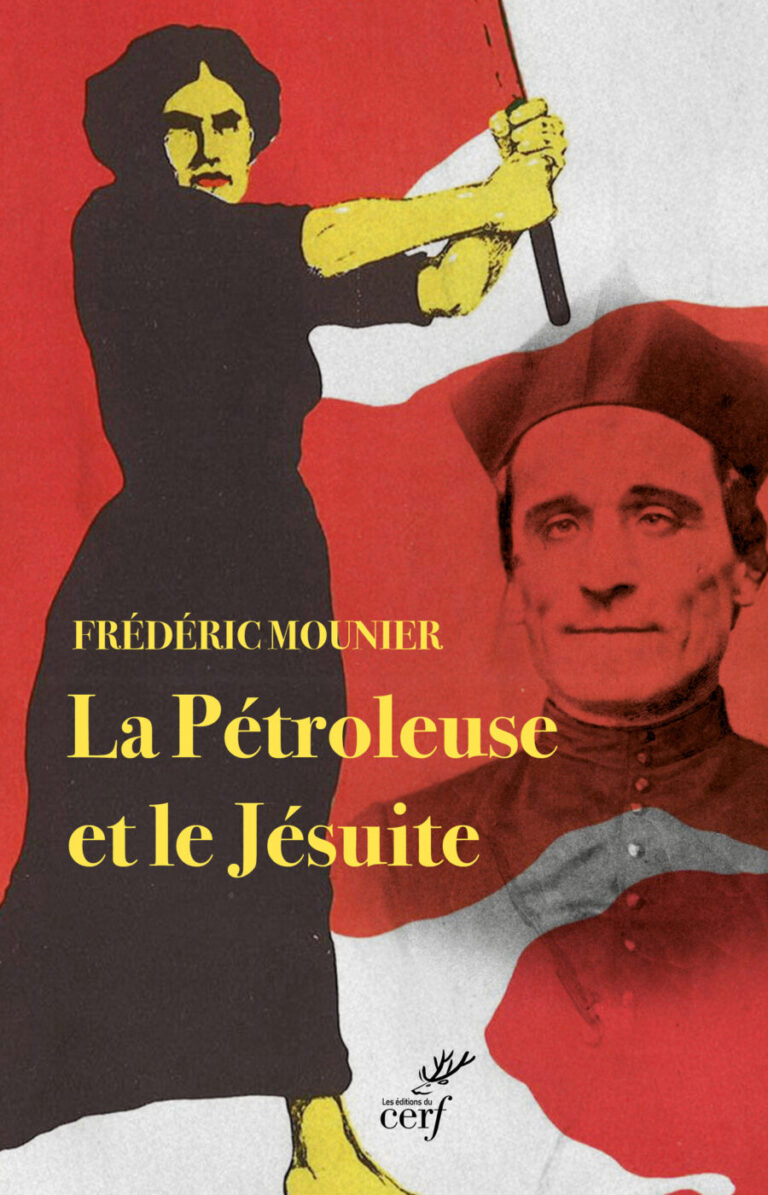Alain Dieckhoff (dir.), Radicalités religieuses. Au cœur d’une mutation mondiale, Albin Michel, 08/10/2025, 352 pages, 24,90€
Dans le fracas d’un monde où les anciennes certitudes politiques se délitent, où la globalisation redessine les appartenances et les frontières, un spectre que la modernité triomphante croyait avoir relégué aux marges de l’Histoire revient hanter le présent : celui du religieux intransigeant, armé d’absolus et de ferveurs exclusives. Des rives du Gange aux plaines du Midwest américain, des collines de Judée-Samarie aux mégapoles nigérianes, une même houle semble enfler, charriant des colères sacrées, des projets de refondation et des violences purificatrices. C’est à cet immense et complexe mouvement de fond que se consacre Radicalités religieuses, ouvrage collectif magistralement dirigé par Alain Dieckhoff. Dépassant de très loin le catalogue de fanatismes exotiques, ce volume déploie une analyse rigoureuse et polyphonique des radicalités comme symptôme et moteur d’une mutation tectonique du religieux à l’échelle planétaire, éclairant avec une acuité et une ambition rares les dynamiques qui, sous des latitudes et des formes diverses, attestent la recomposition profonde des liens entre foi, politique et identité. C’est une œuvre, qui s’impose d’emblée comme une contribution décisive sur l’un des phénomènes les plus cruciaux de notre temps.
Ce faisant, l’ouvrage offre un prisme analytique indispensable pour quiconque cherche à naviguer les eaux troubles du XXIe siècle, en articulant les savoirs croisés de la sociologie des religions, de la science politique, de l’histoire contemporaine, et une connaissance intime des terrains, qu’ils relèvent de l’étude du fondamentalisme, de la sécularisation, de la violence symbolique ou physique, des nationalismes, du catholicisme et du protestantisme, des mondes orthodoxes, juif, musulman, hindou ou bouddhiste, ainsi que des dynamiques propres à l’Afrique, à l’Asie, aux Amériques, à l’Europe et au Moyen-Orient.
L’atelier intellectuel d’une cartographie raisonnée
L’entreprise, portée par l’un des plus fins connaisseurs du fait national et religieux, Alain Dieckhoff, s’ancre dans la vitalité exceptionnelle de la recherche française sur ces questions, cristallisée autour d’institutions comme Sciences Po, son Centre de recherches internationales (CERI), l’Observatoire international du religieux, et des initiatives structurantes tel le projet ReligiS de l’Université de Strasbourg. Cette généalogie intellectuelle confère à l’ouvrage sa colonne vertébrale : une alliance constante entre rigueur conceptuelle et profondeur empirique. Le projet s’articule en une progression d’une grande clarté. Trois chapitres transversaux posent d’abord les cadres d’analyse, explorant les deux grandes formes de la radicalité religieuse – se retirer du monde ou prendre le pouvoir –, les ressorts complexes de la violence commise “au nom de la religion” et, enfin, l’entrelacement sémantique et passionnel du nationalisme, de la religion et de l’ethnicité. Une quinzaine de monographies déploient ensuite cette grammaire sur des terrains aussi variés que le Brésil, l’Iran, le Myanmar ou Israël, offrant un panorama mondial d’une ampleur inédite. Cette architecture, constitue un choix méthodologique audacieux : elle forge une grammaire commune pour penser des phénomènes hétérogènes, tout en laissant chaque cas d’étude éprouver, nuancer, voire mettre en crise les typologies initiales.
Une fresque mondiale, de la ferveur à la fureur
Le véritable tour de force de Radicalités religieuses réside dans sa composition, qui parvient à faire entendre une polyphonie structurée sans jamais céder à la dispersion. Le souci de la nuance et la clarté de l’exposition permettent de saisir les tensions internes qui travaillent chaque acteur, qu’il s’agisse de militants, de fidèles ordinaires, de clercs ou de responsables politiques. Le volume déploie ainsi une fresque impressionnante des radicalités chrétiennes contemporaines, avec les analyses de Denis Pelletier sur les recompositions catholiques post-vaticane II, d’Olivier Roy sur la montée d’un identitarisme chrétien irréligieux en Europe, de Denis Lacorne sur les ressorts du nationalisme chrétien aux États-Unis, de Marcelo Ayres Camurça sur la droite évangélique ultraradicale au Brésil, et de Kathy Rousselet sur les usages politiques de la radicalité orthodoxe dans la Russie post-soviétique. Alain Dieckhoff explore lui-même les configurations complexes des radicalités juives en Israël, entre le monde clos de l’ultra-orthodoxie, le messianisme conquérant du sionisme religieux et le suprémacisme du kahanisme. L’ouvrage cartographie avec la même précision l’archipel foisonnant des radicalités musulmanes, avec les chapitres de Stéphane Lacroix sur la distinction entre islamisme et salafisme en Égypte et en Arabie saoudite, de Stéphane Dudoignon sur la révolution religieuse iranienne et ses métamorphoses, de Bayram Balci sur la difficile marche turque entre nationalisme et islamisme, de Brahim Afrit sur le dialogue compétitif de l’évangélisme et du salafisme en Afrique de l’Ouest, d’Amélie Blom et Aminah Mohammad-Arif sur le renouveau islamique en Asie du Sud, d’Adam Baczko sur l’itinéraire des Taliban, ou encore de Mohamed-Ali Adraoui sur les transnationalismes pluriels des jihadismes. Le tableau est complété par les analyses des mondes religieux orientaux, avec Christophe Jaffrelot qui décortique la création d’une nouvelle forme “d’État profond” par les nationalistes hindous en Inde, et Niklas Foxeus qui se penche sur les mouvements nationalistes bouddhistes au Myanmar. En juxtaposant ces cas, le livre ne se contente pas de les décrire ; il les met en tension, et c’est dans cet agencement savant que se révèle sa puissance analytique, éclairant des logiques communes là où l’on ne voyait que des particularismes irréductibles.
Au-delà des fanatismes, le miroir de nos modernités
Par-delà la richesse de chaque étude de cas, l’ouvrage tisse une toile conceptuelle qui lui confère toute sa portée. Une ligne de force, brillamment tracée par Alain Dieckhoff, structure l’ensemble du propos : la distinction heuristique entre deux formes de radicalité. D’une part, une radicalité “piétiste”, qui opte pour le retrait du monde, la constitution de bastions de la foi et de communautés séparées pour préserver une identité jugée menacée par la modernité séculière. De l’autre, une radicalité activiste, qui entend au contraire prendre le pouvoir, transformer la société de gré ou de force, et édifier des États religieux ou des nations organiquement liées à une tradition spirituelle. “Se retirer du monde ou prendre le pouvoir : les deux formes de radicalité religieuse”, tel est le dilemme qui traverse, sous des formes infiniment variées, l’ensemble des cas étudiés. Cette tension fondamentale, dont les auteurs reconnaissent eux-mêmes le caractère idéal et la fluidité sur le terrain, révèle que ces mouvements, loin d’être des archaïsmes, sont des réponses hyper-modernes aux crises de la modernité.
Immigrés, minorités sexuelles, intellectuels : comment les radicalités religieuses fabriquent leurs ennemis
L’ouvrage éclaire avec une force remarquable la manière dont ces radicalités s’érigent en critiques acerbes des sociétés individualistes, perçues comme une entité adverse commune : “la société des individus, coupée de toute transcendance”. Elles puisent leur énergie dans le rejet d’une modernité libérale accusée de dissoudre les liens traditionnels, les hiérarchies morales et les identités collectives. En cela, leur essor est indissociable des dynamiques politiques contemporaines que sont la montée des populismes illibéraux, les guerres culturelles et les crispations autour des politiques du genre, qui agissent comme des catalyseurs et des révélateurs de ces tensions. L’ouvrage, notamment à travers les réflexions subtiles de Denis Pelletier sur la “violence perpétrée au nom de la religion, au nom du religieux”, déplie également la psychologie complexe des acteurs et ses implications politiques : comment la violence est-elle justifiée, ritualisée ou contenue ? Quelles nouvelles formes d’autorité religieuse émergent-elles, souvent en marge ou contre les institutions établies ? Et comment la fabrication d’ennemis – qu’il s’agisse de l’immigré, de la minorité sexuelle, de l’intellectuel cosmopolite ou du croyant jugé hétérodoxe – devient-elle un instrument central de mobilisation ?
Pourquoi “Radicalités religieuses” est une référence incontournable
Radicalités religieuses ne se contente pas de documenter des crises locales ; il articule des phénomènes épars pour faire apparaître le dessin d’ensemble d’une mutation globale. Ce que l’ouvrage donne à voir, c’est un monde où la religion devient une ressource politique et identitaire de premier plan, capable de mobiliser des passions intenses et de redéfinir les contours du pouvoir. Cette cartographie des radicalités, déployée à travers une pluralité d’échelles et une attention constante au terrain, est un outil intellectuel d’une puissance rare pour comprendre les fractures qui travaillent les sociétés contemporaines. Elle révèle un monde en quête de repères, traversé par une nostalgie de la transcendance qui peut engendrer aussi bien la construction d’enclaves pacifiques que l’explosion de violences eschatologiques.
Par la richesse de ses analyses et l’ampleur de son ambition comparative, cet ouvrage-somme s’impose comme une référence incontournable pour saisir un futur fragmenté où les dieux, loin d’avoir déserté, manifestent une colère bien terrestre. Au-delà du spectacle assourdissant des fanatismes, Radicalités religieuses nous offre la clé d’une symphonie plus secrète, celle d’une humanité qui, dans sa quête éperdue de sens, réinvente le visage ardent et parfois terrible du sacré.