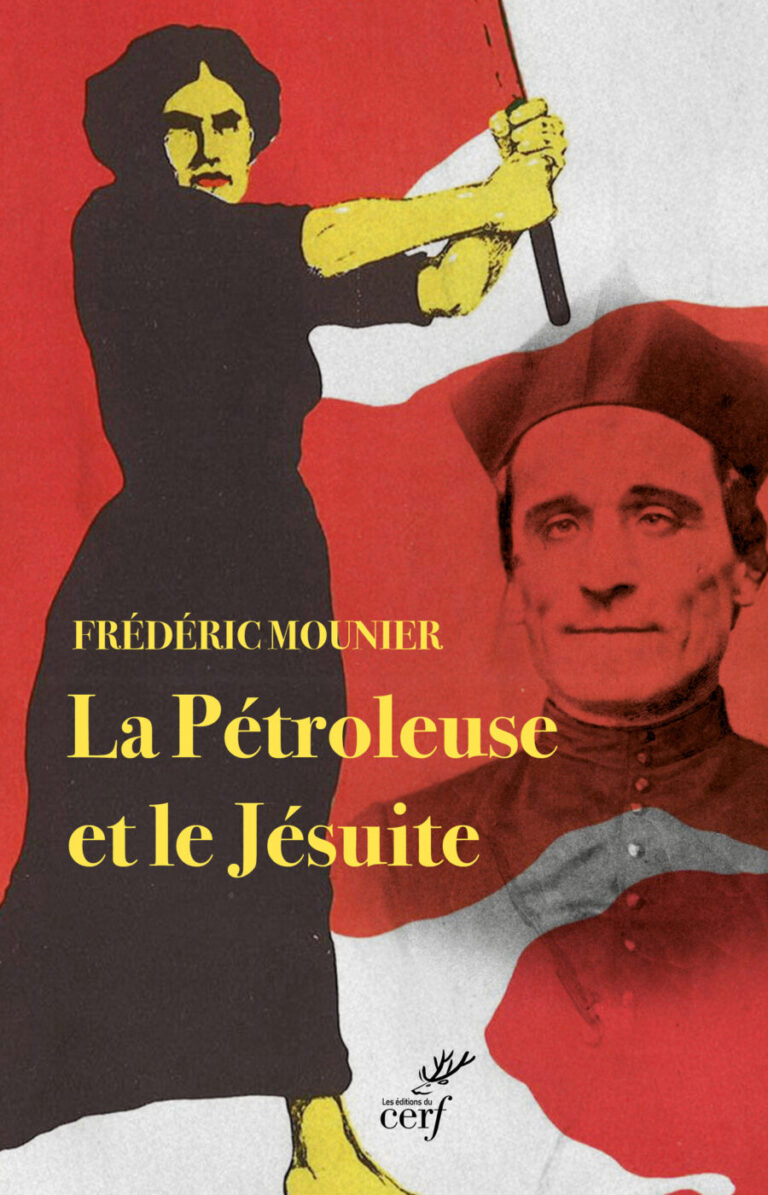Mahmoud Darwich, État de siège, traduction d’Elias Sanbar, Actes Sud, 01/10/2025, 96 pages, 16€
Ramallah, janvier 2002. Tandis que les chars israéliens encerclent la ville palestinienne, Mahmoud Darwich compose État de siège, œuvre qui transcende le témoignage immédiat pour atteindre une portée métaphysique. Ce recueil fragmentaire, traduit par Elias Sanbar, n’est ni reportage versifié ni propagande militante : c’est une interrogation radicale sur ce que signifie exister quand l’espace se rétrécit jusqu’à l’asphyxie et que le temps se fige dans l’attente. Mahmoud Darwich, héritier de la tradition poétique arabe classique et lecteur des modernistes occidentaux, forge ici une langue nouvelle, capable de dire l’indicible du siège. Entre lyrisme amoureux et ironie désenchantée, entre adresse aux bourreaux et dialogue avec les morts, ce poème-fleuve compose une cartographie inédite de la résistance, où écrire devient l’ultime acte de liberté face à l’enfermement.
Comment Mahmoud Darwich transforme la guerre en récit poétique
L’écriture d’État de siège s’inscrit dans le moment le plus violent de la deuxième Intifada. Le blocus de Ramallah en janvier 2002 n’est pas qu’une opération militaire : il vise l’étouffement systématique d’une population civile, la destruction de son infrastructure culturelle, l’effacement de ses traces historiques, prélude au génocide futur. Mahmoud Darwich écrit depuis l’œil du cyclone, mais refuse la posture victimaire. Son poème devient archive vivante d’un présent qui menace de disparaître, tout en s’inscrivant dans une généalogie qui remonte à Job et traverse l’Iliade. “Ici, après les poèmes de Job, nous n’attendions plus personne…” : cette ouverture situe d’emblée le siège palestinien dans la longue durée des catastrophes humaines, établissant un dialogue entre l’ancien et l’actuel, le mythique et le politique.
Le contexte immédiat imprègne chaque vers : “Nos pertes : entre deux et huit martyrs / Par jour, / Dix blessés, / Vingt maisons“. Cette comptabilité macabre témoigne d’une réalité statistique, mais le poète ne s’y arrête pas. Il prolonge : “Sans oublier le déséquilibre structurel qui / Frappera le poème, la pièce de théâtre et le tableau inachevé“. En ajoutant les pertes culturelles aux pertes humaines, le poète souligne que le siège vise
Le poète qui écrivait en fragments pour ne pas se taire
La fragmentation constitue le principe organisateur du recueil. Les 93 sections numérotées forment une mosaïque où chaque fragment fonctionne simultanément comme unité autonome et comme pièce d’un ensemble. Cette architecture morcelée mime la désintégration de la vie quotidienne sous occupation, où toute continuité devient impossible. Contrairement à Paul Celan dont la langue se brise sous le poids de la Shoah, ou à Nazim Hikmet qui maintient une narration carcérale cohérente, Mahmoud Darwich choisit la discontinuité assumée comme forme esthétique de résistance.
Le registre oscille entre plusieurs tonalités. Le lyrique traverse les sections consacrées à l’amour : “Si tu n’es pas pluie, mon amour, / Sois arbre / Fécond… Sois arbre“. Ces anaphores créent un rythme incantatoire qui évoque les litanies bibliques tout en les détournant vers l’érotique. L’ironique surgit dans les moments les plus sombres : “Si le ciel était réel“, dit un passant entre deux obus. Cette distance critique empêche toute récupération sentimentale de la souffrance. Le dialogue enfin structure de nombreux passages, avec ces interpellations directes aux soldats, aux martyrs, aux critiques littéraires, instaurant une polyphonie qui refuse la voix unique du témoin héroïque.
La métaphore chez Mahmoud Darwich ne décore pas : elle pense. Quand il écrit “Dans le siège, le temps devient espace / Pétrifié dans son éternité“, il ne cherche pas l’effet poétique, mais formule une expérience phénoménologique du blocus. L’attente transforme effectivement la temporalité en spatialité : on ne vit plus dans la succession des jours mais dans la contraction d’un espace qui se referme. Cette métaphore conceptuelle rappelle les intuitions d’Anna Akhmatova dans Requiem, où l’attente devant les prisons staliniennes devenait ontologie.
Nous avons un seul but, un seul : Être
La résistance du poète palestinien échappe aux catégories conventionnelles. Elle n’est ni héroïque ni désespérée, mais quotidienne et presque banale : “Nous cultivons l’espoir” comme on cultive des légumes. Cette banalisation de l’héroïsme constitue un geste politique radical : refuser l’exceptionnalité, c’est refuser que l’occupation devienne la norme. Le poème insiste : “Nous avons un seul but, un seul : / Être“. Cette ontologie minimale – simplement être – devient maximaliste dans un contexte qui nie cette existence même.
Le traitement du martyre révèle la complexité éthique du poète. Loin de l’exaltation, il donne voix au martyr qui l’assiège, le questionne, le met face à ses responsabilités : “Où étais-tu ?“. Le martyr de cet homme n’a pas cherché les “vierges de l’éternité” mais “la vie / Sur terre, entre les pins et les figuiers“. Cette désacralisation du sacrifice retourne contre elle-même la rhétorique du martyre islamique, tout en maintenant la dignité de ceux qui meurent. Nulle autre poésie de guerre n’atteint cette subtilité dialectique.
L’humanisation de l’ennemi constitue le geste le plus audacieux. Mahmoud Darwich s’adresse aux soldats : “Nous pourrions échanger nos noms, tu pourrais trouver / Une ressemblance subite entre nous : / Tu as une mère, / J’en ai une“. Cette reconnaissance de l’humanité partagée n’équivaut pas à une neutralité morale – l’oppression reste nommée – mais refuse la déshumanisation réciproque. Le poète devient “le dernier des poètes / Qui partagent les soucis de leurs ennemis“, posture tragique d’une empathie qui n’attend pas de réciprocité.
Les vingt-trois définitions de la paix qui closent le recueil forment une litanie désenchantée où chaque vers réinvente ce concept usé. “La paix, deux ennemis qui rêvent chacun / De bâiller sur les trottoirs de l’ennui” : l’image surprend par sa prosaïque sagesse. La vraie paix ne serait pas l’accord diplomatique mais le retour à l’ennui quotidien, luxe des peuples non assiégés. Ces variations révèlent que Mahmoud Darwich pense la paix non comme absence de guerre mais comme transformation des possibilités existentielles.
Entre blocus et beauté : Darwich, une voix qui échappe à la récupération
État de siège demeure notre contemporain parce qu’il refuse les consolations. Ni espoir naïf ni désespoir complice, le recueil maintient une lucidité inconfortable qui interroge toutes les certitudes. Mahmoud Darwich accomplit ce que Theodor Adorno jugeait impossible après Auschwitz : une poésie qui assume sa beauté formelle tout en témoignant de la barbarie, sans que l’une efface l’autre.
L’héritage de cette œuvre dépasse la Palestine. Partout où l’attente devient mode d’existence, où l’espace se rétrécit, où la dignité se négocie quotidiennement, ces vers résonnent. Mais attention : Darwich n’offre pas de modèle exportable. Sa poésie résiste aussi à sa propre instrumentalisation. Quand il demande au critique de ne pas expliquer ses mots “Avec la cuillère à thé ou le piège pour oiseaux“, il revendique l’opacité constitutive du poème, son irréductibilité.
La prescience douloureuse de ces poèmes constitue leur malédiction : en résonnant encore aujourd’hui dans chaque nouveau massacre, ils prouvent que la beauté poétique ne sauve rien, sinon la trace de ce qui aurait dû nous sauver.