Laurent Olivier, Le monde secret des Gaulois, Flammarion, 02/10/2024, 424 pages, 23,90 €.
Laurent Olivier, avec Le monde secret des Gaulois, propose une investigation qui dépasse de loin une compilation archéologique ou la récitation érudite des sources antiques. L’ouvrage, appuyé par une iconographie choisie qui donne à voir autant qu’à penser, est une invitation à une traversée, exigeante et salutaire, dans les méandres de la mémoire – celle des Gaulois, assurément –, mais aussi et surtout la nôtre, collective, souvent encombrée de spectres et de certitudes mal fondées. Ce secret que l’auteur s’attache à débusquer n’est peut-être pas tant celui des faits tus que celui des regards portés, des récits imposés, des silences construits, qui ont façonné, à travers les siècles, notre perception de cet univers évanoui.
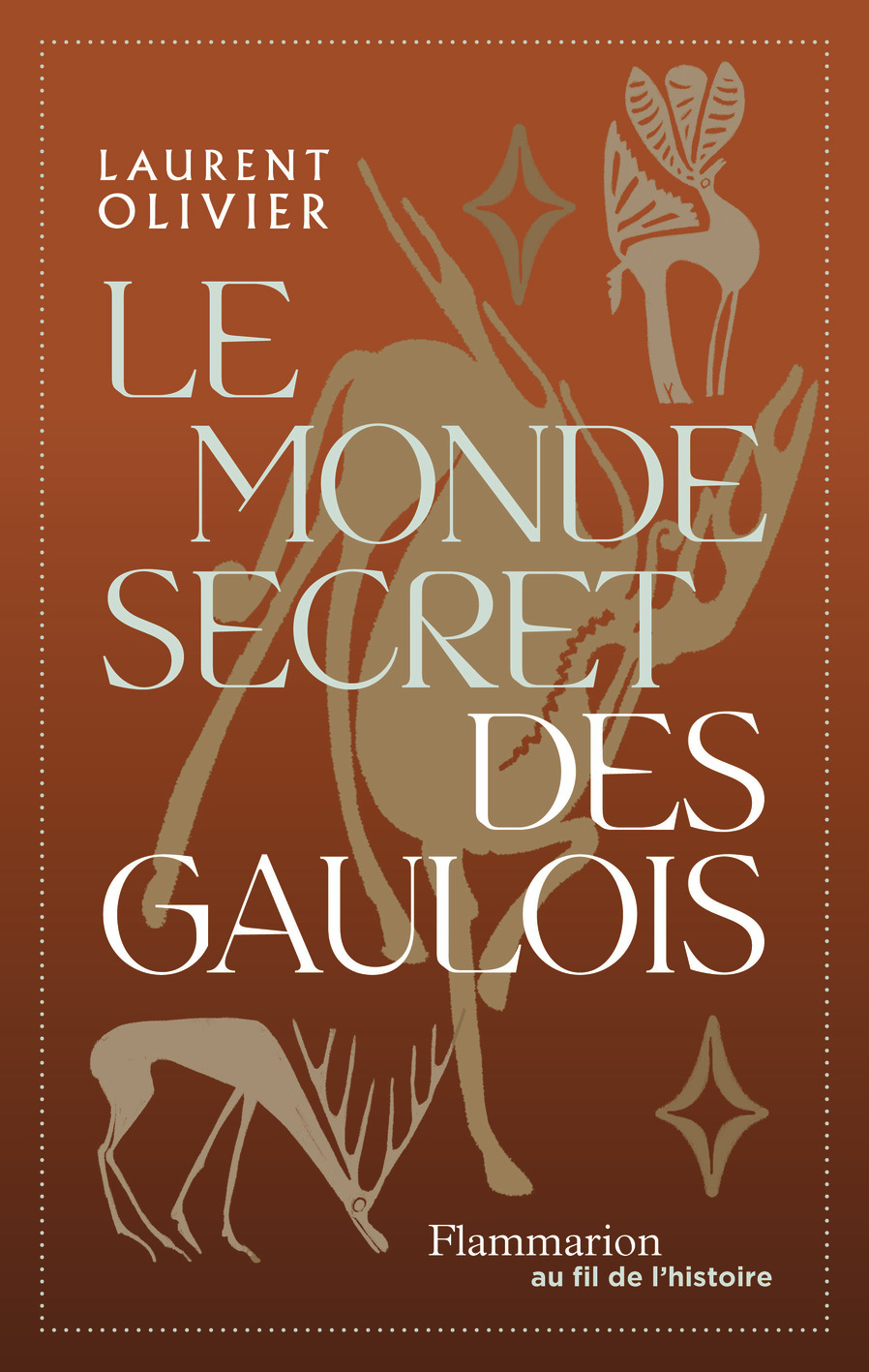
Une immersion entre mythe et réalité
L’auteur nous saisit dès l’orée, avec une malice intellectuelle certaine, par cette image familière : le village gaulois, festoyant sous les étoiles, clin d’œil non dissimulé à cet imaginaire collectif si puissamment modelé par la figure populaire d’Astérix. Mais cette convivialité n’est qu’un leurre introductif. Rapidement, l’historien signifie que ce cliché, enfantin et rassurant, est le premier des voiles qu’il convient de déchirer. Le sanglier dominical n’est pas au menu de cette histoire ; pas plus que les maisons rondes en grosses pierres, avatars fantasmés de nos restaurants d’autoroute. L’ambition est autre : sonder comment ce « monde désormais évanoui » nous est parvenu, filtré, déformé, instrumentalisé au fil des narrations successives.
Ce ne sont pas les Gaulois eux-mêmes qui, les premiers, prennent la parole dans ce récit archéologique et historiographique, mais ceux qui les ont nommés, décrits, et finalement conquis. Les Grecs d’abord, ces Phocéens audacieux débarquant sur les côtes de Provence dès le VIIe siècle av. J.-C., apportant avec eux non seulement le vin, mais aussi une première grille de lecture pour ces peuples de l’intérieur. Keltoi, les nomment-ils. Hécatée de Milet, puis Pythéas le Massaliote, explorateurs et chroniqueurs, fixent une première image de ces « barbares », philhellènes pour certains, simplement “autres” pour la plupart. Laurent Olivier montre comment cette première définition des Gaulois, même teintée de curiosité, n’est jamais neutre. Elle classe, elle hiérarchise, elle prépare déjà le terrain d’une intelligibilité extérieure, celle qui finira par occulter, ou du moins simplifier à l’extrême, la complexité autochtone.
Puis viennent les Romains, et avec eux, la figure écrasante de César. Caton l’Ancien mentionne les Galli, et le metus gallicus, cette peur ancestrale et structurante des Romains face à l’envahisseur du Nord, devient une clé de lecture, un prisme déformant. L’auteur souligne comment cette terreur se mue en un puissant instrument politique. La Gaule devient, sous la plume des conquérants, ce contrepoint nécessaire à l’affirmation de la civilitas romaine, ce territoire à pacifier, à ordonner, à intégrer. La conquête, telle que Laurent Olivier la dépeint, n’est pas que militaire : elle est d’abord, et peut-être surtout, une prise de contrôle narrative. Le récit de la Guerre des Gaules devient ainsi le moule, la matrice à travers laquelle des générations entières – y compris les historiens des XIXe et XXe siècles – percevront cet univers.
Des regards croisés sur un monde évanoui
L’ouvrage progresse en déconstruisant méthodiquement les strates de représentations. La démarche n’est pas de nier la “barbarie” gauloise pour la remplacer par une idylle anachronique, mais plutôt de questionner la notion même de barbarie, telle qu’elle fut forgée par les civilisations qui se posaient en parangons de l’ordre. Laurent Olivier montre que la perception antique des Gaulois est une construction complexe, où se mêlent la peur, la fascination, le mépris et, parfois, une forme de respect inavoué.
Le metus gallicus (chapitre II), cette « terreur gauloise », est analysé non pas comme une angoisse irrationnelle, mais comme le fruit d’une mémoire traumatique : la prise de Rome par les Sénons en 390 av. J.-C. Cet événement fondateur a durablement façonné le regard romain. Les Gaulois deviennent l’archétype de l’ennemi imprévisible, violent, insaisissable. Mais l’auteur montre aussi comment cette peur sert de justification à une politique de domination préventive. Le sacrifice humain d’un couple gaulois et d’un couple grec au Forum Boarium en temps de crise n’est pas seulement un rite propitiatoire ; c’est un acte politique, une mise en scène de la supériorité romaine qui exorcise la peur de l’autre en le sacrifiant symboliquement.
Et dans cette entreprise de dévoilement, Laurent Olivier n’hésite pas à aborder des aspects longtemps tus ou déformés par le prisme romain. Ainsi, la place et le rôle des femmes gauloises émergent avec une force singulière, bien au-delà des clichés. Elles ne sont pas que des figures passives. Elles apparaissent dans les récits de guerre, non comme des victimes, mais parfois comme des actrices de leur destin, allant jusqu’au suicide collectif face à la défaite. Ces actes ultimes, souvent interprétés par les Romains comme une manifestation supplémentaire de « barbarie », sont ici réinterrogés, suggérant une complexité des réactions face à la soumission inéluctable, une affirmation tragique d’une identité irréductible, dont la statue du Galate mourant est une célèbre, mais tardive icône romaine.
Le traitement de la figure de Vercingétorix est particulièrement éclairant. Laurent Olivier ne cède ni à l’hagiographie nationale d’un héros romantique, ni au dénigrement post-colonial d’un « loser magnifique ». Il restitue la complexité d’un chef de guerre confronté à une machine impériale, et montre comment sa mémoire fut, elle aussi, l’objet d’une instrumentalisation, de César lui-même à Napoléon III. La reddition d’Alésia, par exemple, est disséquée pour en révéler les enjeux symboliques et politiques, loin des images d’Épinal.
L’archéologie, discipline de prédilection de l’auteur, n’est pas présentée comme une science neutre apportant la vérité des faits, mais comme une autre forme de narration, elle aussi soumise à des interprétations, des modes, des enjeux politiques. Et c’est ici que la dimension visuelle et plastique de l’ouvrage prend tout son sens : les cartes détaillées, les reproductions d’objets exhumés, les reconstitutions d’habitats, constituent le soubassement matériel de l’analyse, rendant tangible la complexité des cultures matérielles et des échanges. La découverte des tombes à char, l’étude des oppida, ou l’analyse des sanctuaires comme celui de Ribemont-sur-Ancre, ne servent pas à reconstituer un « âge d’or » celtique, mais à questionner les structures sociales, les rapports de pouvoir, les systèmes de représentation d’une société qui, bien que sans État au sens romain, n’en était pas moins complexe et organisée. L’historien souligne la difficulté pour l’archéologie française, longtemps prisonnière du « fantasme gallo-romain », de penser une civilisation gauloise autonome, non définie par son rapport – ou son opposition – à Rome.
Un livre en écho à notre présent
Ce Monde secret des Gaulois résonne puissamment avec nos interrogations contemporaines sur l’identité, la mémoire, et la construction des récits historiques. En démontant les mécanismes de l’altérisation (néologisme emprunté à la sociologie) des Gaulois par les Grecs et les Romains, Laurent Olivier offre des outils pour penser les formes actuelles de racisme et de xénophobie, qui reposent souvent sur des stéréotypes hérités d’une longue tradition de regards dominants.
L’instrumentalisation politique de l’histoire, que l’auteur traque de César à Vichy (avec l’illustration de Vercingétorix à Pétain), trouve des échos évidents dans les débats mémoriels qui traversent nos sociétés. L’exemple de la récupération de Vercingétorix, d’abord par Napoléon III comme figure unificatrice d’une nation en quête de grandeur, puis comme symbole de résistance, illustre la plasticité des figures historiques et leur capacité à être mobilisées au service d’agendas politiques successifs. Le livre montre bien que le « choix des ancêtres » n’est jamais innocent.
La question de la mémoire des vaincus est au cœur de la démarche. Comment entendre ces voix que le récit des vainqueurs a si souvent étouffées ? L’archéologie peut offrir des bribes, des traces matérielles, mais le « secret » réside aussi dans notre capacité à lire entre les lignes des sources dominantes, à y déceler les non-dits, les résistances implicites. C’est là que le travail de Laurent Olivier est le plus novateur : il ne prétend pas livrer une “vérité” gauloise enfin restituée, mais montre comment, à partir des fragments dont nous disposons, nous pouvons tenter de reconstruire une histoire plus respectueuse de la complexité du passé. Le sensible et l’imaginaire ont leur place dans cette quête : non pas pour fantasmer une Gaule idéale, mais pour tenter de se rapprocher, avec humilité, de l’expérience vécue de ces hommes et de ces femmes.
Le monde secret des Gaulois est moins un livre de réponses qu’un livre de questions, un formidable stimulant pour l’esprit critique. En invitant à repenser notre rapport à ce passé fondateur, Laurent Olivier nous convie à un exercice de libération intellectuelle, à une quête d’une mémoire multiple, affranchie des tutelles idéologiques. Et c’est peut-être là que réside le véritable “secret” : non pas dans les profondeurs de la terre gauloise, mais dans notre capacité à renouveler sans cesse notre regard sur ce qui nous a précédés, pour mieux comprendre ce qui nous constitue.















