Marin Fouqué et Samira Negrouche, Pente raide, Actes Sud, 03/09/25, 112 pages, 16 €
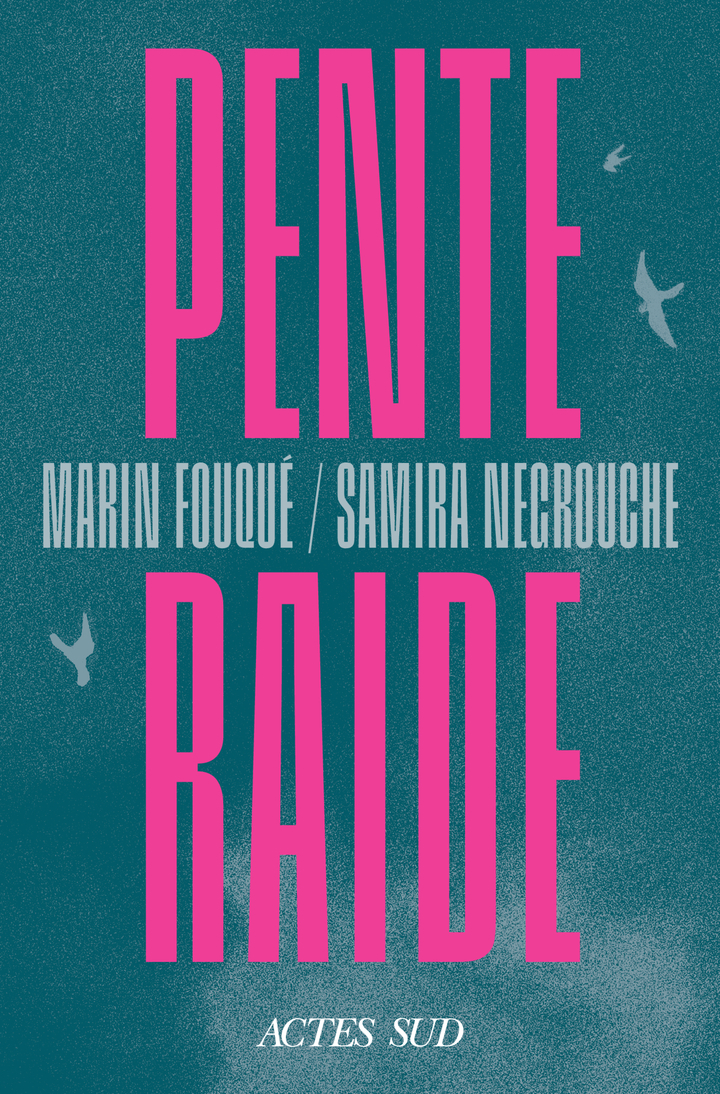
Marin Fouqué et Samira Negrouche ont commis ensemble un geste littéraire qui tient du défi autant que de l’urgence : Pente raide, repose sur un dispositif dialogique où deux voix s’interpellent, se heurtent, se cherchent à travers la Méditerranée. L’un vient d’un « pays plat », français, hanté par les silences de ses aïeux ; l’autre habite Alger, ville verticale et sismique, où les pentes raides sculptent autant les corps que les mémoires. Entre eux, soixante-dix ans d’histoire non dite, de langues mutilées, de filiations empoisonnées. Ce texte hybride – poème, récit, incantation – explore les strates géologiques d’une blessure coloniale qui refuse de cicatriser. Il faut y voir une archéologie sensible des rapports franco-algériens, menée avec une rigueur chirurgicale et une empathie radicale.
Résidence littéraire croisée : quand Aix-en-Provence rencontre Alger
L’ouvrage naît d’une résidence croisée entre Aix-en-Provence et Alger au printemps 2024. Marin descend la pente d’Alger, métaphore physique et mentale de ce qu’il ignore de sa propre généalogie ; Samira grimpe les sentiers provençaux, confrontée à une beauté qui la « rend furieuse », selon le mot emprunté à une artiste martiniquaise. Chaque section alterne les perspectives, marquées par des signes typographiques distincts : arobase, dièse, esperluette, parenthèses. Cette ponctuation visuelle devient langage à part entière, signalant les ruptures, les reprises, les respirations. La forme mime le va-et-vient d’une parole qui se cherche, se perd, se retrouve. Les auteurs écrivent chacun dans leur langue : le français des deux côtés, certes, mais un français fissuré, traversé d’arabe dialectal, de transmissions avortées, de rage contenue. On pense aux Nedjma de Kateb Yacine, aux polyphonies éclatées d’Assia Djebar : ici aussi, la langue française devient le lieu d’un affrontement intérieur, un champ de bataille où se joue la possibilité même du dire.
Argot des banlieues et arabe dialectal : quand les langues se croisent
Le style de Marin frappe par son énergie brute, sa prosodie heurtée. Ses phrases s’allongent en litanies haletantes, scandées par des anaphores obsessionnelles – « et si », « je veux dire », « rien nada quedchi que dalle » –, comme si le flux verbal tentait de rattraper une mémoire en fuite. Les images s’empilent, se télescopent : la pente devient forage, les poings deviennent nœuds, les silences deviennent shlasses. L’argot des banlieues françaises côtoie les références à Cézanne, aux containers rouillés, aux champs de tournesols. Ce mélange des registres traduit une conscience déchirée entre plusieurs appartenances : fils de colon juif rescapé de la Shoah, petit-fils d’un appelé de la guerre d’Algérie, héritier d’un « pays plat » qui refuse de regarder en face ses ombres portées. Samira, elle, adopte une écriture plus fragmentée, mais d’une densité poétique redoutable. Ses phrases se déploient en cascades méditatives, ponctuées de mots arabes translittérés — hchicha talba m3icha (une herbe qui ne cherche qu’à vivre), ness mleh (des gens bien) —, de proverbes familiaux, de notations sensorielles qui ancrent le texte dans une géographie intime. Elle interroge la « neutralité » revendiquée, cette position « balle au centre » qui permettrait de tenir la conversation « déséquilibrée ». Sa voix porte une mémoire collective, celle d’un peuple « orphelin » qui a payé cher son indépendance et continue de payer. Ses images – les boyaux sortis, les volcans imprononçables, les boyaux suturés pendant dix heures – disent l’écartèlement physique, la douleur viscérale de l’héritage colonial. Les deux écritures se répondent sans jamais fusionner : elles dessinent une géométrie instable, une « distance d’amour » encore à inventer.
Comment habiter ensemble une histoire qui nous sépare ?
La portée de Pente raide dépasse largement le cadre autobiographique. Marin et Samira mettent en scène une confrontation symbolique où se jouent les impensés du « vivre-ensemble ». Ils refusent les facilités de la réconciliation mémorielle, les discours convenus sur le pardon ou l’oubli. Au contraire, ils exposent crûment les contradictions, les ressentiments, les culpabilités héritées. Marin assume sa rage contre les « bons Français » qui refusent de voir le « colon qui sommeille dans les poings », tandis que Samira rappelle que « l’Arabe qui est arabe et autre chose » en a assez d’être assigné à résidence identitaire. Tous deux savent que « la guerre est ce qui arrive quand la langue échoue », selon la formule de Margaret Atwood qu’ils convoquent. D’où l’urgence de parler, de « forer dans le silence », de « suturer les boyaux » à vif, même si cela fait mal. L’œuvre résonne avec les tensions contemporaines autour des polémiques mémorielles, des fractures sociales dans les quartiers populaires, des assignations identitaires. Elle offre une réponse poétique à une question politique : comment habiter ensemble une histoire qui nous sépare ? Comment faire du français une langue commune sans effacer les sédiments, les strates, les cicatrices ? Comment transformer la verticalité d’Alger et la platitude de la France en un seul paysage partagé ?
Pente raide demeure une œuvre en tension, refusant les conclusions apaisantes. Les deux voix finissent par se retrouver rue Didouche à Alger, « apeurés », « mutiques », cherchant dans le regard de l’autre « ce petit quelque chose d’autrefois ». Puis vient la corniche, la mer, une glace à la main – boule citron, vanille-pistache – et cette promesse fragile : « alors enfin des brins d’herbe / qui demandent à vivre / un petit bout de paradis peut-être ». L’espoir ici ne relève pas de l’idéalisme mais d’un réalisme implacable : il faut continuer à grimper, à dévaler, à recommencer. Car la pente raide trace le seul chemin possible vers la reconnaissance mutuelle, celui où l’on accepte enfin de se regarder en face.
















