Valérie Rodrigue, Oranaise sang pour sang, récit, français, L’Harmattan, 14/10/2025, 128 pages, 15 €
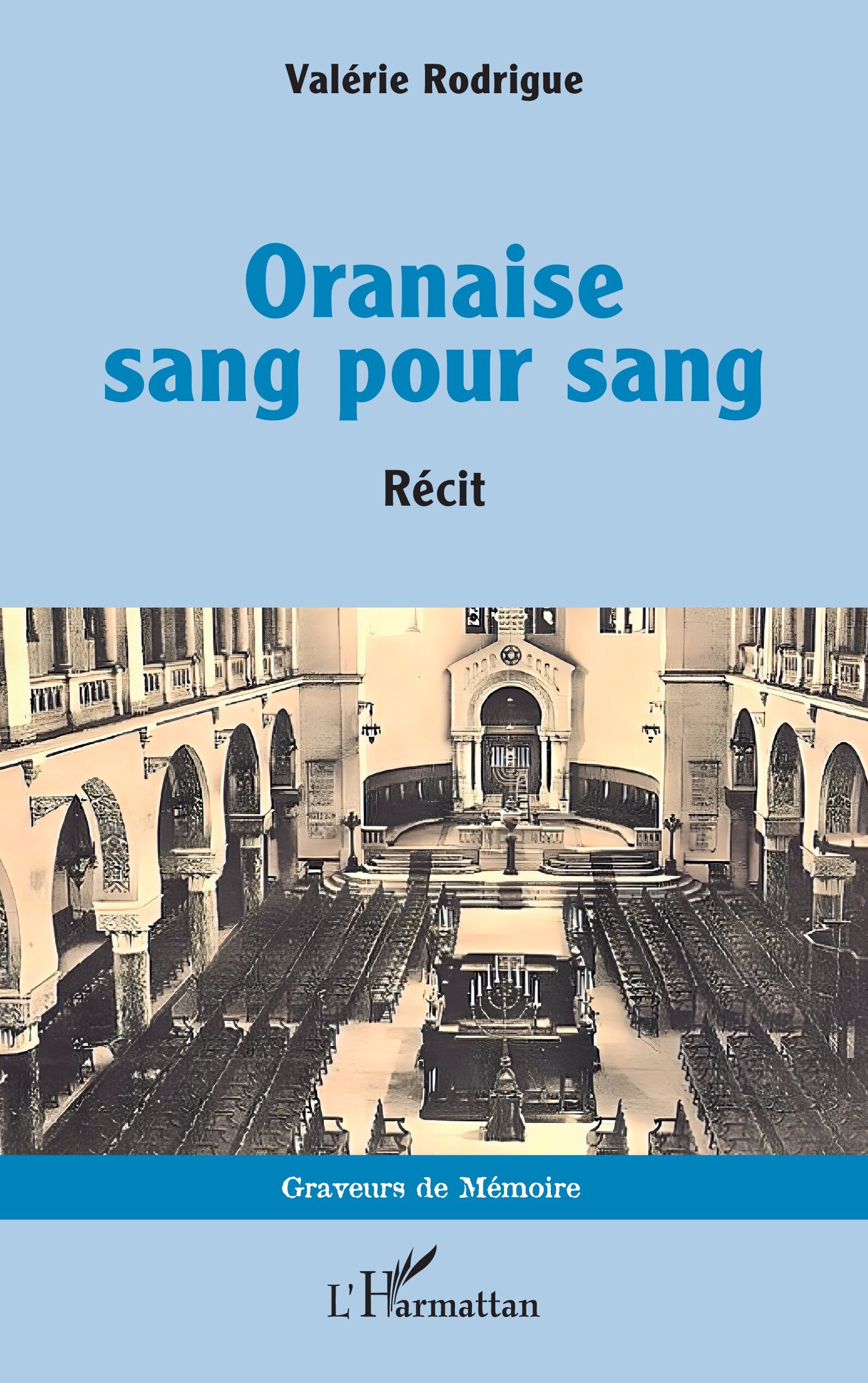
Soixante ans après l’exode de 1962, Nathalie prend l’avion pour Oran, la ville que ses parents ont fuie et qu’elle n’a jamais connue. Dans ses bagages : des photos jaunies, l’adresse d’un appartement rue d’Arzew, la mission impossible de retrouver une tombe au cimetière juif. Valérie Rodrigue signe un récit bouleversant sur l’héritage des silences, où le voyage initiatique se mêle à la quête amoureuse, où l’histoire familiale croise la grande Histoire, où chaque rue d’Oran devient le théâtre d’une réconciliation avec soi-même.
Valérie Rodrigue signe chez L’Harmattan un récit qui traverse les décennies, les rives de la Méditerranée et les silences familiaux pour renouer avec une Algérie jamais quittée parce que jamais vraiment habitée. Oranaise sang pour sang appartient à cette littérature de la filiation blessée, de l’exil transmis en héritage, où la narratrice, journaliste reporter-photographe parisienne, entreprend un voyage à Oran en septembre 2019, soixante ans après le départ précipité de ses parents. Ce texte explore l’exil, la mémoire juive séfarade, les identités fragmentées, le rapport à l’Algérie postcoloniale, les transmissions familiales blessées, l’héritage féminin, les langues maternelles perdues, l’amour contemporain et ses dérives, l’écriture de soi, la réparation symbolique, l’Histoire traversée par l’intime, et la quête des origines à travers le voyage et le deuil, autant de thématiques que je maîtrise et qui traversent ce récit avec une force singulière.
Retour à Oran : combler le vide de la génération rapatriée
Le livre s’ouvre sur une phrase programmatique : « Cet été, je pars en Algérie ». Cette déclaration, apparemment anodine, porte en elle toute l’épaisseur d’un manque. L’auteure construit son récit autour d’une absence fondatrice : celle du bled, ce territoire fantasmé par les autres enfants de migrants, mais dont elle fut privée. Ses parents, rapatriés en 1962, juifs d’Algérie devenus « pieds-noirs » par commodité linguistique, ont tourné le dos à Oran. Le père, instituteur devenu mutique, la mère surnommée Dalida, artiste ratée et mère défaillante, incarnent deux figures du refoulement : l’un par le silence, l’autre par la fuite. Entre eux, Nathalie grandit dans un vide mémoriel que seuls quelques objets, quelques expressions arabes glissées dans le français familial, quelques plats du dimanche viennent habiter fugacement.
Ce voyage à Oran devient alors un acte de réappropriation, une tentative de combler le manque par la présence physique. Valérie Rodrigue arpente les rues où son père a grandi, pousse les portes des immeubles, visite les cimetières, cherche les traces d’une vie antérieure qu’elle n’a jamais connue. Sa démarche rappelle celle des enfants de la Shoah qui se rendent à Auschwitz ou des descendants d’esclaves qui retournent à Gorée : il s’agit de transformer l’histoire collective en expérience personnelle.
Identité séfarade : de l’Espagne à l’Algérie, une mémoire fragmentée
L’écriture procède par fragments, chapitres brefs qui alternent entre le présent du voyage et les souvenirs d’enfance, entre les découvertes oranaises et les échanges virtuels avec Ilyas, cet amant kabyle qui incarne un autre versant de l’impossible réconciliation. Cette structure kaléidoscopique mime les mécanismes mêmes de la mémoire : associations libres, retours en arrière, obsessions récurrentes. « J’aurais pu avoir un passeport espagnol, le gouvernement l’a proposé aux juifs séfarades, une offre qui a duré deux ans », note-t-elle, avant de dérouler l’histoire complexe de ses ancêtres marranes, ces conversos chassés d’Espagne au XVe siècle.
Cette généalogie éclatée dessine une identité en archipel : turque par le grand-père marin, tlemcénienne par la grand-mère illettrée, espagnole par les aïeux séfarades, française par le décret Crémieux de 1870 qui accorda la citoyenneté aux juifs d’Algérie. La romancière ne cherche pas à résoudre cette multiplicité ; elle l’habite, la revendique même, consciente que cette fragmentation constitue précisément son héritage.
Cimetière juif d’Oran : quand un gardien musulman veille sur la mémoire
Le cimetière juif d’Oran, où repose l’oncle Raoul mort à vingt-sept ans dans un accident de voiture, constitue le cœur symbolique du récit. Ali, le gardien musulman qui lit l’hébreu transmis par son père, veille sur ces tombes abandonnées comme sur un patrimoine commun. Sa présence incarne une cohabitation mémorielle que l’histoire officielle peine à reconnaître. Lorsqu’il retrouve la sépulture de Raoul, intacte après soixante ans, c’est toute une mémoire familiale qui remonte à la surface, provoquant une onde de choc jusqu’en Israël et en France, où les tantes pleurent à nouveau ce frère disparu.
Valérie Rodrigue comprend alors que son voyage répare symboliquement ce que la génération précédente a vécu comme une amputation. « Je suis la seule à pouvoir faire désormais ce voyage, pour honorer une mémoire familiale, réconcilier quelque chose, apaiser une mémoire à vif ». Cette fonction réparatrice transforme chaque geste en rituel : allumer une bougie sur une tombe, photographier une façade, chercher des traces dans les registres.
Mère absente, tantes présentes : réinventer la filiation féminine
La relation à Dalida, cette mère toxique qui a renié ses origines et rompu avec sa fille, traverse le livre comme une blessure ouverte. Rodrigue écrit pour comprendre, pour pardonner peut-être, surtout pour exister malgré ce désaveu maternel. Dalida incarne une génération qui a voulu tout effacer du passé algérien, considéré comme « rayouyou », c’est-à-dire vulgaire, populaire, maghrébin. Cette violence de l’auto-négation, ce désir d’assimilation poussé jusqu’à l’autodestruction psychique, Rodrigue les expose sans complaisance mais sans cruauté non plus.
Face à cette figure maternelle défaillante, Nathalie invente d’autres filiations : les tantes qui l’appellent depuis Jérusalem ou Nice pour lui confier des missions mémorielles, les femmes rencontrées à Oran qui lui ouvrent leurs maisons et leurs histoires. Cette sororité reconstituée dessine un lignage alternatif qui compense l’échec de la verticalité. Le récit culmine dans un rêve où la narratrice sauve sa mère de la noyade, métaphore d’un sauvetage mutuel où chacune apprend à nager dans ses propres eaux.
Refuser la nostalgie
Oranaise sang pour sang s’écrit en 2019, au moment du Hirak, ce printemps algérien où la jeunesse descend dans la rue pour réclamer une vraie démocratie. Rodrigue capte cette Algérie contemporaine, celle des manifestations, des taxis, des cabarets de raï, des stylistes qui créent des robes de mariée en organza, des femmes voilées qui écoutent du rap avec leurs écouteurs. Elle refuse la nostalgie coloniale comme l’essentialisation culturelle, cherchant à voir le pays tel qu’il est, vivant et complexe, plutôt que figé dans l’ambre du passé.
Le livre se referme sur un coup de fil à la mère, après des années de silence. Dalida demande : « Pourquoi l’Algérie ? » Valérie Rodrigue raconte, et dans ce récit oral, tout se joue : la possibilité d’une parole qui circule, d’une histoire qui se partage. L’oubli maternel libère alors la fille de l’obligation de porter seule cette mémoire. Chacune peut désormais habiter son rapport à l’Algérie sans le devoir à l’autre, dans un apaisement qui ressemble moins à une réconciliation qu’à une coexistence pacifiée avec ses propres fantômes.
















