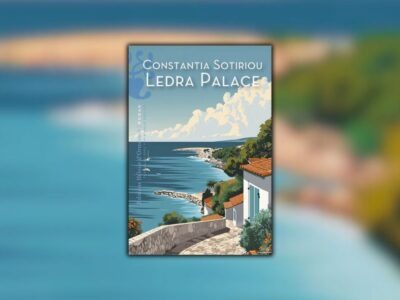Élie Guillou, L’homme tempéré, Marabout, 23/08/2023, 1 vol. (288 p.), 20,90€
Élie Guillou nous ouvre aux réflexions et émotions pétries de doutes et d’interrogations qui l’accaparent depuis sa rencontre, au Kurdistan, avec un peuple apatride dont l’existence, que ce soit en Turquie, en Irak, en Iran ou en Syrie, rime avec les violences meurtrières subies et celles de la résistance en retour, le constituant en terroriste.
L’homme tempéré explore et questionne ce qui se joue entre un jeune homme ayant grandi dans un pays en paix depuis plusieurs décennies et des enfants, femmes et hommes dont le quotidien n’est que guerre depuis le début du XXe siècle.
Socialisé aux manières d’être et de penser d’ici où, d’une manière générale, l’on peut se lever le matin sans avoir en tête la crainte d’être arrêté, torturé, violé ou tué, le narrateur a dû s’habituer là-bas à un environnement où cette crainte est chevillée au corps et au cerveau de chacun. Et, revenu en France, sensibilisé à cette crainte infuse, il se heurte à la difficulté de la rendre palpable à celles et ceux qui ne l’ont pas approchée et qui, le plus souvent, préfèrent la tenir à distance.
Là-bas : la découverte d’un quotidien qui n’est que guerre
Selon le narrateur, “accablement” et “révolte” sont deux mots qui, aujourd’hui, disent particulièrement bien le Kurdistan en guerre, que celle-ci couve, toujours sur le point d’exploser, ou qu’elle soit effectivement à l’œuvre. D’abord expérimentée dans les zones montagneuses reculées puis désormais aussi dans le cœur des villes, la conjugaison paradoxale entre “l’accablement” et “la révolte” dessine les contours d’une personnalité sociale kurde qui a dû se résoudre à faire le deuil du mot paix, convaincue que résister et prendre les armes est la seule solution tangible.
Infiltré partout, “l’accablement” est le produit d’un présent désespéré qui rend caduques toutes velléités de se projeter dans l’avenir. Le présent guerrier qui s’éternise, ce sont, par exemple, les coups de klaxon répétés des blindés turcs “qui, chaque jour, vous pénètrent jusqu’aux os” ; en l’un des dialectes kurdes non officiellement reconnus, ce sont aussi “les quelques minutes d’éternité” égrenant des chants tristes à la mesure de “vies tristes produites par un siècle de douleur” ; ou encore, comme moment de répit à l’affliction profonde de son peuple, c’est cette comédienne qui laisse monter sur scène une vieille femme égarée, donnant ainsi d’autant plus de force à la pièce dont le propos est notamment de soutenir “les Mères du samedi, un groupe d’activistes qui réclament à l’État turc des informations sur la disparition de leurs enfants”.
“La révolte”, c’est notamment affronter une énième fois la répression turque qui s’abat avec brutalité lors des manifestations. Si tous savent parfaitement qu’une journée de lutte va se terminer à leurs dépens, tous viennent, cependant, d’eux-mêmes “dans un piège déjà refermé”. Les Kurdes se mobilisent parce qu’ils le doivent, parce que leur dignité bafouée l’exige. Lors de l’une de ces manifestations, le narrateur assiste impuissant au lynchage d’un adolescent kurde. Longtemps, il gardera en tête la terrible image d’hommes des forces spéciales turques le frappant “en plaisantant, comme s’ils faisaient des passes avec un ballon”.
Ici : la difficulté d’alerter sur la guerre qui dure là-bas
De retour en France, le narrateur se demande comment faire entendre l’urgence du Kurdistan ? Comment faire comprendre “la tension politique qui là-bas s’incruste dans les corps, dans les nerfs” ? Mais, ici, il est confronté au profond décalage entre ce qu’il considère comme relevant de sa responsabilité – informer sur le sort dramatique des Kurdes – et les réactions peu impliquées, voire agacées et caustiques (“mais les Kurdes, ils ont participé au génocide arménien, non ?” de celles et ceux qu’il interpelle.
Ici, conformément à la culture de paix, le narrateur est encouragé – sinon acculé – à “aller mieux”, à cesser de se sentir missionné à porter toute la misère du monde sur ses épaules. Il lui est reproché de venir perturber la jouissance d’être libre dont on dispose, tout en l’encourageant néanmoins à s’investir dans des joutes verbales qu’il entrevoit sans autres finalités qu’elles-mêmes.
Alors qu’ici, il lui est fait injonction de “cicatriser”, le narrateur ne le veut pas car ce serait trahir celles et ceux dont, là-bas, il a côtoyé la souffrance. Dans un premier temps, même s’il ne parvient pas à l’exprimer comme il le voudrait devant un auditoire maniant avec aisance le dictionnaire et l’argumentaire de la culture de la paix et de la liberté, il s’en tient à être intimement convaincu qu’il sait quelque chose du Kurdistan et des Kurdes ; que ce quelque chose se trouve dans cette “image volée par l’entrebâillement d’une porte : le délice particulier d’une semelle policière écrasant la nuque d’un adolescent inanimé”. Puis, le temps aidant, il aspire à transformer cette image qui l’obsède en une démarche lui permettant d’être utile aux gens de là-bas.
Vouloir être utile à celles et ceux de là-bas
Soucieux de ne pas “repousser la brûlure de la colère” des Kurdes rencontrés et, attentif à “la laisser renseigner son doute d’homme tempéré”, le narrateur a donc souhaité agir. Suite à la sollicitation pressante d’un père, il pense d’abord être en capacité de faire venir en France, accompagné par sa famille, un enfant Kurde qui doit absolument bénéficier d’une greffe de moelle osseuse. Mais, ici, il prend conscience des multiples obstacles de tous ordres (bien sûr financiers mais également juridiques, institutionnels, temporels …) qui doivent être levés sans jamais avoir la certitude qu’ils le seront au bout du compte.
Ensuite, dans un camp de réfugiés kurdes, le narrateur a eu pour fonction d’enseigner la guitare à des enfants. Là, il a dû adapter sa manière de procéder en s’affranchissant du futur, en ne cherchant pas à les emporter par le rêve comme il a l’habitude de le faire ici. Là-bas, Il a aussi fallu ne pas s’immiscer dans le drame dont leur passé est nourri et qui ne cesse de suinter. En tenant cette posture, les derniers jours de son intervention, le narrateur a permis à ses élèves “d’effleurer durant quelques secondes, ce qui là-bas ressemble à la paix : le présent pour lui-même”.
Puis, le narrateur a accepté d’aider Aram à fuir la Turquie où trois procès à son encontre ont été diligentés pour un documentaire qu’il a réalisé en Kurmanci (l’un des trois dialectes kurdes), bravant délibérément l’interdiction d’en faire usage. Malgré de nombreux couacs et atermoiements, Aram a pu gagner la France où le narrateur va, cette fois, l’accompagner dans le long parcours qui devrait aboutir à la régularisation de sa situation. Si le narrateur peut se dire qu’il lui a enfin été donné d’aider, il ne peut s’empêcher de penser à tous ceux qu’il a croisés là-bas sans qu’il ait songé à les secourir alors que, lui, il peut “circuler librement dans le monde”.
En se gardant de l’arrogance des certitudes définitives qui, ici où la paix prévaut, peuvent être formulées aisément et sans risques, Élie Guillou relate un apprentissage, à la fois émotionnel et réflexif, de l’attention au sort tragique d’une partie de nos semblables dont l’existence se déroule au rythme de la guerre. L’homme tempéré témoigne avec justesse de la difficulté de se positionner avec à-propos et d’agir avec clairvoyance face à la brusquerie de l’histoire qui ravage certains territoires quand, soi-même, on s’est construit dans un espace où, globalement, la paix et la liberté donnent le tempo à notre existence.
Chroniqueuse : Éliane Le Dantec
NOS PARTENAIRES
Faire un don
Vos dons nous permettent de faire vivre les libraires indépendants ! Tous les livres financés par l’association seront offerts, en retour, à des associations ou aux médiathèques de nos villages. Les sommes récoltées permettent en plus de garantir l’indépendance de nos chroniques et un site sans publicité.