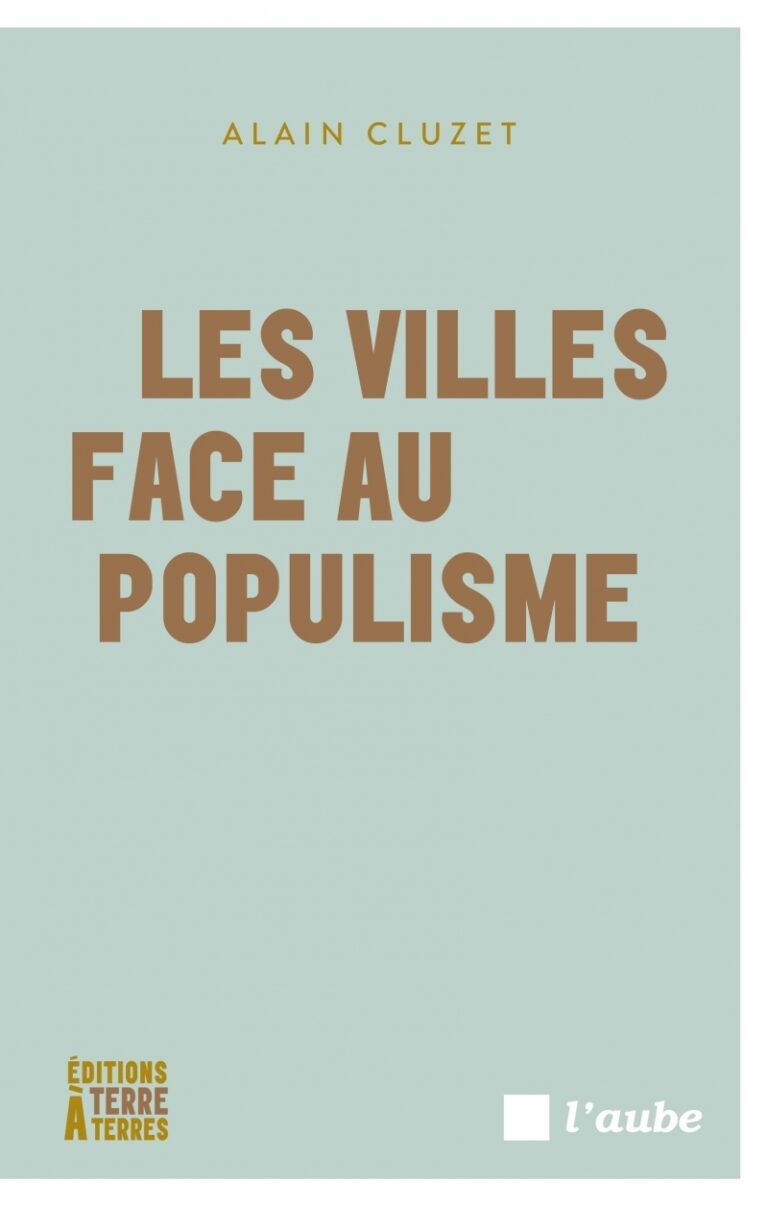Mark Fortier, Devenir fasciste, Lux Éditeur, 05/09/2025, 144 pages, 16€
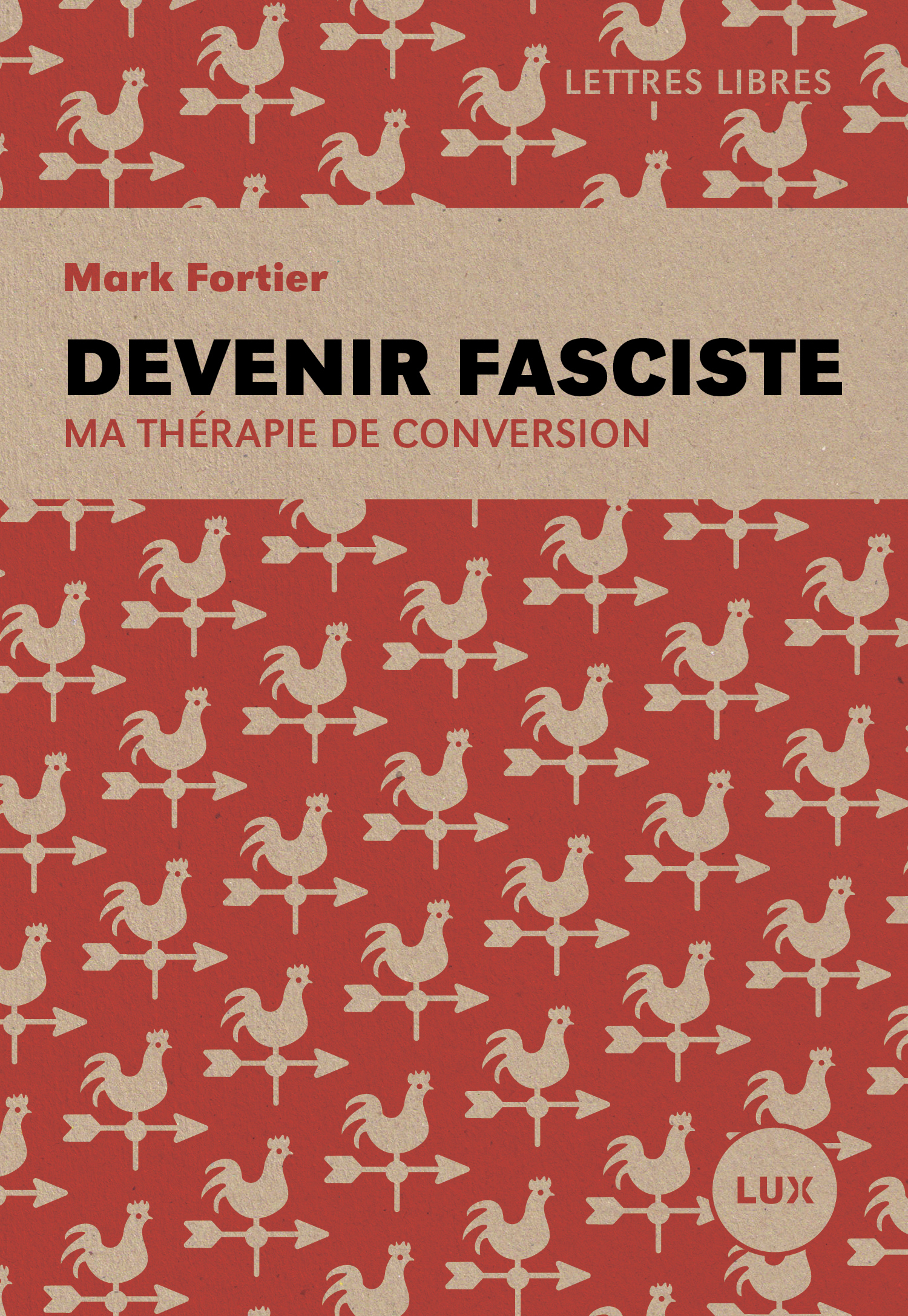
Peut-on rire du fascisme sans banaliser ses conséquences ? Mark Fortier tente l’expérience radicale avec Devenir fasciste, récit provocateur où un intellectuel de gauche imagine, étape par étape, sa propre conversion au nouveau monde autoritaire. Loin de la pure fiction, c’est un cheminement lucide et douloureux, à travers des symboles forts, des diagnostics amers et des épisodes qui mêlent autofiction et radiographie sociale.
“L’heure de la révolution conservatrice a sonné”
Que fait un démocrate lorsque l’histoire lui tourne le dos ? Mark Fortier ouvre son ouvrage sur cette question vertigineuse, formulée avec la désinvolture de qui sait déjà que la réponse tient en un mot : capituler. Mais la capitulation qu’il met en scène dans Devenir fasciste prend les atours d’une expérience radicale, à mi-chemin entre le pacte faustien et la thérapie comportementale. L’auteur, éditeur montréalais et intellectuel de gauche assumé, annonce dès l’ouverture son intention de « devenir fasciste », puisque « l’heure de la révolution conservatrice a sonné » et que « toute opposition est futile ». Ce qui pourrait passer pour une provocation de salon devient, au fil des pages, un dispositif littéraire redoutable : la satire autofictionnelle d’un monde où la résignation politique s’apparente à l’instinct de survie.
Le geste de Mark Fortier s’inscrit dans une tradition de la littérature politique qui remonte à La Boétie, traverse Klemperer et Haffner, sans pour autant reproduire leur approche. Là où Orwell construisait dans 1984 un système totalitaire fondé sur l’hyper-contrôle et la surveillance, Fortier décrit une dérive bien plus insidieuse : celle de la sidération collective, de la rationalisation complice, de l’adhésion passive déguisée en pragmatisme. Le livre s’ouvre sur un constat accablant : la démocratie libérale recule partout, les élites progressistes abdiquent, les milliardaires s’agenouillent devant Trump, et les institutions vacillent sous les coups de boutoir d’une droite radicale qui a compris que le pouvoir se conquiert d’abord par le langage et le spectacle. Fortier décrit ainsi un Jeff Bezos qui félicite Trump après l’avoir vilipendé, un Zuckerberg qui écoute religieusement l’hymne des émeutiers du Capitole, et une Europe où Meloni, Orbán, Milei et Le Pen orchestrent méthodiquement le démantèlement des libertés publiques.
“Fuck aux réacs, fuck à cette extrême droite”
La structure du livre mime celle d’un parcours initiatique inversé : plutôt que de s’élever vers la lumière, le narrateur descend méthodiquement les marches de l’abjection politique. Chaque chapitre correspond à une étape de cette conversion factice : apprendre le salut fasciste avec sa fille Romane (moment à la fois comique et glaçant), accepter la bouffonnerie du carnaval politique trumpiste, embrasser l’égoïsme rationnel des libertariens, renoncer à la beauté du langage au profit de la novlangue managériale. Cette progression culmine dans le chapitre « La dictature », où le narrateur bascule : au moment précis où il devrait achever sa métamorphose, il refuse. L’échec de la thérapie devient alors le véritable sujet du livre. Mark Fortier découvre que devenir fasciste exigerait de renoncer à l’amitié, cette « alliance du cœur » qui fonde l’humanité même. La solitude radicale du tyran, rappelle-t-il en citant Mussolini (« Je ne peux pas avoir d’amis, je n’en ai pas »), constitue l’aboutissement logique d’une philosophie de la force qui nie la vulnérabilité constitutive de l’être humain.
Le style de l’auteur frappe par sa polyphonie. Il convoque tour à tour l’érudition historique (Mussolini, Hitler, la République de Weimar), la philosophie politique (Aristote, Schmitt, Arendt), la sociologie contemporaine (Paxton, Traverso, Gentile), et les anecdotes personnelles qui donnent chair à l’analyse. Les chapitres alternent entre le sarcasme pur (« Fuck aux réacs, fuck à cette extrême droite », lance Anne Hidalgo après les Jeux olympiques, dans une saillie qui résume l’impuissance du progressisme contemporain) et la méditation sur la corruption du langage. Ce dernier aspect mérite qu’on s’y attarde : le chapitre « On les pendra avec leur langue » constitue peut-être le cœur théorique de l’ouvrage. Mark Fortier y déploie une double critique : celle du verbalisme démagogique (les « faits alternatifs » de Trump, les « quartiers indigènes » de Renaud Camus) et celle, plus inattendue, du jargon technocratique qui vide les mots de leur substance bien avant que les populistes s’en emparent.
“Société de sots”
L’auteur dénonce avec une minutie implacable cette langue administrative qui fabrique sa propre réalité : « collecter des données », « fournir des conseils à valeur ajoutée dans un cadre de gestion axée sur des résultats », « continuum de responsabilités aux synergies nombreuses ». Cette novlangue managériale, observe Mark Fortier, partage avec le fascisme un mépris commun pour le sens. L’une et l’autre dissolvent le réel dans un flux de signifiants interchangeables. Lorsqu’un directeur d’établissement scolaire parle de « mode solution » et de « mode apprentissage », lorsqu’une administration publique recherche quelqu’un pour « relever le défi » d’un poste dont personne ne comprend les attributions, la langue cesse d’être un outil de compréhension pour devenir un instrument de soumission. Fortier va plus loin encore : il montre que cette désintégration du langage précède et rend possible l’avènement des démagogues. Trump ne détruit pas la langue politique, il occupe les ruines laissées par des décennies de communication technocratique.
L’une des intuitions les plus fécondes du livre tient à l’analyse du « carnaval politique » que représente le trumpisme. Mark Fortier, s’appuyant sur les travaux de l’anthropologue Lynda Dematteo, montre que les figures autoritaires contemporaines tirent leur force de leur bouffonnerie assumée. Trump, Bolsonaro, Milei incarnent des « sociétés de sots » où la grossièreté devient une arme de subversion, où l’incompétence se mue en gage d’authenticité. Cette théâtralité grotesque paralyse les démocrates, qui oscillent entre l’indignation morale et la paralysie tactique. Pendant que les progressistes débattent de pronoms et d’ampoules incandescentes (anecdote révélatrice sur Tony Blair refusant d’interdire les ampoules incandescentes par crainte d’être « trop radical »), la droite radicale organise méthodiquement la prise de contrôle des universités, des médias, des cours de justice.
Un guide pour transformer le désespoir en instrument de lucidité
Au-delà du diagnostic politique, Devenir fasciste pose une question profondément existentielle : comment vivre lorsque l’horizon démocratique se referme ? La réponse de Mark Fortier, qui traverse tout le livre comme un leitmotiv, emprunte à la sagesse des Guaraos du delta de l’Orénoque : « L’ami, mon autre cœur ». Face à la solitude radicale du tyran, face à l’individualisme mortifère des libertariens qui rêvent de s’échapper sur Mars ou de vivre en autarcie après l’effondrement écologique, l’auteur oppose la fragilité assumée de l’amitié. Cette conclusion peut sembler modeste au regard de l’ampleur du désastre décrit, mais elle porte en elle une puissance subversive considérable : refuser la conversion au fascisme, c’est refuser de renoncer aux autres, c’est maintenir vivante la possibilité d’un « nous » malgré tout.
Devenir fasciste appartient à cette famille d’ouvrages qui transforment le désespoir en instrument de lucidité. À rebours des essais militants qui exhortent à l’action sans mesurer l’ampleur de la défaite, Fortier regarde en face l’abîme qui se creuse sous nos pieds. Sa « thérapie » ratée dit quelque chose d’essentiel sur notre époque : le fascisme d’aujourd’hui avance masqué, déguisé en spectacle télévisuel, en optimisation gestionnaire, en libération des contraintes. Résister exige alors de retrouver ce que l’auteur appelle « le goût des mots justes », la patience des amitiés vraies, le courage de refuser ce que tout le monde semble avoir déjà accepté. Fortier clôt son livre sur cet avertissement emprunté à Aristote et aux Guaraos : un être humain qui refuse l’amitié se condamne à l’isolement radical, antichambre de la tyrannie. Dans un monde où les affects politiques se résument de plus en plus à la peur et à la haine, cette défense de l’amitié comme résistance au fascisme prend la forme d’une insurrection silencieuse.