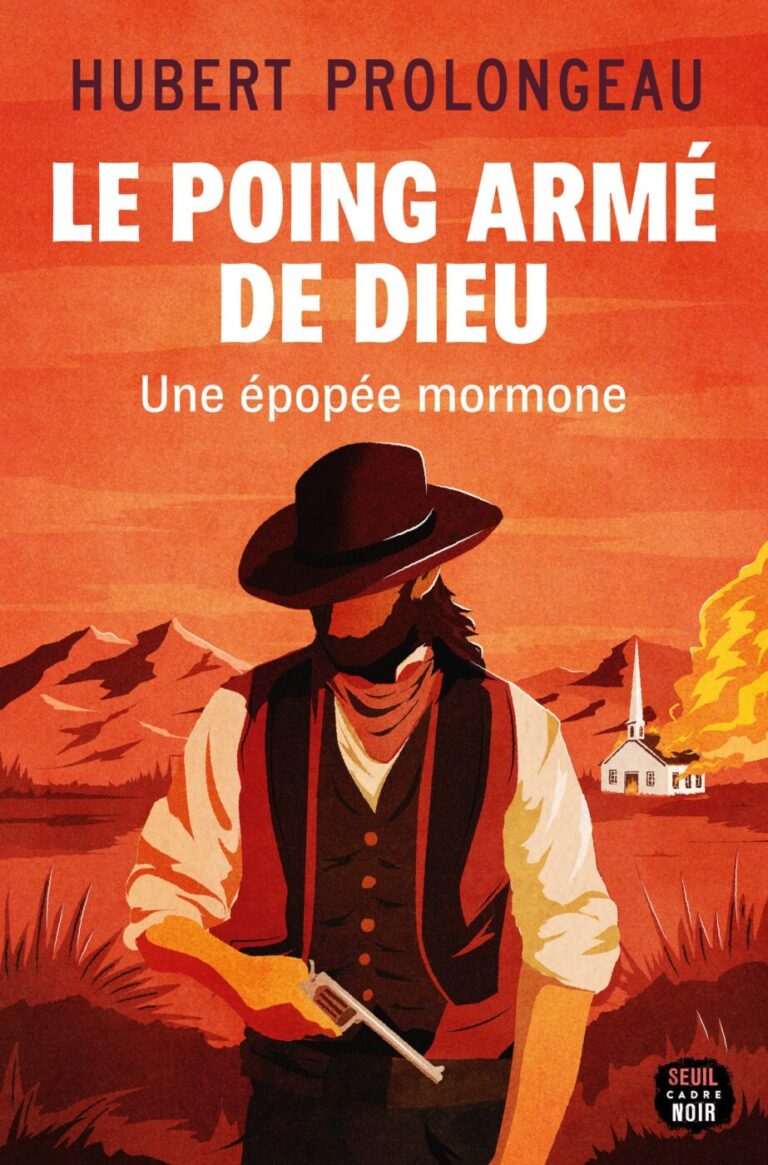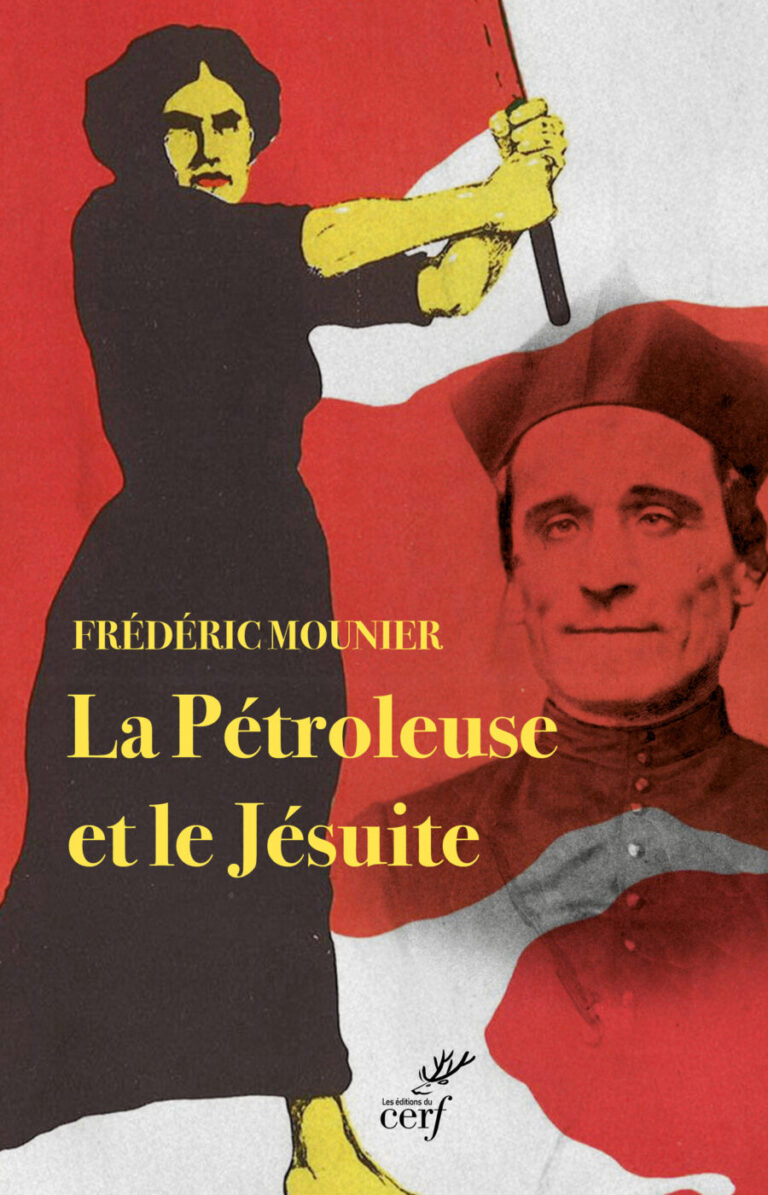Judith Koelemeijer, Etty Hillesum. L’Histoire de sa vie, traduit du néerlandais par Philippe Noble et Isabelle Rosselin, Le Seuil, 10/01/2025, 592 pages, 29,00€
Certaines trajectoires de vie, bien que brèves, marquent durablement la mémoire collective, tel un souvenir ardent qui interpelle notre histoire et notre conscience. Après l’extraordinaire biographie consacrée à celle qui a su transformer la souffrance en une quête de sens et d’humanisme (Etty Hillesum : une voix dans la nuit par Cécilia Dutter chez Tallandier en 2020), Etty Hillesum. L’histoire de sa vie, racontée par Judith Koelemeijer, relève le défi de retracer l’itinéraire intellectuel et spirituel d’une femme dont la destinée s’est heurtée au nazisme, tout en illustrant l’essor d’une pensée qui dépasse le simple cadre des événements historiques. L’ouvrage, fruit de dix ans de recherches, ne se contente pas d’une restitution biographique : s’appuyant sur des archives et des documents inédits, il propose une analyse très fine des dynamiques psychologiques, philosophiques et religieuses qui ont façonné Etty Hillesum.
Judith Koelemeijer adopte une approche rigoureuse en déconstruisant l’image d’une victime passive pour révéler celle d’une personnalité d’une étonnante complexité. Etty Hillesum apparaît comme une femme tiraillée entre le besoin d’indépendance et l’aspiration à une transcendance qui surpasse la condition humaine. Plutôt que de suivre un récit linéaire, l’auteure examine les composantes de son parcours intérieur, mettant en lumière les correspondances entre sa pensée et les traditions mystiques juives et chrétiennes, les enseignements de Julius Spier – lui-même influencé par Carl Jung – et l’existentialisme naissant.
Refusant les représentations sentimentales courantes dans les récits de la Shoah, Judith Koelemeijer montre que la résistance d’Etty Hillesum ne réside ni dans un engagement armé ni dans une opposition frontale, mais dans un combat spirituel et philosophique. Par ailleurs, la biographie insiste également sur la réalité concrète de son quotidien à Westerbork, les conditions de vie difficiles et les liens qu’elle tisse avec les autres détenus, humanisant ainsi son parcours. Par l’écriture, elle élabore une pensée qui refuse le nihilisme et la résignation, construisant un témoignage où se conjugue la tension entre la perspective de destruction et l’affirmation d’une humanité inébranlable. De ce fait, l’œuvre d’Etty Hillesum s’impose non seulement comme un document historique, mais également comme un objet d’étude essentiel pour quiconque s’intéresse aux intersections entre littérature de témoignage, philosophie morale et phénoménologie du sacré.
L’éveil d’une conscience (1914-1941)
Etty Hillesum naît en 1914 dans une famille juive où se confrontent deux héritages opposés : son père, Louis Hillesum, intellectuel rigoureux et professeur de latin et de grec, cantonné à un univers académique restreint, et sa mère, Riva Bernstein, une juive russe au tempérament vif, marquée par une histoire d’exil et de souffrance. Ce conflit entre le rationalisme paternel et l’émotivité débordante maternelle façonne dès son plus jeune âge un tempérament à la fois bouillonnant et analytique, empreint d’une sensibilité intense et troublé par un chaos intérieur.
Judith Koelemeijer illustre comment la relation conflictuelle avec sa mère, empreinte d’un étouffement affectif et d’une difficulté à communiquer, aura une influence déterminante sur le parcours spirituel et intellectuel d’Etty. Tout au long de sa vie, cette dernière sera confrontée à l’ambivalence de forces contradictoires, tiraillée entre un désir de se laisser aller et une quête incessante d’autonomie.
Parallèlement, l’atmosphère familiale se caractérise par une agitation constante, où les éclats de voix se succèdent à des silences lourds de sens. Louis Hillesum, passionné par le savoir et la transmission des langues anciennes, demeure réservé et absorbé par son monde intellectuel. Riva Bernstein, quant à elle, exprime ses émotions avec une intensité saisissante, oscillant entre une affection débordante et une exigence intransigeante. Ce cadre familial incite Etty à développer une sensibilité exacerbée et à rechercher inlassablement sa propre voie, indépendamment des modèles parentaux qui lui semblent incompatibles avec ses aspirations profondes.
Très tôt, elle se laisse captiver par les récits de son héritage russe, écoutant avec ferveur les histoires de sa mère sur les pogroms et les exils forcés. Cette transmission mémorielle forge en elle un rapport singulier à l’histoire et à l’identité juive, naviguant entre la fierté et le sentiment d’oppression. Ce passé tourmenté lui conférera, plus tard, la capacité remarquable d’embrasser son destin avec une lucidité qui exclut toute forme de résignation.
Dès l’adolescence, Etty ressent un impératif d’émancipation. Elle refuse de se cantonner aux rôles traditionnels assignés aux femmes de son époque et aspire à un avenir où elle pourrait librement explorer son esprit et ses émotions. Avide de lecture, elle nourrit son intellect de littérature, de philosophie et de poésie, cherchant à ordonner le tumulte intérieur qui la hante. Toutefois, son cheminement demeure marqué par la tension constante entre l’influence maternelle et sa propre quête d’autonomie, entre
Étudiante en droit puis en slavistique, Etty Hillesum se distingue alors par un esprit indomptable et une soif insatiable de savoir. Elle se passionne pour Rilke, Dostoïevski, Carl Jung, la mystique chrétienne et la pensée stoïcienne. Pourtant, malgré l’étendue de sa culture, elle semble peiner à canaliser cette énergie débordante. Multipliant les aventures amoureuses, elle évolue tantôt dans les cercles universitaires, tantôt au cœur des milieux bohèmes d’Amsterdam, sans parvenir à définir une voie véritablement la sienne.
Judith Koelemeijer met en lumière cette période d’errance, où la jeune Etty cherche ardemment un sens à son existence. Julius Spier qui deviendra son mentor et guide spirituel, va jouer un rôle crucial dans sa transformation, même si leur relation est empreinte d’ambiguïté : elle oscille entre une dépendance affective et intellectuelle et un besoin grandissant d’affirmer son individualité. Ce tumulte intérieur trouve sa première réponse en 1941, lors de la rencontre décisive avec Julius Spier, qui bouleverse à jamais sa vie.
La métamorphose (1941-1942)
L’initiation d’Etty Hillesum à l’écriture constitue une véritable voie d’émancipation. Encouragée par Julius Spier, elle entame son journal intime en mars 1941. Rapidement, ce journal se transforme en un espace d’introspection sans compromis, un exutoire face aux tourments intérieurs et, surtout, un levier de transformation. Par l’écriture, Etty découvre une liberté nouvelle et une manière de donner un sens à son existence dans un monde en pleine mutation. Elle parvient ainsi non seulement à mettre des mots sur ses angoisses et sa quête personnelle, mais aussi à transcender son quotidien en l’inscrivant dans une réflexion plus vaste sur la vie. Au fil de ses écrits, son style évolue. Ce qui débute comme l’expression brute de ses tourments se mue progressivement en une méditation profonde sur la condition humaine. Elle parvient à transformer ses angoisses en une quête spirituelle bien au-delà du simple témoignage personnel. Cette transformation s’opère dans un contexte marqué par une peur grandissante et une persécution de plus en plus oppressante, rendant son engagement dans l’écriture d’autant plus vital.
Parallèlement, Etty entame une exploration spirituelle profonde. S’affranchissant des dogmes religieux traditionnels, elle développe une relation intime avec Dieu, adoptant une forme de mystique personnelle caractérisée par une acceptation du destin et une aspiration à un amour universel. Cette spiritualité, plutôt qu’un refuge passif, se révèle être un puissant moteur de transformation. Elle lui permet de donner un sens aux événements tragiques qui l’entourent et de puiser dans une force intérieure inépuisable.
Elle découvre que la prière n’est pas une simple supplication ni une attente d’aide extérieure, mais bien un dialogue intérieur, une façon de structurer son esprit et d’appréhender la réalité sans se laisser envahir par la haine ou la peur. Au gré de ses écrits, elle construit peu à peu une théologie du quotidien, où chaque instant, même le plus sombre, se présente comme une opportunité de croissance intérieure.
Pour Etty, l’amour se mue en une véritable forme de résistance. Il ne s’agit pas d’un amour sentimental ou exclusif, mais d’un amour inconditionnel envers le monde et ses habitants, malgré l’horreur ambiante. Ce refus de la haine constitue un acte d’affirmation radicale de son humanité. Face à la brutalité et à l’oppression, elle choisit d’opposer à la violence une force de compréhension et d’acceptation résolue, un engagement qui transcende la souffrance individuelle.
Sa conception de l’amour, empreinte d’une lucidité remarquable, repose sur la compréhension que le mal se nourrit de la rancœur. Pour ne pas sombrer dans la barbarie, il est essentiel de préserver en soi une capacité d’émerveillement et de compassion. Cet amour, loin d’être une abstraction, s’exprime dans les gestes du quotidien : une parole bienveillante, un sourire, une main tendue. C’est un amour qui résiste à l’anéantissement, affirmant avec force la dignité humaine face à l’inhumanité.
En résumé, cette période marque une transition essentielle dans le parcours d’Etty Hillesum. De jeune femme tourmentée par ses démons intérieurs, elle se transforme en une figure lumineuse de la résistance intérieure. Son écriture, sa quête spirituelle et son amour inébranlable pour l’humanité deviennent les fondations de sa métamorphose, lui permettant d’affronter les épreuves à venir avec une force renouvelée.
L’accomplissement (1942-1943)
En 1942, alors que la persécution des Juifs aux Pays Bas se fait de plus en plus vive, Etty Hillesum opte pour une décision radicale : au lieu de se cacher, elle choisit d’accompagner son peuple en s’engageant volontairement comme employée administrative au camp de transit de Westerbork. Là-bas, elle est confrontée aux souffrances indicibles de ses coreligionnaires, mais refuse de se laisser envahir par la haine ou le désespoir. Son journal, devenu véritable acte de résistance, offre un regard empreint d’une humanité tenace face à l’horreur ambiante.
Ce choix dépasse le simple courage physique et incarne une posture philosophique et spirituelle singulière. Etty ne perçoit pas Westerbork comme un lieu de passage menant inévitablement à la destruction, mais comme un espace où elle peut exercer son influence, insuffler de l’espoir et nourrir son combat intérieur. Son rôle au camp dépasse largement celui d’une fonction administrative : elle se transforme en confidente, en présence réconfortante pour ceux qui, autour d’elle, sombrent dans le désespoir. À travers son journal, elle dévoile non seulement les conditions de vie terribles du camp, mais aussi la force de son engagement personnel. Son choix n’était pas de la résignation ou de l’abdication, mais plutôt une acceptation de l’inéluctable et – malgré le danger – de témoigner.
Jusqu’à son dernier jour, Etty continue d’écrire. Ses lettres et son journal expriment une sérénité poignante et une acceptation du destin qui frôle la sainteté. Dans son ultime message, rédigé à bord d’un wagon en route vers Auschwitz, elle célèbre la vie et refuse de laisser l’horreur altérer sa foi en l’humanité. Plutôt que de fuir ou de se rebeller contre le destin qui l’attend, elle choisit de lui donner un sens et de l’accueillir comme une étape finale de son cheminement intérieur.
Son écriture devient alors un héritage pour l’humanité. Par ses mots, elle enseigne que la souffrance ne doit pas engendrer la haine et que l’amour peut subsister même au cœur du chaos. Elle cultive une sagesse rare, refusant de se laisser happer par la brutalité environnante et y opposant une force d’âme inébranlable. Ses derniers écrits témoignent d’une foi en l’homme qui ne vacille malgré les épreuves.
Etty Hillesum a été déportée à Auschwitz avec sa famille le 7 septembre 1943. On suppose qu’elle a été sélectionnée pour le travail forcé, mais elle a pu être envoyée directement à la chambre à gaz. Son sort exact est inconnu et il n’y a aucun témoignage de survivants qui l’aient vue dans le camp. La Croix-Rouge a fixé sa date de décès conventionnelle au 30 novembre 1943. Ses écrits ont été détruits par les nazis à son arrivée à Auschwitz. Son histoire est un témoignage poignant de la tragédie de la Shoah, mais aussi de la force spirituelle et de la détermination d’une femme face à l’horreur
L’œuvre d’Etty Hillesum résonne bien au-delà de son époque. Son journal, publié après la guerre, demeure un texte essentiel de la littérature sur la Shoah et de la quête spirituelle. Son refus du ressentiment, son humanisme lumineux et son aspiration à une transcendance universelle font d’elle une figure singulière qui continue d’inspirer les générations. Son héritage ne se limite pas à ses écrits ; il se manifeste également dans la manière dont elle a vécu ses convictions. Etty n’a pas seulement écrit sur la bonté, la paix et l’acceptation : elle a incarné ces valeurs jusqu’à son dernier souffle. Son exemple a inspiré de nombreux penseurs, philosophes et écrivains, qui voient en elle une figure de résistance spirituelle et morale. Aujourd’hui, son journal est étudié dans les universités et analysé à la lumière des grandes traditions mystiques et philosophiques.
Une voix qui traverse le temps
L’histoire d’Etty Hillesum dépasse les pages de son journal et les analyses biographiques qui lui sont dédiées. Elle interroge notre rapport à la souffrance, à l’acceptation et à la transcendance. Son parcours, marqué par une rapide évolution vers une spiritualité profondément incarnée, nous rappelle que l’écriture peut constituer un acte de résistance, un refuge contre l’anéantissement intérieur et un moyen de transformer l’indicible en un témoignage pérenne.
Judith Koelemeijer dresse dans cette biographie qui fait désormais autorité, un portrait d’une finesse remarquable, révélant toute la richesse et la complexité de cette jeune femme qui, en moins de deux ans, a su transformer son existence en une véritable œuvre d’art spirituelle. Son courage réside dans sa capacité à affronter la réalité avec une lucidité inébranlable, à ne pas fuir la douleur mais à lui conférer un sens, à transformer la contrainte en choix et le tragique en élévation intérieure. Marquée par une résilience exceptionnelle, elle incarne une figure complexe, faite de doutes et de contradictions, dont la quête spirituelle et intellectuelle continue de résonner aujourd’hui.
À travers ses écrits, Etty Hillesum enseigne que l’amour répond à la haine, que la sérénité constitue une force face au chaos et que, même dans les heures les plus sombres, il est possible de choisir de rester humain. Son journal ne se contente pas de raconter la Shoah : il s’impose comme un guide de survie spirituelle, une invitation à la contemplation et à la recherche d’un absolu qui transcende la barbarie. Aujourd’hui encore, sa voix résonne avec une intensité bouleversante, nous rappelant que la grandeur d’un être ne se mesure pas à sa survie physique, mais à la manière dont il transforme son destin en un témoignage d’amour et de lumière. Son héritage demeure un phare pour ceux qui, face à l’adversité, cherchent un sens au-delà de l’horreur.