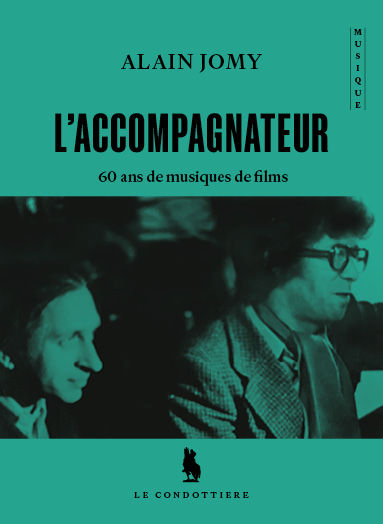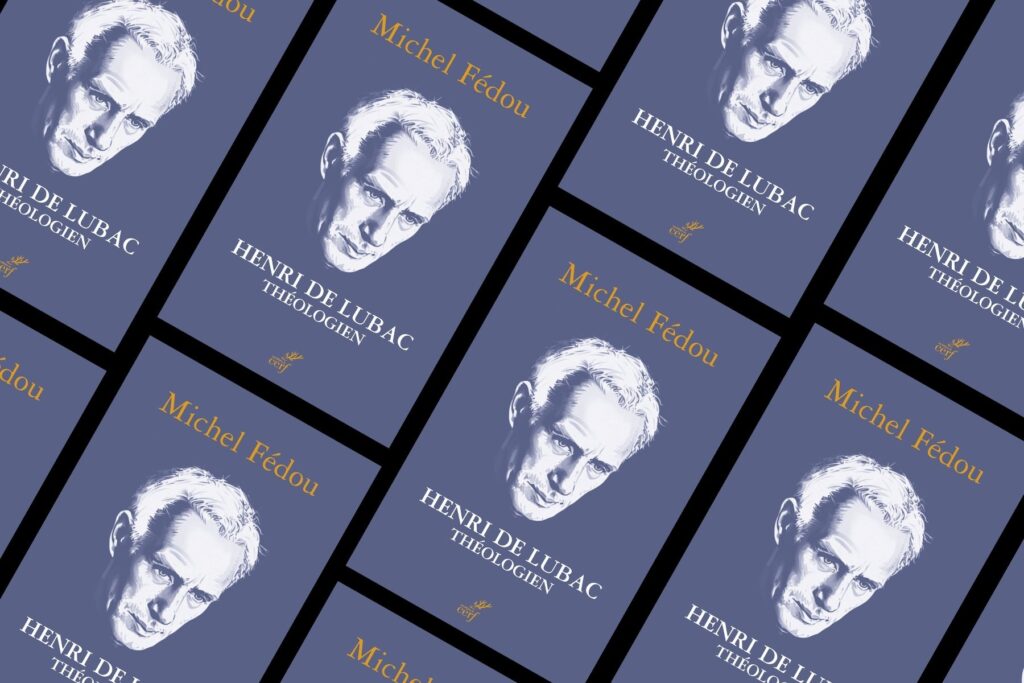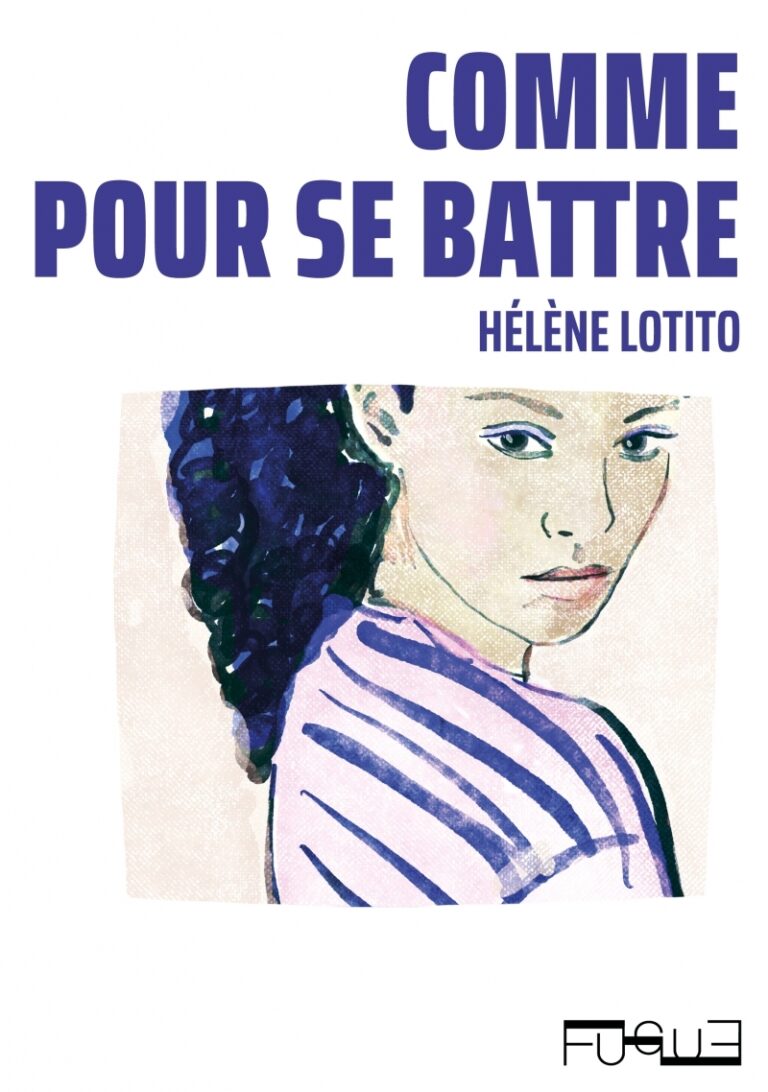Roselyne Febvre, Le pacte du désert, Éditions du Rocher, 05/03/2025, 360 pages, 21,90€
Dans Le pacte du désert, Roselyne Febvre brosse le portrait d’une figure historique et nous convie surtout à une traversée initiatique, à la fois intime et géopolitique, sur les traces brûlantes de Gertrude Bell. Cette femme, météore insaisissable dans le ciel corseté de l’Angleterre victorienne et édouardienne, fut tout à la fois aventurière intrépide, archéologue visionnaire, alpiniste émérite, cartographe de génie et diplomate au cœur des recompositions explosives du Moyen-Orient. Roselyne Febvre, par une plume qui allie souffle romanesque et rigueur documentaire, nous la restitue dans toute sa solaire et douloureuse complexité.
D’un crépuscule à l’autre : l’héritage secret de Gertrude Bell
Le récit s’inaugure par une scène crépusculaire, presque un adieu avant la lettre : Bagdad, 12 juillet 1926. Gertrude Bell, minée par la maladie et cette solitude qui fut à la fois son fardeau et le creuset de ses plus audacieuses entreprises, contemple ses derniers instants, tandis que les vers du poète persan Hafez, ” Oh, toi qui cherches les clefs / de la Vie et de la Mort “, flottent dans l’air comme une ultime confidence. Cette entrée en matière, préambule à une vie vécue comme une épopée et achevée dans un isolement presque monacal, donne le la d’une exploration des marges, là où l’éclat public dissimule mal les fêlures intimes, où l’architecte d’un nouvel Irak pleure en silence les amours sacrifiées : Henry Cadogan, la promesse brisée par le véto paternel et Dick Doughty-Wylie, la passion dévorante et adultère fauchée à Gallipoli. Ce tombeau des illusions est cependant le terreau d’une transmission inattendue, matérialisée par l’introduction subtile d’une figure contemporaine, Maya Evans, universitaire syro-britannique. L’arrière-grand-père de Maya, Fattuh, fut le guide fidèle, le confident mutique de Bell, et c’est lui qui lègue à sa descendante une malle, Arche d’alliance contenant les carnets inédits de l’aventurière. Ainsi, Maya, et Roselyne Febvre par son truchement, devient l’archéologue d’une âme, exhumant une mémoire menacée, tissant un fil ténu mais puissant entre les époques. Ce dispositif narratif, où la fin d’une vie annonce la quête d’une autre pour en reconstituer le sens, souligne d’emblée les thèmes de la solitude, de l’oubli face à l’Histoire officielle, et de cette étrange pulsion de vie qui, même au seuil de la mort, anime Gertrude dans ses souvenirs des sables et des passions. L’écriture devient alors un acte de réparation, une manière de rendre à Gertrude Bell cette voix que la Grande Histoire, souvent écrite par et pour les hommes, lui avait en partie confisquée, la réduisant parfois à l’ombre d’un T.E. Lawrence.
Corps et âme dans les sables : l’expérience totale du désert
L’Orient, pour Gertrude Bell, fut bien davantage qu’une destination ou un champ d’études ; il fut le miroir éclaté et magnifique d’une âme en quête d’elle-même, un espace de réinvention radicale, bien loin des salons feutrés et des conventions étouffantes de son Angleterre natale. Roselyne Febvre, avec une palette descriptive d’une richesse inouïe, nous immerge dans les premières expéditions de Gertrude Bell en Syrie, en Jordanie, en Mésopotamie. On ressent presque physiquement la morsure du vent sur les dunes, l’ivresse des nuits sous un ciel constellé, l’âpreté des rencontres avec des tribus dont elle apprendra les dialectes, les codes, les allégeances fluctuantes. Sa fascination pour le désert, cette ” solitude qui n’est pas vide mais pleine de traces humaines “, est moins une fuite qu’une élection, un lieu où son intelligence, son insatiable curiosité et sa résistance physique hors norme peuvent enfin s’épanouir sans entraves. La découverte de la forteresse d’Al-Ukhaidir, en 1909, devient ainsi une métaphore de sa propre quête : exhumer du sable de l’oubli des pans entiers de civilisations, mais aussi, peut-être, les fragments enfouis de sa propre identité. L’archéologie, sous la plume de Roselyne Febvre, se mue en une véritable herméneutique de l’existence : chaque relevé topographique, chaque tesson de poterie, chaque inscription déchiffrée est un pas de plus vers la compréhension non seulement d’un passé lointain, mais aussi des mécanismes complexes du pouvoir et de la culture. Le désert devient son véritable maître, celui qui lui enseigne la patience, la résilience, et cette forme particulière de lucidité face à la fragilité des empires et des destins humains. C’est dans cet univers minéral et immuable qu’elle trouve une forme de pacte tacite, une harmonie éphémère avec un monde qui, par son dépouillement même, la confronte à l’essentiel et la prépare, sans qu’elle ne le sache encore tout à fait, aux arcanes tortueux de la diplomatie et de la construction nationale. Son regard, à la fois érudit et poétique, sur les paysages et les peuples, préfigure déjà cette capacité unique à naviguer entre les lignes de faille d’un Moyen-Orient en pleine ébullition, dont elle deviendra, pour un temps, l’une des cartographes les plus écoutées et les plus controversées.
Une “Reine sans couronne” : servir l’Empire tout en aimant les peuples
L’implication de Gertrude Bell dans la redéfinition géopolitique du Moyen-Orient, et singulièrement dans la genèse de l’Irak moderne, constitue le cœur battant, et souvent douloureux, du roman de Roselyne Febvre. En ne sombrant pas dans la simplification hagiographique, l’autrice explore avec une acuité remarquable les ambivalences d’une femme qui, tout en servant les intérêts de l’Empire britannique, nourrissait une affection sincère pour les peuples arabes et aspirait à une forme d’autodétermination pour eux, fût-ce sous une tutelle bienveillante. Sa collaboration avec T.E. Lawrence, “son cher petit”, est restituée dans toute sa complexité, alliance de deux intelligences hors normes fascinées par le monde arabe mais souvent en désaccord sur les stratégies, partageant un destin de météores qui, après avoir brillé de tous leurs feux, seront confrontés à la désillusion et à une forme d’oubli relatif. La conférence du Caire en 1921, où, sous l’impulsion de Winston Churchill, se dessinent la couronne du roi Fayçal et les frontières d’un Irak artificiellement unifié, est un moment d’une densité dramatique intense. Roselyne Febvre y montre une Gertrude Bell au sommet de son influence, manœuvrant avec une habileté consommée, mais déjà consciente des germes de conflits futurs que ces tracés à la règle, ignorant les mosaïques tribales et ethniques séculaires, ne manqueraient pas de semer. Le “pacte du désert” prend ici une coloration amère, celle des promesses impériales souvent trahies, des peuples ballottés au gré d’intérêts qui les dépassent. La transmission de son savoir intime des tribus, de ses cartes méticuleuses, est un outil précieux pour l’Empire, mais elle-même semble parfois prise au piège de son propre rôle, “reine sans couronne” d’un royaume dont elle a dessiné les contours mais dont elle ne maîtrisera jamais tout à fait le destin. L’acte d’écrire, à travers ses carnets et ses rapports, devient pour Gertrude Bell un moyen de consigner, peut-être de justifier, ses actions, mais aussi de déposer le poids d’une lucidité parfois écrasante sur la nature du pouvoir et les cicatrices indélébiles laissées par le colonialisme. L’héritage de son œuvre, notamment la création du musée archéologique de Bagdad, apparaît alors comme une tentative de préserver une mémoire, une identité, face aux forces dissolvantes de l’Histoire et des ambitions politiques, un dernier rempart contre l’oubli, pour un pays et pour elle-même, dans un écho poignant à sa propre quête inassouvie de reconnaissance et d’ancrage. Roselyne Febvre, en nous confrontant à cette complexité, évite le jugement anachronique et nous invite plutôt à une réflexion sur les responsabilités de l’Occident et sur la figure tragique de celle qui, en voulant bâtir un avenir, a peut-être contribué à enchevêtrer un peu plus les fils d’un présent toujours plus instable.