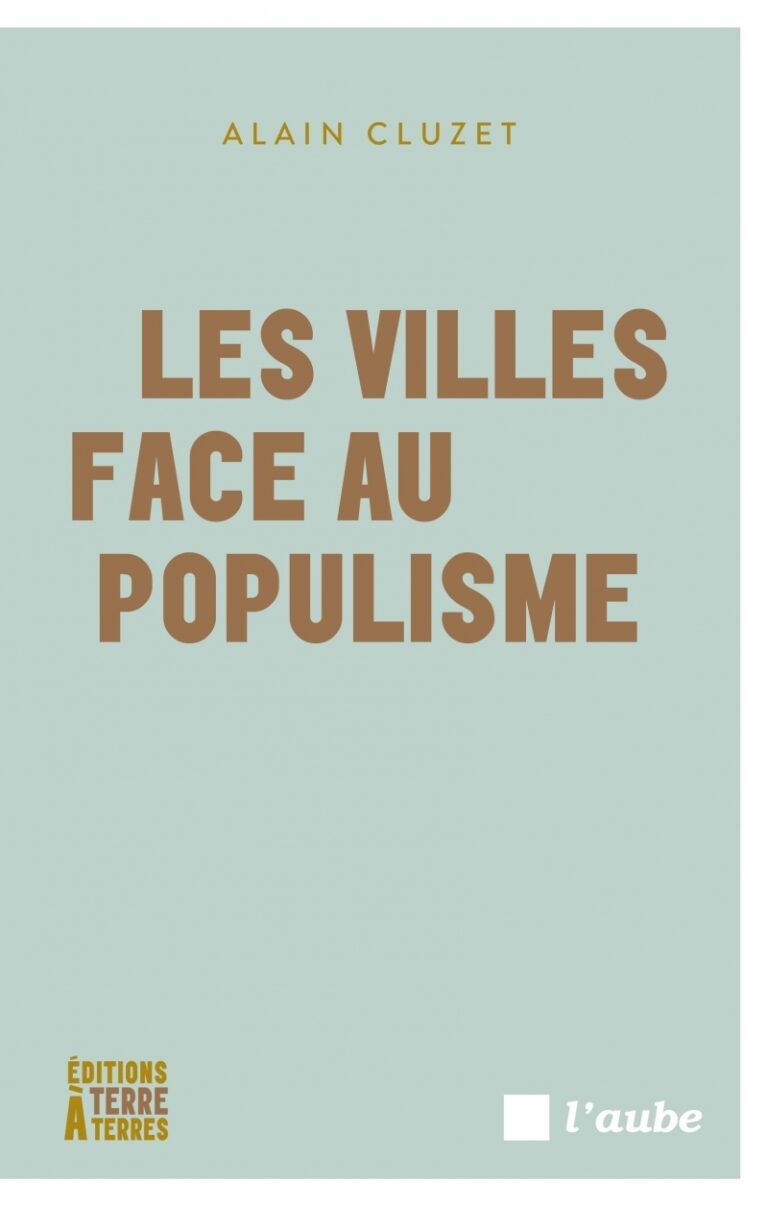Haouès Séniguer, Dieu est avec nous ! Le 7 octobre et ses conséquences. Ed. Le Bord de l’eau. 22/08/2025, . 278 Pages. 20 €
L’objet de ce livre est d’analyser comment « un certain judaïsme et un certain islam politisés » ont contribué à la légitimation et à la sacralisation de la violence, en prenant le 7 octobre 2023 comme point de focalisation et en le replaçant dans un « temps long ». Le 7 octobre est pris comme un moment charnière. Autrement dit, comment, dans le contexte de l’attaque du 7 octobre des formes de religion (juive et islamique) ont été mobilisées pour légitimer la violence. La compréhension de cette propension à fonder son regard sur la part victimaire en réaction nous permet d’apprécier comment la religion s’insère dans les conflits contemporains, et comment elle est utilisée dans des discours de « droit à résister » ou « droit à se défendre ». Haouès Séniguer évoque également les implications des deux communautés confessionnelles en France, et leur déploiement sur le sol national.
Le 7 octobre sert donc de point de départ mais les logiques sont plus anciennes.
Quelle responsabilité historique, politique, sociale cela suppose-t-il ? Les réactions à cet évènement barbare (contre-violences, guerre à Gaza, polarisation en France) sont extrêmement mouvantes. On se heurte à une complexité qui nous dépasse ; et pour cette raison il est utile de prendre de la hauteur et du champ. Pour ce faire, il s’intéresse à la façon dont un certain « judaïsme politisé » et, un certain « islam politisé » jouent un rôle dans les mécanismes de violence sacralisée. Essayer d’avancer sans tomber dans le piège de la culpabilisation ou de la victimisation. Bien au contraire, le regard doit s’ouvrir pour critiquer les ressorts de la religion comme instrument politique. Comme le disait Jean Starobinski c’est la disposition pour garder « L’œil vivant ».
Étudier ce phénomène dans « le Temps long »
Cependant, pour pouvoir dégager des pistes de réflexion, et éventuellement des lignes d’approche, le « Temps long » est nécessaire pour montrer que ces logiques ne commencent pas avec le 7 octobre, mais ont des racines plus anciennes. Il nécessite un aller-retour entre événement récent et généalogie historique et idéologique des discours religieux-politiques. Cette méthode (micro-événement et aller-retour sur le temps long) est solide pour éviter des conclusions purement émotionnelles. La situation géopolitique depuis le 7 octobre reste évolutive (escalade, réactions internationales, enquêtes, procès, évolutions sociales). La lecture « à chaud » est trop partielle. Il faut déchiffrer constamment le contexte et d’éviter des affirmations datées. Les entretiens montrent que l’auteur tente de replacer l’événement dans une histoire plus longue pour limiter ce biais. Haouès Séniguer met en lumière la « surenchère » et la « sacralisation » de la violence au nom de Dieu.
L’auteur ne reste pas dans la sphère moyen-orientale
Il s’intéresse au contexte français parce que la France compte d’importantes communautés juive et musulmane. Le livre peut donc alimenter un débat sur l’« islamisme radical », sur le « suprémacisme juif » ou sur les dérives religieuses en contexte démocratique. L’essai nous invite à faire la part des choses. Même si l’intention est comparative, il est toujours difficile de traiter deux traditions aussi riches et variées que l’islam et le judaïsme sans tomber dans des généralisations. Par exemple : « un certain judaïsme politisé », « un certain islam politisé » … mais comment définit-on ces « certains » ? On reste à la périphérie du phénomène ou on entre dans son cœur ? Il faut vérifier si l’auteur fournit suffisamment d’exemples concrets, de textes, de discours, ou s’il reste sur un plan plus abstrait. Il conviendrait de voir comment il gère l’actualité et la nuance. Vérifier, par exemple, à quel point l’auteur distingue clairement le religieux « instrumentalisé » du religieux « vécu » comme spiritualité pacifique.
L’essayiste n’aborde pas la religion en bloc
Il analyse des formes politisées et instrumentalisées des confessions qui servent à justifier la violence. Il définit ce qui est « politisé » au travers des thématiques suivantes : idéologies messianiques, nationalistes religieux, acteurs étatiques vs non étatiques — la clarté conceptuelle est cruciale. Il met en lumière des contre-exemples : mouvements religieux pacifistes, prises de position interconfessionnelles. La critique ne peut pas admettre des jugements posés dans « l’à-peu-près », mais au contraire doit pouvoir permettre d’interroger les discours, les textes et les acteurs de terrain. Traiter simultanément des usages politiques de l’islam et du judaïsme évite l’écueil d’un regard unilatéral, à repérer des mécanismes communs (sacralisation de la violence, rhétorique du « droit à résister » en regard du « droit à se défendre »). C’est montrer aussi la circularité des violences et contre-violences.
Une surenchère et une sacralisation de la violence au nom de Dieu
On observe des formes discursives qui présentent la violence comme légitime : soit comme « droit à résister » soit comme « droit à se défendre ». Une mise en garde importante sur les effets collatéraux de la sacralisation de la violence. Elle touche aussi le vivre-ensemble en France, dans les communautés. Plutôt que d’affirmer en posant des jugements universels qui tomberaient comme des réalités acquises, il préfère tester ses hypothèses. Pour cette raison fondamentale, l’auteur cherche à dialoguer avec le monde contemporain. Ce dialogue promet la recherche des attitudes et des actions positives, performatives, et des initiatives interconfessionnelles.
Le discours sociétal actuel comporte des risques évidents.
Si l’auteur en est conscient, le lecteur doit aussi garder cette vigilance vive. Le corpus de sources (textes religieux, discours militants, médias) peut être déséquilibré : si l’accent est mis sur les acteurs extrêmes, on peut craindre un biais vers l’exception plutôt que le « courant majoritaire ». L’équilibre entre l’analyse théologique et l’analyse politique (stratégies, pouvoir, conflit) est complexe. Certaines interprétations pourront à l’avenir être remises en cause par les évolutions du terrain, et selon ce qui va advenir dans les mois et les années à venir. Le livre est donc à lire comme un instantané analytique dans une dynamique
Dans des entretiens et articles autour du livre, l’auteur articule argumentation académique et propos accessibles au grand public : utile pour alimenter le débat civique et médiatique. L’entretien dans Le Monde illustre la volonté d’intervention publique. Le corpus des sources (textes religieux, sermons, réseaux sociaux, discours politiques, presse) apporte une vraie richesse et des éléments efficaces de compréhension. La Théologie, pour sa part, exige une lecture lente et patiente des textes et traditions. L’exercice comparatif exige d’être expert dans plusieurs registres et de s’entourer d’experts. Les recensions notent la tonalité théologico-politique. Il y a toujours un risque à concilier l’analyse théologique et la politique sans simplification. Il y a un travail de mise en lumière de la façon dont certains acteurs (groupes politico-religieux, courants ultrareligieux, voire États ou gouvernements) mobilisent un langage sacré ou théologique pour armer des logiques de violence, et ce tant du côté israélien que palestinien. Aborder « comment les religions justifient la violence » est une ambition forte mais risquée : il y a un danger de réduire la religion à un « moteur de violence » sans suffisamment nuancer les nombreux volets pacifiques, humanistes, et modérés.
Le livre « Dieu est avec nous ! » apporte une contribution importante sur les études sur la religion et la violence, et au débat sur le rapport entre foi et pouvoir. Le lecteur pourra accompagner sa lecture d’autres sources complémentaires pour avoir une vue plus complète. Lire d’abord l’introduction méthodologique pour identifier le corpus et les définitions (surtout « politisé »), se reporter à l’apport critique et universitaire et évaluer la validité des analogies. Le pouvoir explicatif d’un livre comparatif tient beaucoup aux sources mobilisées (textes religieux, discours politiques, médias, prêches, manifestes). Le corpus privilégie des exemples extrêmes ou marginaux. Il faut en mesurer leur représentativité. Les comptes rendus universitaires proposent de vérifier la diversité des sources.
Son étude permet au lecteur de dépasser les explications purement géopolitiques ou militaires. Le sujet reste sensible auprès de ces communautés confessionnelles. L’effet collatéral possible est une stigmatisation politique dans le débat public, en particulier dans un contexte français polarisé risque toujours de partir de façons désordonnées et violentes. L’ouvrage nécessite une bonne dose de réflexion et d’ouverture à des terrains sensibles. Ce livre peut être un support de réflexion utile sur les discours religieux, la radicalisation, l’articulation religion-politique.
L’avenir appartient à ceux qui sauront lire les évènements, ceux qui sauront en dégager ce qui a de plus positif pour que les religions ne soient pas des vecteurs de haines ou d’exacerbations mais des lieux de confluences et de concorde. Il y a sur cette Terre des lieux et des personnes qui essayent de dialoguer, de vivre ensemble ; et c’est sur celles-ci qu’il faut bâtir l’avenir. Vœu pieux ou possibilité réelle… Si nous le voulons !