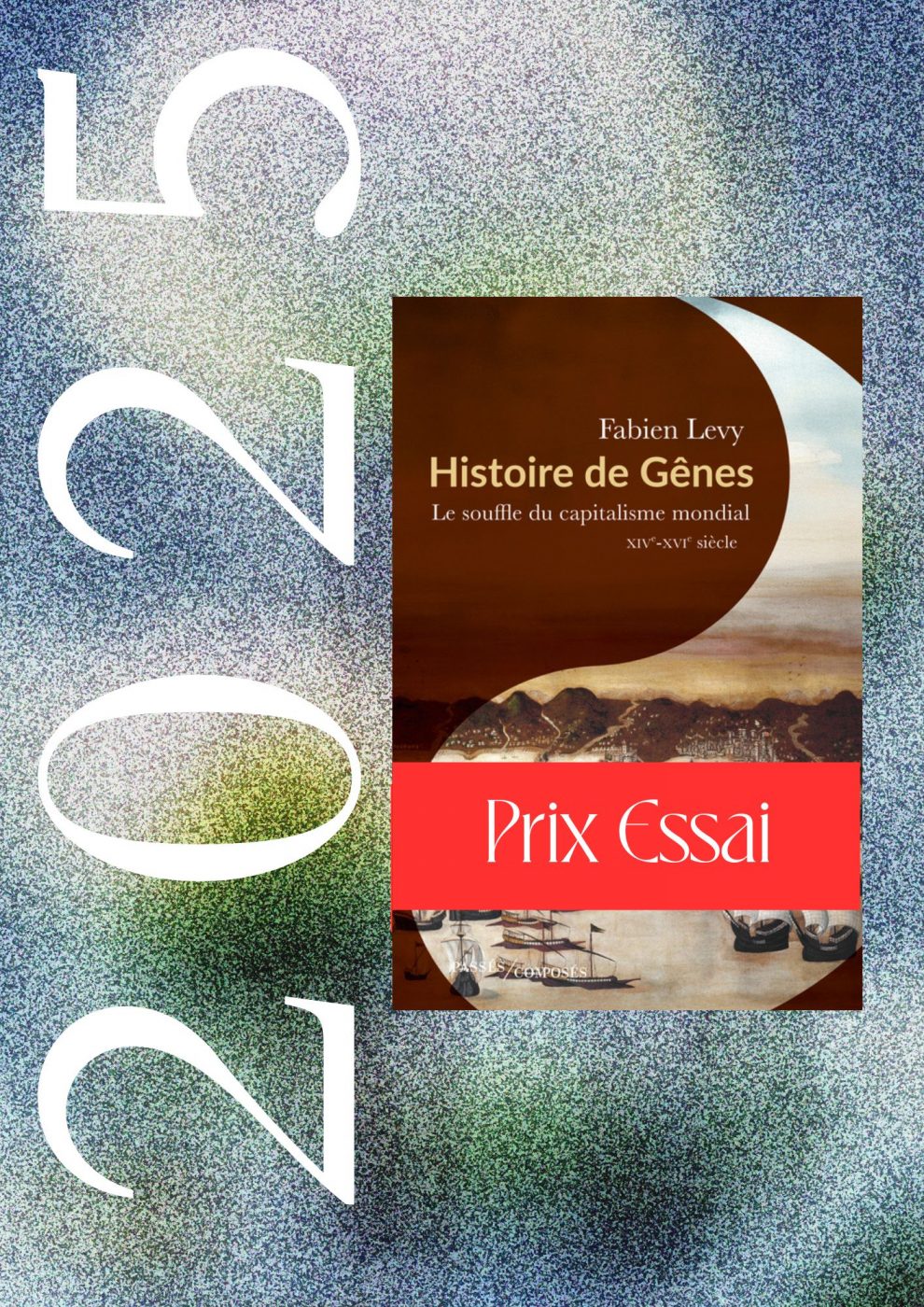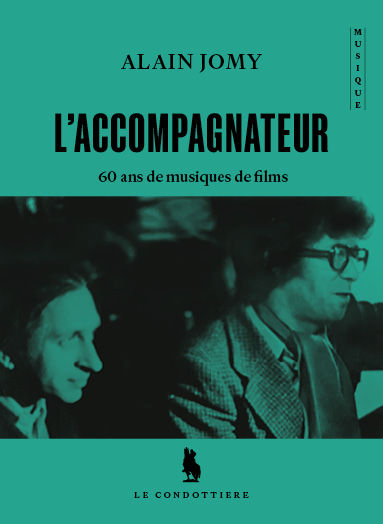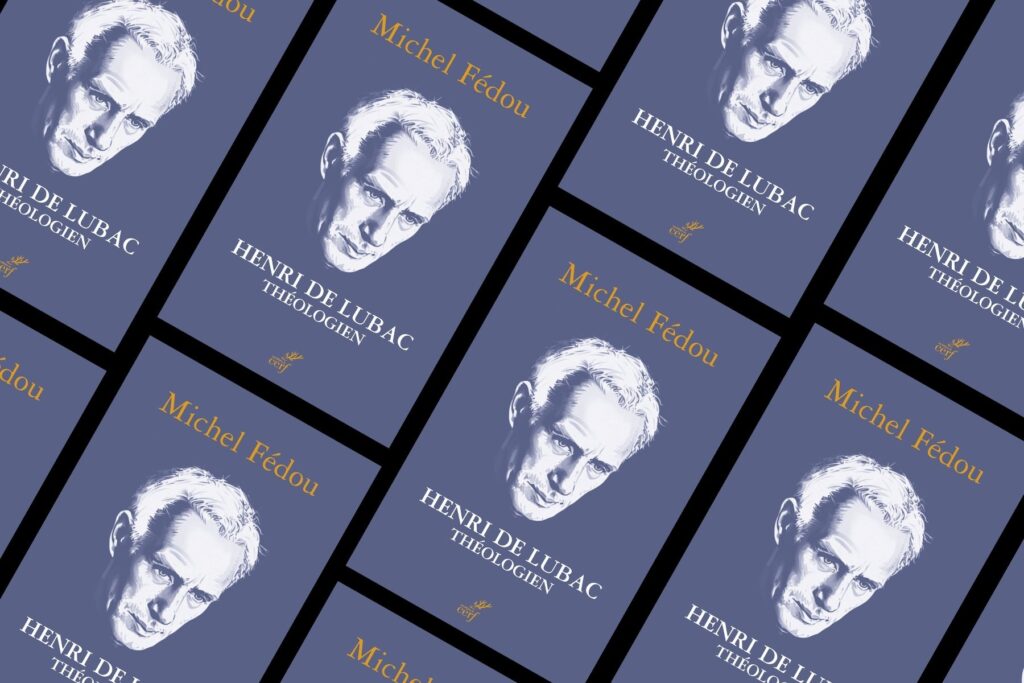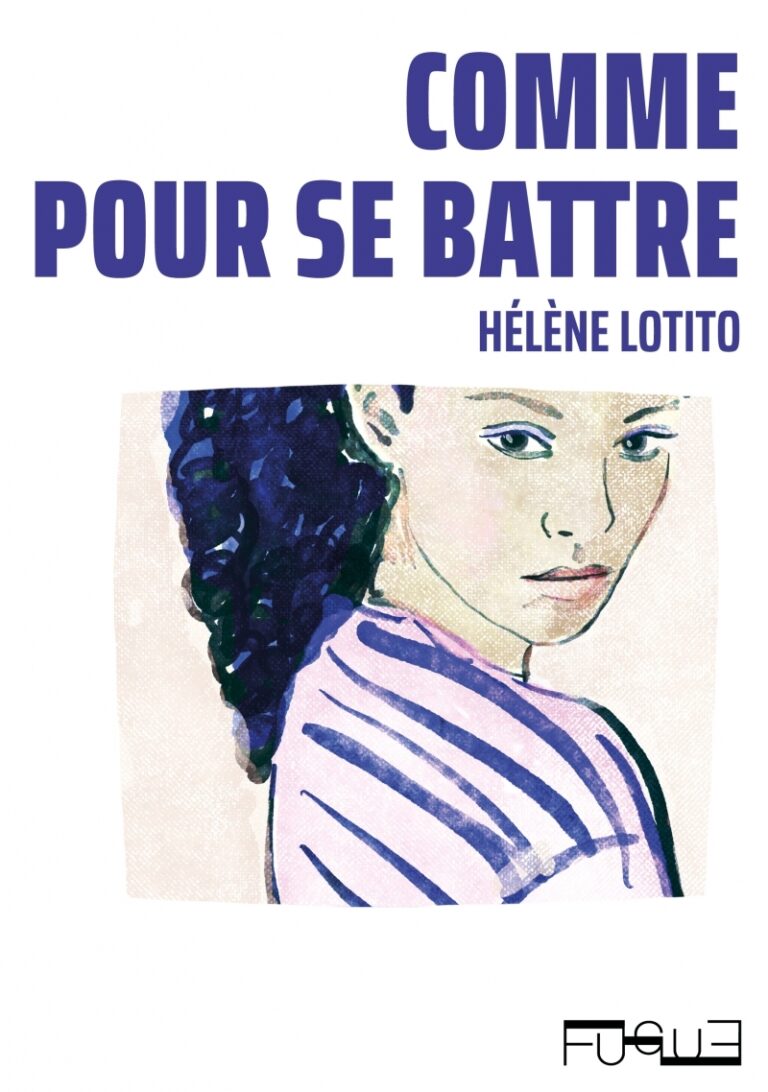Fabien Levy, Histoire de Gênes, Passés Composés, 28/04/25, 313 pages, 24,90€
Historien médiéviste et enseignant en classes préparatoires, Fabien Lévy nous plonge dans l’épopée de Gênes, cité marchande qui, du XIVe au XVIe siècle, a tissé les premiers fils du capitalisme mondial. À travers une narration fluide et érudite, il dévoile comment cette république maritime a su, malgré les tumultes politiques, devenir le cœur battant des échanges économiques de son temps.
Une cité-monde avant l’heure
Gênes, enserrée entre l’austérité de ses montagnes ligures et l’immensité prometteuse de la Méditerranée, se révèle, sous la plume de Fabien Lévy, comme un archétype singulier de la ville-monde avant l’heure, un carrefour d’ambitions et un laboratoire où s’expérimentèrent, avec une acuité parfois brutale, les prémices d’une économie globalisée. Dès l’introduction, l’ouvrage établit son envergure : l’auteur ne se propose pas une monographie figée, mais une fresque dynamique, traçant les contours d’une entité politique et économique qui, avec une plasticité déconcertante, absorbe les chocs pour mieux se réinventer. Fabien Lévy adopte une démarche qui conjugue la rigueur chronologique avec une analyse thématique pénétrante, où les vicissitudes politiques de la République – ce ballet incessant de doges éphémères, de factions (Adorno, Fregoso, Grimaldi, Doria) se disputant les oripeaux d’un pouvoir communal paradoxalement indigent – servent de toile de fond à l’exploration des mécanismes profonds d’une résilience économique hors du commun. Le célèbre adage, “Genuensis, ergo mercator“, prend alors une dimension nouvelle, celle d’un ethos collectif orienté vers l’accumulation, l’investissement et une gestion quasi-instinctive du risque. Ainsi, l’humiliation politique du XVe siècle, loin de sonner le glas de la cité, agit comme un catalyseur, contraignant Gênes à un redéploiement stratégique de ses réseaux, un pivotement subtil de la Méditerranée orientale vers l’Occident et l’Atlantique.
Les premiers chapitres nous confrontent à la grandeur initiale de Gênes “la Superbe“, bâtisseuse d’un empire maritime informel, reposant davantage sur un maillage de comptoirs et une maîtrise des flux que sur une domination territoriale classique – contraste saisissant avec sa rivale, Venise, dont l’emprise sur la terraferma obéit à une logique distincte. La fragilité inhérente à cet empire “réticulaire” se manifeste par une sensibilité extrême aux mutations géopolitiques : l’avancée ottomane, la consolidation des monarchies ibériques, l’émergence de nouvelles routes commerciales. Lévy met en lumière cette dialectique entre la puissance économique, construite sur l’initiative individuelle et la flexibilité des structures familiales (les Alberghi), et la faiblesse institutionnelle d’une République en proie aux querelles intestines. La financiarisation précoce de l’économie génoise, avec l’invention et la sophistication des instruments de crédit, d’assurance et de change, ainsi que la gestion complexe de la dette publique par la Casa di San Giorgio, apparaît alors comme une réponse ingénieuse, bien que périlleuse, aux défis de son temps. Ce n’est donc pas un déclin que dépeint l’auteur, mais une phase de “destruction créatrice” schumpétérienne, où l’ancien modèle de la thalassocratie méditerranéenne cède le pas, sous la contrainte, à une entité d’une nature nouvelle, anticipant ce que Fernand Braudel appellera plus tard “le siècle des Génois“.
Le capitalisme génois à l’âge de la finance
L’œuvre de Fabien Lévy, tout en retraçant le destin sinueux de Gênes, de la “Superbe à l’Humiliée” puis à sa renaissance en tant que pivot financier de l’Empire espagnol, invite à une réflexion qui dépasse le strict cadre historique. L’analyse du basculement vers l’Occident, par exemple, met en exergue la capacité d’adaptation d’une élite marchande contrainte par la fermeture progressive des marchés orientaux. Ce mouvement n’est pas un redéploiement géographique : il s’accompagne d’une transformation structurelle de l’économie, avec l’essor de l’industrie (soie, papier) et, surtout, une sophistication accrue des pratiques financières. L’auteur excelle à démontrer comment les structures capitalistes du rebond – sociétés par carati, réseaux familiaux transnationaux, maîtrise de l’information – s’affinent précisément durant cette période de crise apparente. La transition du marchand aventurier au banquier sédentaire, orchestrant ses affaires depuis son palazzo grâce à un dense réseau de correspondants, est l’un des fils conducteurs les plus stimulants du livre. On songe ici, par un détour contemporain, à la manière dont les start-ups technologiques d’aujourd’hui, avec leur agilité et leur capacité à lever des capitaux, disruptent des marchés établis, un peu à la manière des financiers génois qui, délaissant les modèles commerciaux plus traditionnels de leurs concurrents, investissent massivement le champ alors novateur des prêts aux souverains et du change international.
Les chapitres consacrés à l’exploitation des îles atlantiques et aux premiers pas des Génois en Amérique illustrent parfaitement cette “technostructure impériale” avant la lettre. Christophe Colomb, loin d’être une figure isolée, s’inscrit dans une tradition d’exploration et d’entreprise typiquement génoise, où l’audace individuelle s’appuie sur des compétences nautiques, cartographiques et commerciales collectives. L’ouvrage souligne avec pertinence comment, même sans État-nation puissant pour les soutenir directement, les Génois, par la capillarité de leurs réseaux et leur expertise financière, deviennent des acteurs incontournables de l’expansion coloniale ibérique. Ils financent les expéditions, organisent le commerce transatlantique, y compris, il faut le souligner, la traite négrière naissante, et participent à la mise en place des premières économies de plantation. Cette capacité à opérer “dans l’ombre de l’Empire“, à s’insérer dans les interstices du pouvoir pour en devenir une pièce maîtresse, rappelle la stratégie des “stateless powers” contemporains, ces entités qui, sans territoire souverain, exercent une influence globale par leur maîtrise des flux financiers et informationnels. La Casa di San Giorgio, véritable État dans l’État, gérant la dette publique et administrant des pans entiers du domaine colonial, est à cet égard une institution fascinante, un modèle de privatisation de fonctions régaliennes qui trouve des échos jusqu’à notre époque. Fabien Lévy, par une narration qui entrelace habilement le destin des grandes familles (les Doria, les Grimaldi, les Spinola) avec les mutations économiques et politiques, parvient à donner corps à ce capitalisme d’Ancien Régime, le rendant tangible et ses enjeux, étrangement familiers.
Ce que Gênes dit encore à notre monde
Au terme de cette fresque érudite, la question de la pertinence contemporaine de l’histoire génoise se pose avec acuité. Les thèmes explorés par Fabien Lévy – l’articulation entre initiative privée et bien public, les dynamiques de la dette souveraine, les rivalités géopolitiques pour le contrôle des routes commerciales, la résilience des réseaux face à l’instabilité des États – résonnent avec une force singulière dans notre XXIe siècle globalisé. Gênes, cette “République de l’argent”, avec son oligarchie de marchands-banquiers et sa capacité à projeter une influence bien au-delà de ses modestes frontières territoriales, offre une grille de lecture inattendue pour comprendre certaines dynamiques actuelles. Le paradoxe d’une cité politiquement fragmentée mais économiquement hégémonique invite à relativiser la prééminence du modèle de l’État-nation comme unique vecteur de puissance.
L’histoire de Gênes, telle que narrée par Lévy, devient ainsi une méditation sur la nature même du pouvoir et de la richesse. L’ascension et la chute, ou plutôt la transformation, de la cité ligure illustrent une forme de capitalisme “liquide”, pour emprunter une image à Zygmunt Bauman, capable de s’adapter, de se redéployer, de survivre aux empires qui, tour à tour, la dominent ou la sollicitent. La tension entre l’esprit civique et l’individualisme forcené apparaît comme un moteur dialectique de l’histoire génoise, expliquant à la fois ses faiblesses institutionnelles et sa formidable capacité d’innovation économique et financière. L’ouvrage de Fabien Lévy fait bien plus que de retracer une histoire : il ouvre des pistes de réflexion, invitant le lecteur à questionner les fondements de notre propre modernité économique et à reconnaître, dans le “souffle du capitalisme mondial” qui animait Gênes, des échos persistants et parfois troublants de notre propre temps. Une lecture indispensable, qui, bien au-delà du destin d’une cité-État italienne, éclaire d’une lumière crue les mécanismes pérennes de l’ambition humaine et de la quête du profit.