Éric Sadin, Le Désert de nous-mêmes, L’échappée, 03/10/2025, 262 pages, 19€
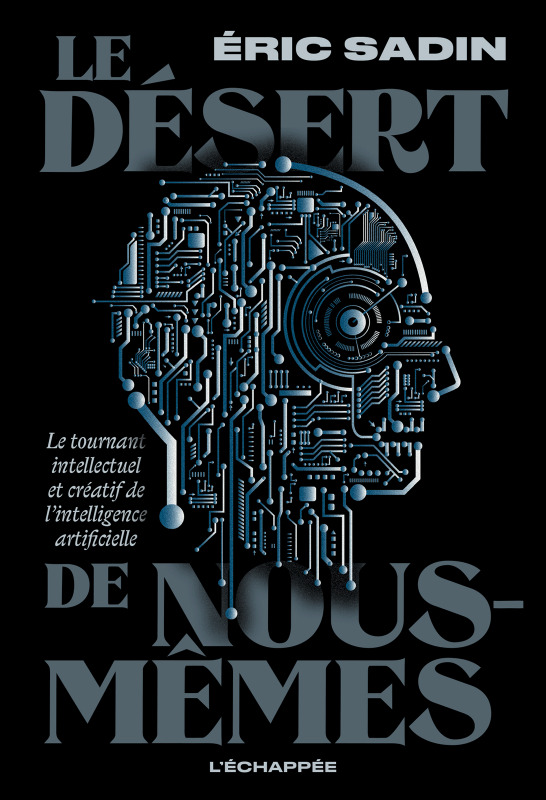
Et si la révolution technologique masquait une dissolution silencieuse, une lente et inexorable désertification de l’intériorité ? Le Désert de nous-mêmes d’Éric Sadin est moins un essai qu’un acte politique, une dissection d’une humanité en voie de se retirer d’elle-même. Oscillant entre l’allégorie inaugurale, une critique radicale des nouvelles structures de pouvoir, et un diagnostic anthropologique de notre dévitalisation, l’ouvrage tisse un fil narratif implacable : celui d’un effacement consenti de la parole humaine. Il ne s’agira pas ici de résumer un livre, mais de déplier sa mécanique argumentative, d’en sonder les soubassements philosophiques et d’en mesurer la portée politique, car Éric Sadin nous offre une cartographie précise de notre propre dépossession.
Éric Sadin révèle la mécanique cachée du fondamentalisme numérique
À défaut d’en déplorer les symptômes, Éric Sadin ausculte la structure même du mal. Son livre s’ouvre sur la parabole du rossignol philomèle, ce virtuose du chant qui, séduit par des automates produisant des mélodies sans effort, choisit le confort au détriment de l’art. Ce prologue au drame révèle la matrice de notre servitude volontaire, cette préférence pour la passivité qui innerve toute la critique du philosophe.
Mais le cœur de la machine discursive qu’il démonte réside dans sa formidable analyse du « fondamentalisme de l’IA ». Éric Sadin identifie cinq piliers qui soutiennent cette nouvelle religion séculière. Premièrement, des responsables politiques fascinés, agissant comme les promoteurs zélés d’une puissance qui les dépasse et qu’ils financent à coups de milliards. Deuxièmement, un « monde de l’intérieur » — ingénieurs, chercheurs, entrepreneurs — qui, tout en feignant de s’inquiéter des dérives par un discours sur l’« éthique », accélère sans cesse le processus. Troisièmement, des économistes, nouveaux théologiens de la croissance, pour qui l’automatisation est un destin inéluctable et désirable. Quatrièmement, des comités et des instances officielles, cautions morales du système, dont la consanguinité avec les acteurs de l’industrie technologique relève du conflit d’intérêts systémique. Enfin, les médias, qui, par fascination ou par manque de distance critique, relaient sans relâche la parole des maîtres du jeu.
À ces cinq piliers, Éric Sadin ajoute un sixième, invisible et peut-être le plus puissant de tous : « la grande illusion de la régulation ». Il y démonte avec une rigueur implacable le mensonge d’un encadrement possible. La régulation, explique-t-il, ne fait qu’entériner la logique qu’elle prétend contrôler, en raisonnant dans le cadre utilitariste du ratio avantages/risques, sans jamais poser la question fondamentale, celle des ruptures civilisationnelles.
La parole humaine remplacée par des calculs de probabilité statistique
Au cœur de ce processus, un acteur central : le langage. Éric Sadin forge le concept de « thanatologos » pour désigner ce langage mort, ce pseudo-verbe des intelligences artificielles génératives. Il ne s’agit pas d’un nouvel outil, mais d’un « anti-langage » fondé non sur l’intentionnalité, l’ambiguïté ou la singularité d’un sujet, mais sur la corrélation statistique et la probabilité. Ce langage de la conformité, qui tend à reproduire ce qui a déjà été dit, appauvrit nos représentations et sclérose la pensée.
Surcroyances et bêtise généralisée : le chaos politique qui vient
La conséquence de cette double dépossession — du pouvoir politique et du langage — est une transformation anthropologique profonde qu’Éric Sadin nomme « l’Anhumanité ». Il ne s’agit pas de la fin de l’homme au sens post-humaniste, mais de l’avènement d’une humanité vidée de sa substance, dévitalisée. C’est le portrait d’êtres en retrait, de spectateurs de leur propre existence, satisfaits de leur passivité assistée.
Cette atrophie de l’agir individuel a des conséquences politiques dévastatrices. Éric Sadin montre comment la destruction des repères communs et l’atomisation des individus dans leurs bulles de certitudes créent un terreau fertile pour une violence d’un genre nouveau. Loin des guerres classiques, c’est une « guerre de la bêtise de tous contre celle de tous », une guerre de dogmes et de « surcroyances » où l’impossibilité de dialoguer conduit à la négation de l’autre. La critique de la violence politique qui affleure est subtile et puissante, rappelant que l’érosion des contre-pouvoirs (presse, justice, savoirs critiques), eux aussi menacés par cette vague, laisse le champ libre à toutes les formes d’autoritarisme. Le style d’Éric Sadin, volontiers pamphlétaire et prophétique, est lui-même une arme. Contre la prose neutre et désincarnée de la technocratie, il oppose une écriture charnelle, engagée, où chaque phrase est une prise de position. Il ne se contente pas de décrire, il martèle. Sa rhétorique de l’effondrement est une stratégie pour réveiller les consciences anesthésiées.
Contre les salons de l’éloquence, la rigueur d’Éric Sadin
C’est précisément sur ce terrain – celui de la rigueur analytique et de la conscience politique – que le travail d’Éric Sadin se distingue de la glose médiatique, et surclasse de manière éclatante les postures d’un Raphaël Enthoven. Ce dernier, dans ses interventions, réduit l’IA à une querelle philosophique intemporelle : l’outil contre la main, le perroquet sophistiqué contre la conscience humaine. En affirmant que le problème n’est pas l’outil mais l’usage que l’homme en fait, Raphaël Enthoven commet un contresens majeur : il refuse de voir que cet outil n’est pas neutre. Il s’agit d’un système conçu, financé et déployé par un complexe techno-capitaliste qui a ses propres visées : automatiser les professions, capter l’attention, orienter les comportements et, in fine, démanteler les structures du travail et de la délibération. Demander si la machine « pense » est une question de salon qui détourne de l’essentiel, là où Éric Sadin demande : « qui en tire profit ?”, “quel monde ce système produit-il ? ». En restant prisonnier d’une opposition stérile entre l’homme et la machine, Raphaël Enthoven prouve qu’il n’a saisi ni la nature systémique, ni la portée politique du phénomène.
Face à une philosophie qui préfère poser des diagnostics élégants sur le patient sans jamais opérer, l’œuvre d’Éric Sadin est un acte chirurgical. Elle n’anesthésie pas la douleur, elle la révèle ; elle ne commente pas la gangrène, elle la découpe. Un manuel de survie pour un corps social en péril.
















