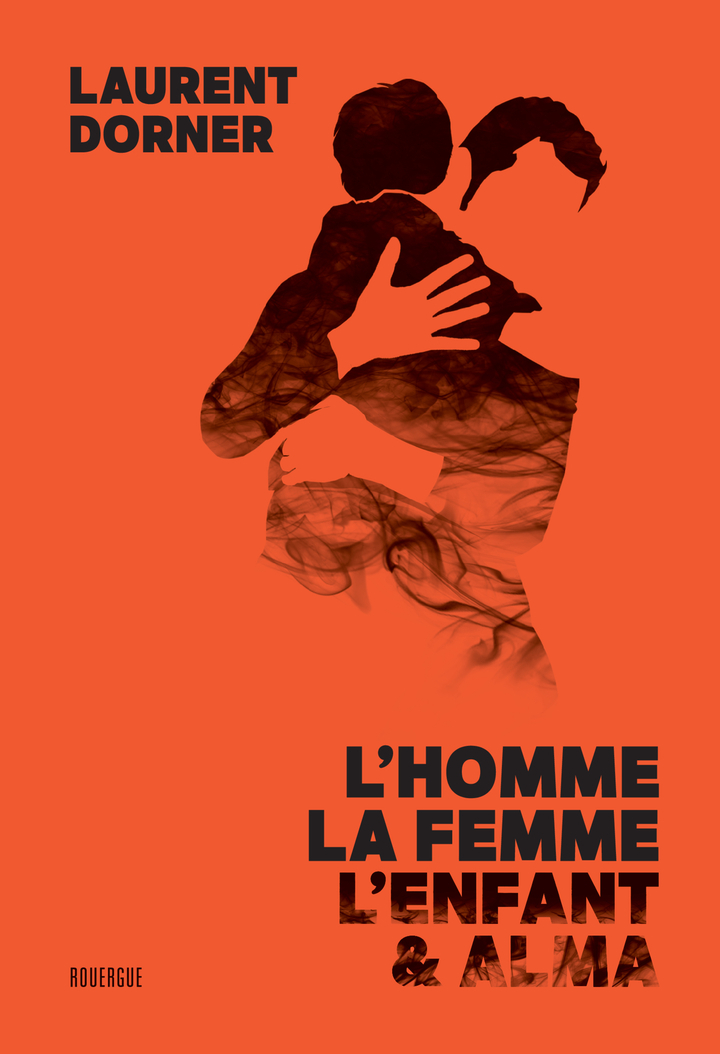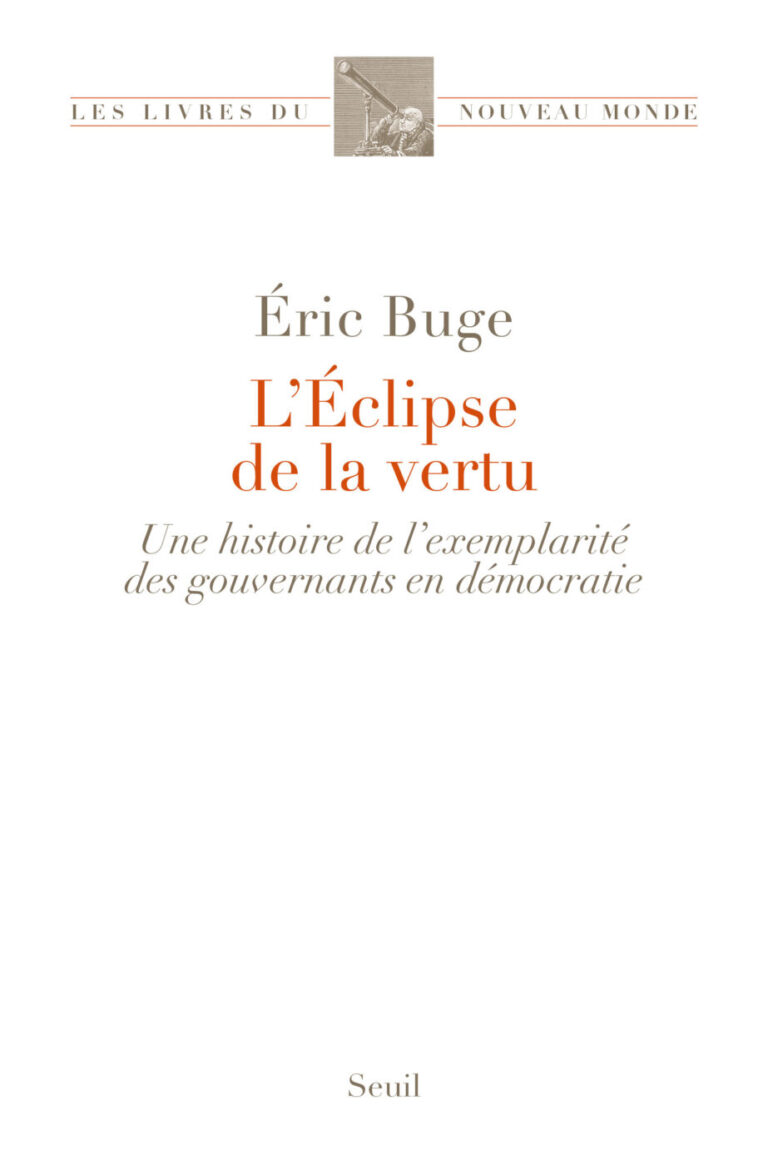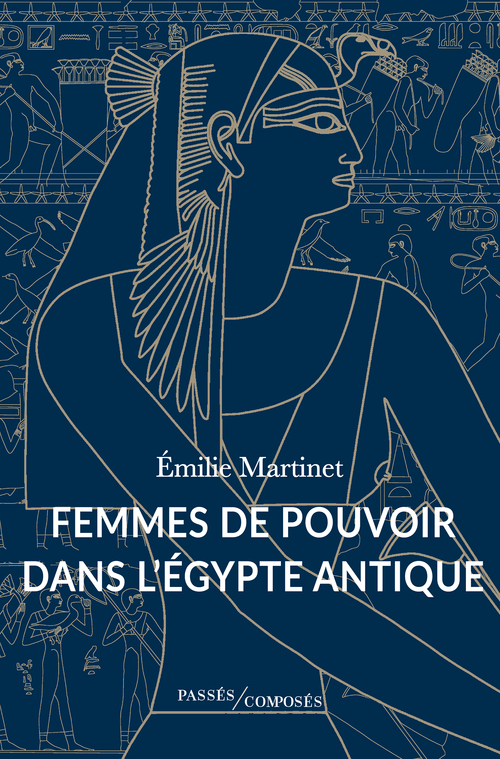Dounia Hadni, La Hchouma, Albin Michel, 02/01/25, 192 pages, 18,90 €
La hchouma, cette honte marocaine qui ronge, est au cœur du premier roman coup de poing de Dounia Hadni. C’est le cri de révolte viscéral de Sylia, dont le corps devient l’arène d’une lutte intime et politique entre Fès et Paris, tradition et liberté. Une déflagration littéraire qui dissèque les silences assassins.
Le cortège funèbre s’éloigne, emportant Dadda vers cette terre marocaine qui fut sa seule maîtresse, son unique prière. Mais pour Sylia, jeune femme funambule au bord de sa propre désintégration, l’enterrement du grand-père est moins une fin qu’un commencement trouble. Autour du corps rapetissé, drapé d’un linceul d’une blancheur presque agressive, s’anime le théâtre complexe et douloureux des rituels familiaux et sociaux. Les prières psalmodiées se heurtent aux gémissements hyperboliques ; les femmes, exclues de la dernière demeure terrestre par la seule loi du genre, hurlent une douleur sincère ou performative, se lacèrent le visage, implorant Rabbi dans une transe collective. C’est dans ce clair-obscur des affects, cette mise en scène millénaire du deuil où le chagrin lui-même semble obéir à des codes invisibles, que s’ancre La Hchouma, le premier roman saisissant de Dounia Hadni. Un texte qui refuse les faux-fuyants pour plonger dans l’anatomie d’une honte – cette hchouma tutélaire, poison culturel et héritage transgénérationnel – qui corsète les existences, mutile les corps et étouffe les voix, naviguant entre Fès, Casablanca et un Paris tout aussi normatif. L’auteure nous convie à une immersion, parfois asphyxiante, dans la psyché fissurée d’une femme écartelée entre deux mondes, deux langues, et l’impérieuse nécessité de briser un silence qui menace de l’engloutir.
Le spectre de Dadda et le ballet des apparences
L’enterrement de Dadda, figure patriarcale à la fois terrienne et intellectuellement frustrée, n’est pas qu’un prologue événementiel ; il agit comme le catalyseur d’une mémoire familiale et sociale chargée. Sylia, la narratrice de vingt-six ans, observe ce théâtre du deuil avec une lucidité précoce, déjà consciente des failles sous le vernis des convenances. Le souvenir des chiens protecteurs sur le toit de la ferme, promesse enfantine d’Amal (« ils seront toujours là, à leur poste, suspendus pour veiller sur nous »), se charge d’une ironie tragique face à la réalité des gardiens de l’ordre moral. Le rituel lui-même, étalé sur trois jours, condense les paradoxes marocains : l’opulence culinaire répondant au vide laissé par la mort, les anecdotes exorcisant le chagrin, les effusions de douleur côtoyant les secrets bien gardés. Dadda, même sans vie, sa bouche « avalée » comme ultime rempart contre la parole, incarne cette emprise silencieuse des ancêtres. Cette ouverture pose d’emblée la dialectique du roman : le poids écrasant de la tradition face à l’aspiration individuelle, la béance entre le paraître social et l’être intime, la parole confisquée par le silence collectif.
Galerie de portraits féminins : entre soumission et “parades”
Les figures féminines qui entourent Sylia dessinent une constellation de destins entravés, miroirs des injonctions multiples qui pèsent sur les femmes issues de cette bourgeoisie maghrébine. Tata Nawal, épouse d’oncle à la quarantaine “pétillante”, incarne la “parade” comme art de vivre : une libération superficielle, confinée aux privilèges matériels et à la transgression contrôlée (apéritifs au bar italien, blagues salaces), mais viscéralement attachée aux piliers du patriarcat. Sa critique acerbe de Leïla Slimani (« Elle n’est plus marocaine depuis longtemps ») ou son rejet horrifié de l’homosexualité (« Je ne voudrais pas d’un fils pestiféré ») dévoilent la fragilité de cette émancipation de façade. Amal, la cousine adorée de l’enfance, représente le versant tragique de cette négociation impossible. Prisonnière de TOCS et d’une piété expiatoire, elle est l’incarnation vivante du trauma enkysté, conséquence directe d’une histoire d’amour et d’une grossesse avortées au nom de la hchouma et de la mésalliance sociale. Son destin brisé illustre comment le non-dit familial se mue en symptôme corporel et psychique. À leurs côtés, Lalla, la nounou illettrée, figure de résilience et d’amour inconditionnel, représente une forme de sagesse intuitive, un ancrage affectif vital pour Sylia, mais elle reste confinée à son rôle subalterne, témoin silencieux des hypocrisies de classe. Enfin, Valérie, la belle-mère française, sympathique mais pétrie de clichés orientalistes, complète ce tableau en rappelant à Sylia l’assignation identitaire qui la poursuit même en France, la réduisant à l’image exotique de la « jeune femme maghrébine comme vous qui ose porter une jupe aussi courte ». Chaque femme est une variation sur le thème de l’enfermement, qu’il soit doré, tragique ou socialement déterminé.
Le corps comme champ de bataille
Au cœur de La Hchouma, le corps féminin est traité non comme une simple enveloppe charnelle, mais comme un territoire politique, lieu d’inscription des traumas et des résistances. La hchouma, cette honte diffuse et omniprésente, s’attaque d’abord au corps, en particulier à la sexualité. Le roman explore avec une rare acuité comment le silence culturel autour du sexe, l’absence de mots adéquats dans la darija pour nommer le plaisir ou l’intimité (« un homme prend une femme, une femme ouvre les jambes »), génère une dissociation profonde. Sylia vit cette fracture dans sa chair : douleurs lors des rapports, diagnostic de frigidité, sentiment de saleté hérité de la réprimande maternelle (« La hchouma, la “honte” ! »). Son corps devient le réceptacle d’une violence intériorisée, se bloquant, se refusant, comme une ultime défense contre une intrusion vécue comme une souillure. C’est dans ce contexte que les soins de Lalla au hammam, ce frottement énergique qui exfolie autant la peau que les chagrins (« Je dois frotter, Sylia, regarde tous ces spaghettis noirs qui dégoulinent de tes pores »), prennent une dimension quasi thérapeutique, offrant une reconnaissance corporelle que le langage verbal ne peut fournir. La relation tumultueuse et animale avec Jad, si elle semble offrir une échappatoire initiale par sa transgression des codes bourgeois, finit par reproduire d’autres formes de domination, où le corps est encore objet, tantôt adulé, tantôt méprisé. La décompensation psychotique de Sylia, point culminant du récit, peut alors se lire comme l’expression ultime et désespérée d’un corps saturé, qui hurle sa vérité quand la parole est restée trop longtemps captive.
Les entrelacs de la domination : classe, genre et regard psychiatrique
Dounia Hadni ne se limite pas à une exploration psychologique ; elle ancre fermement le drame de Sylia dans un tissu social complexe où les rapports de domination s’entrecroisent. Le roman offre une critique subtile de la bourgeoisie marocaine, prise entre une aspiration à la modernité occidentale et la prégnance d’archaïsmes sociaux et religieux. L’hypocrisie de classe est palpable : l’opulence affichée lors des réceptions contraste avec le mépris larvé pour les classes populaires (le sort d’Issa, l’amant d’Amal, “enlevé” car socialement inadéquat) ou le paternalisme envers les domestiques. La hogra, cette forme d’oppression et d’humiliation du plus faible, irrigue les relations sociales. Cette violence de classe est indissociable de la violence de genre. La hchouma sert souvent de paravent moral pour maintenir l’ordre social et l’endogamie. Le destin d’Amal, sacrifié sur l’autel de la réputation familiale, en est l’illustration la plus crue. Dans ce cadre, l’intervention psychiatrique apparaît moins comme une aide neutre que comme une tentative de normalisation, voire de répression de la dissidence. L’internement de Sylia, validé par son père et un psychiatre français (Dr Marcel) dont la compréhension du contexte culturel est limitée (« je connais le Maroc, j’y suis allé plusieurs fois »), soulève la question de la psychiatrisation du refus social. Faisant écho aux analyses foucaldiennes, le diagnostic devient un outil de pouvoir, visant à réduire au silence celle qui dérange l’ordre établi en refusant les “parades”. L’hôpital, loin d’être un sanctuaire, se révèle une autre forme d’enfermement, où le discours médical peine à saisir la complexité d’une souffrance enracinée dans des dynamiques culturelles et familiales toxiques.
Une langue à soi : entre Darija, français et silence
L’écriture de Dounia Hadni reflète la fragmentation de son héroïne. La prose est nerveuse, syncopée, alternant descriptions cliniques des rituels sociaux et plongées viscérales dans l’angoisse. La langue est elle-même un enjeu central. Le français, langue de l’étude, de l’exil, de l’analyse, se confronte à la darija, langue maternelle des affects, des injonctions primales (« Benti, matfaqsis haka, mamzyanch »), mais aussi langue trouée, impuissante à nommer l’intime. Cette tension linguistique innerve le récit, traduisant le déchirement identitaire de Sylia. L’utilisation des termes arabes n’est pas folklorique ; elle souligne leur charge symbolique et émotionnelle spécifique, ce poids intraduisible de l’héritage. Le style de Hadni, riche en métaphores corporelles, ancre la souffrance psychique dans le tangible, faisant du corps de Sylia le sismographe de ses fractures intérieures et des violences du monde extérieur.
Une voix dans le chœur brisé
Par sa manière directe d’aborder la sexualité féminine entravée, la culture du silence et la honte internalisée, La Hchouma entre en résonance profonde avec les préoccupations féministes contemporaines, notamment celles soulevées par le mouvement #MeToo. Le roman s’inscrit également dans la lignée des écritures de femmes issues du Maghreb et de sa diaspora qui explorent, souvent avec douleur, les identités fracturées, les conflits de loyauté entre cultures et la difficile négociation avec un héritage patriarcal persistant. En choisissant une héroïne issue d’un milieu aisé, Dounia Hadni démontre que les mécanismes d’oppression liés au genre et à la tradition ne sont pas l’apanage d’une classe sociale spécifique, mais traversent l’ensemble de la société, y compris ses strates les plus occidentalisées. La question de la santé mentale, telle qu’abordée dans le roman, interroge également nos sociétés contemporaines : comment prend-on en charge des souffrances qui sont à la fois intimes et profondément sociales, culturelles ? La “folie” de Sylia apparaît moins comme une défaillance individuelle que comme le reflet d’un système collectif dysfonctionnel, incapable de faire place à la différence et à la révolte légitime.
Le roman de Dounia Hadni ne propose pas de résolution facile. En retournant symboliquement à la ferme de Dadda, lieu des origines et des premières promesses trahies, Sylia semble chercher un point d’ancrage après la tempête. Mais la fin reste ouverte, en suspension. Peut-on véritablement s’affranchir de la hchouma, de l’héritage familial et culturel, sans se perdre soi-même, sans rompre les liens vitaux ? Hadni nous laisse avec cette question, face à une Sylia meurtrie, certes, mais peut-être enfin prête à esquisser sa propre voie, une “parade” qui ne serait plus celle de la dissimulation mais celle, courageuse et précaire, de l’affirmation de soi. La Hchouma est une œuvre dense et nécessaire, un premier roman maîtrisé qui dissèque les mécanismes de l’oppression intime et sociale avec une justesse et une intensité rares. C’est le portrait vibrant d’une femme en lutte contre les fantômes du passé et les démons du présent, un cri lucide contre les silences assassins et une exploration poignante des sentiers escarpés de la liberté.