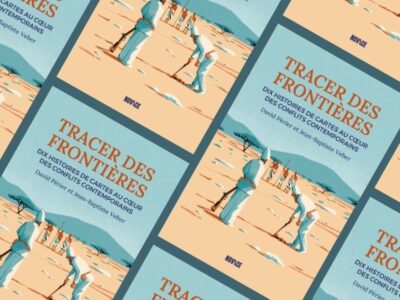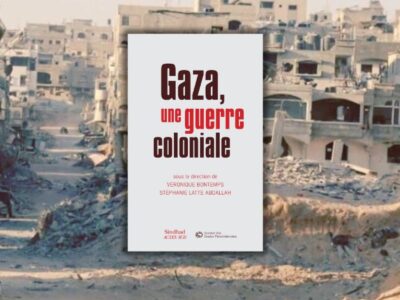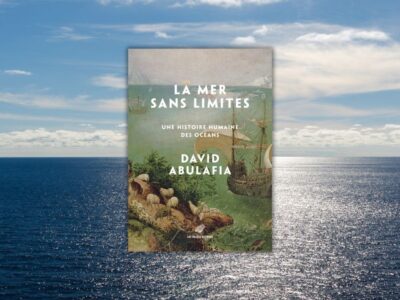Jean-Pierre Filiu, Comment la Palestine fut perdue. Et pourquoi Israël n’a pas gagné, Éditions du Seuil, février 2024, 432 pages, 24,00 €.
La terre de Palestine, berceau de trois monothéismes et carrefour des empires, est depuis plus d’un siècle le théâtre d’un conflit sanglant et apparemment sans fin. Deux peuples, israélien et palestinien, s’y affrontent pour la même terre, nourris chacun d’un récit historique qui légitime ses revendications et invisibilise celles de l’autre. Le résultat, après plus de soixante-quinze ans d’existence de l’État d’Israël, est la domination d’un peuple sur l’autre, une domination aussi impitoyable que porteuse d’instabilité. Comprendre comment une telle situation a pu émerger est essentiel pour briser le cycle de la violence et ouvrir enfin la voie à une coexistence durable.
Les fondations inattendues du sionisme
Jean-Pierre Filiu, dans “Comment la Palestine fut perdue“, nous invite à revisiter les origines du conflit israélo-palestinien. Loin des explications simplistes qui ont pu être avancées, il met en lumière les forces profondes du projet sioniste, forces qui ont permis de passer d’une présence juive très minoritaire en Palestine au début du XXe siècle à l’établissement d’un État hébreu dominant l’ensemble de ce territoire un siècle plus tard.
Un sionisme historiquement chrétien
L’ouvrage se distingue par sa mise en évidence du rôle crucial du sionisme chrétien dans l’émergence puis la consolidation de l’État d’Israël. Loin d’être un phénomène récent, ce courant trouve ses racines au cœur même du protestantisme anglo-saxon, et ce dès le milieu du XIXe siècle. Les tenants de ce courant, convaincus de l’imminence du retour du Christ à Jérusalem, considèrent la colonisation juive de la Palestine comme un prérequis essentiel à l’accomplissement des prophéties. C’est ainsi que des personnalités aussi influentes que Lord Shaftesbury en Grande-Bretagne ou le révérend Blackstone aux États-Unis vont se mobiliser activement en faveur du projet sioniste.
L’auteur retrace avec précision le poids déterminant de ce sionisme chrétien dans l’adoption de la Déclaration Balfour en 1917, par laquelle le gouvernement britannique s’engage à “favoriser l’établissement en Palestine d’un foyer national pour le peuple juif.” Cette déclaration, fruit de la convergence entre les visées impériales de Londres et les attentes eschatologiques des évangéliques, va marquer une rupture fondamentale dans la question de Palestine. Alors que les Juifs ne constituent alors qu’un dixième de la population, cette déclaration ne reconnaît qu’à eux, et à eux seuls, le droit à des aspirations nationales. Quant à la majorité arabe, elle est réduite au statut de simples “communautés non juives” auxquelles sont concédés des “droits civils et religieux” sur leur propre terre. Ce déni de l’identité nationale arabe est lourd de conséquences, car il pose d’emblée les bases d’un conflit dont l’intensité ne cessera de croître.
Il souligne la continuité entre le discours de Lord Shaftesbury, dès 1854, sur “un pays sans nation pour une nation sans pays” et le libellé de la Déclaration Balfour treize ans plus tard. Le soutien au jeune État d’Israël, né en 1948 sur les ruines de la Palestine mandataire, devient aux États-Unis un enjeu majeur de la politique intérieure, moins du fait du “vote juif” que de la puissance du sionisme chrétien, qui va progressivement s’imposer comme le principal levier de la diplomatie israélienne. Benyamin Netanyahou, Premier ministre israélien à plusieurs reprises, incarne ainsi une forme de “sionisme sans Juifs” où il privilégie le soutien inconditionnel des évangéliques à un dialogue avec une diaspora juive dont la diversité est profonde et dont les critiques, de plus en plus nombreuses, sont le plus souvent ignorées.
Le pluralisme de combat du sionisme juif
Le sionisme juif, à la différence du sionisme chrétien, s’est toujours caractérisé par sa pluralité organisationnelle et la vivacité de ses débats internes. Loin d’en compliquer le développement, cette vitalité démocratique a consolidé la diffusion dans le monde juif de thèses qui étaient longtemps minoritaires, chaque nouvel adhérent pouvant se réclamer de sa propre version du sionisme. Ce pluralisme de combat a permis au mouvement sioniste de mobiliser une base de plus en plus large et d’adapter son discours et sa stratégie aux profondes évolutions de la conjoncture internationale.
Jean-Pierre Filiu retrace ainsi les clivages fondateurs entre le sionisme culturel d’Ahad Haam, qui prône une renaissance spirituelle sur la terre d’Israël, et le sionisme politique de Theodor Herzl, partisan d’un État des Juifs à vocation profane. Ces clivages s’aggravent avec la proposition, en 1903, par Herzl lui-même, d’une implantation juive en Ouganda, une alternative territoriale qui divise le mouvement sioniste entre “pratiques” et “territorialistes”. Ce n’est qu’après la mort de Herzl, en 1904, que son successeur David Wolffsohn parvient à surmonter de telles contradictions et à focaliser les énergies du mouvement sur l’objectif de la colonisation de la Palestine.
L’auteur met en évidence la nouvelle fracture qui apparaît, à partir de 1923, entre la ligne travailliste de Ben Gourion et l’intransigeance révisionniste de Jabotinsky. Ce dernier, partisan d’une ligne aussi claire qu’implacable, prône la constitution d’un “mur de fer” pour repousser la population arabe. Il dénonce l’hypocrisie de la direction sioniste qui refuserait d’avouer son “but ultime” et de reconnaître la dimension inéluctable de la confrontation avec les Arabes. Pour Jabotinsky, seul un rapport de force implacable, construit sur une domination démographique de la population juive, peut garantir l’avenir de l’État juif.
La rupture est consommée en 1935 lorsque Jabotinsky crée sa Nouvelle Organisation sioniste, dont la branche armée, l’Irgoun, va se livrer à de sanglants attentats contre les Arabes, mais aussi contre les Britanniques. L’auteur souligne que Ben Gourion, pourtant opposé au terrorisme révisionniste, n’hésite pas à utiliser la capacité de nuisance de l’Irgoun et du Lehi pour peser sur le mandat britannique. Et, une fois l’État d’Israël proclamé en 1948, c’est bien la victoire aux élections de la Knesset qui consacre la marginalisation des partis révisionnistes, dont le retour au pouvoir sera d’autant plus brutal en 1977, avec l’élection surprise de Begin à la tête du Likoud.
Ce retournement marque le début d’une dérive droitière dont la tendance de longue durée est indéniable, malgré des coalitions d’”union nationale” plus ou moins bancales. Les Palestiniens sont réduits à n’être que des “Arabes d’Eretz Israel” et la ligne dure contre l’OLP, stigmatisée en ramassis de “terroristes”, culmine avec l’invasion israélienne du Liban en 1982. Le processus de paix lancé en 1993 permet une suspension de cette escalade, avant que le retour de Netanyahou au pouvoir ne la relance, avec un acharnement et une violence sans précédent.
Une stratégie gradualiste de faits accomplis
La troisième force d’Israël, mise en lumière par l’essayiste, réside dans la stratégie de faits accomplis suivie par le mouvement sioniste, puis par l’État d’Israël. L’objectif n’est jamais clairement défini, afin de ne pas s’aliéner les parrains internationaux ou de heurter l’opinion publique, mais à chaque étape, un nouvel acquis est consolidé, au point de devenir irréversible. Les dirigeants israéliens sont ainsi toujours en mesure de se poser en partisans de la modération, face aux extrémistes de leur propre camp ou à l’absolutisme eschatologique des sionistes chrétiens.
Jean-Pierre Filiu retrace cette stratégie gradualiste dès le mandat britannique et les négociations sur la délimitation territoriale de la Palestine, que la Déclaration Balfour a laissée dans une incertitude propice aux manœuvres sionistes. L’objectif n’est pas de tracer dès lors les frontières d’un État juif, mais de maximiser l’espace de colonisation pour y implanter “un foyer national pour le peuple juif”.
La “question cachée” de la population arabe est alors traitée par le déni, soit en niant l’existence même d’un nationalisme palestinien, soit en affirmant que l’arrivée des colons sionistes ne saurait que profiter aux autochtones. La commission d’enquête britannique sur les violences de 1929 conclut pourtant que les émeutes résultent de la crainte arabe d’être “privés de moyens d’existence et de tomber politiquement sous la tutelle des Juifs”, une conclusion réfutée par la direction sioniste qui y voit un pogrom fomenté par le grand mufti Husseini.
L’auteur met alors en évidence le caractère implacable de la « dépossession symbolique » des habitants arabes de Palestine. Alors que les Juifs, minoritaires à 90 %, se voient reconnaître des droits nationaux, la majorité arabe est réduite à n’être qu’une agrégation de “communautés non juives”, définies négativement et sans la moindre aspiration collective. Un tel déni de l’identité nationale palestinienne est le préalable essentiel à la dépossession physique, qui va culminer en 1948 avec l’exode de la majorité de la population.
La signature en 1933 d’un accord de transfert des Juifs allemands vers la Palestine, accord conclu par l’Agence juive avec l’Allemagne nazie, illustre ce processus de faits accomplis. Même si les partis sionistes sont engagés dans une campagne de boycott des produits allemands, l’Agence juive privilégie l’immigration à tout prix, sans craindre de traiter avec le régime hitlérien.
Quant à l’exode palestinien, il est rarement présenté comme un objectif sioniste, mais il est orchestré avec méthode, d’une localité à l’autre, par la Haganah, l’Irgoun et le Lehi, ainsi que par Tsahal une fois l’État d’Israël proclamé. Les plans d’Allon, formulés après la conquête de 1967, prévoient une annexion de 33 % de la Cisjordanie, tandis que, de Begin à Netanyahou, les différents Premiers ministres israéliens vont systématiquement lier la “sécurité” d’Israël à l’imposition de conditions de plus en plus draconiennes à la Palestine, jusqu’au retrait unilatéral de Gaza en 2005 et au blocus implacable de cette enclave palestinienne.
Les faiblesses structurelles du nationalisme palestinien
Jean-Pierre Filiu ne se contente pas de mettre en lumière les forces du projet sioniste, il s’attache aussi à identifier les faiblesses palestiniennes qui ont rendu possible la constitution puis l’expansion de l’État d’Israël. Ces faiblesses, d’une nature aussi structurelle, participent de trois dynamiques interdépendantes qui vont durablement miner le nationalisme palestinien, jusqu’à le conduire à la polarisation actuelle entre un Fatah assiégé à Ramallah et un Hamas isolé à Gaza.
L’illusion d'une solidarité arabe
Le conflit pour la Palestine oppose dès l’origine une population locale s’affirmant comme arabe à des immigrants juifs qui incarnent, avec le sionisme, la revendication nationaliste d’un État sur la terre d’Israël. Les différentes communautés arabes palestiniennes, issues de siècles de domination ottomane, peuvent compter sur des solidarités claniques, religieuses et linguistiques pour contrer une telle menace, ainsi que sur l’attachement profond à la Palestine, cette “Terre sainte” dont elles partagent l’héritage avec les Chrétiens et les Juifs. Mais la tentation est forte de s’adosser au grand récit panarabe qui prétend fédérer les Arabes d’un ensemble s’étendant du Maroc au golfe Persique, ensemble idéologiquement construit à la fin du XIXe siècle, sans aucune base territoriale commune.
Jean-Pierre Filiu retrace avec précision comment cette affirmation d’une identité collective arabe, si pertinente pour rassembler les Palestiniens face aux sionistes, va se traduire en une dépendance structurelle envers des régimes qui sont d’autant plus prompts à manipuler la cause palestinienne à leur profit que leur légitimité est fragile. C’est ainsi que les congressistes arabes qui se réunissent à Paris en 1913 n’éprouvent même pas le besoin de se prononcer sur le projet sioniste, pourtant dénoncé avec virulence par la presse de Palestine. Quant aux promesses faites par Londres en 1915 au chérif Hussein de La Mecque de garantir “l’indépendance des Arabes” dans les territoires libérés de l’autorité ottomane, elles sont trahies en 1917, d’abord par les accords Sykes-Picot de partage du Moyen-Orient entre la Grande-Bretagne et la France, puis par la Déclaration Balfour consacrant l’implantation sioniste en Palestine.
L’auteur met en évidence le double jeu de Faysal, qui tente à Londres de se concilier les sionistes, en conditionnant ensuite cet accord à la pleine reconnaissance de son “royaume arabe” par la conférence de paix. Cette conférence de paix, qui s’ouvre à Paris en 1919, consacre la mise en place de mandats de la SDN sur la Palestine, la Syrie et l’Irak, une solution impériale que condamnent les premiers congrès arabes palestiniens. Londres confie l’administration civile de la Palestine à Herbert Samuel, un sioniste militant qui n’aura de cesse d’encourager l’immigration juive, tandis qu’Amman et Le Caire se disputent la représentation des Palestiniens.
La rivalité entre régimes arabes sur la question palestinienne aboutit à un véritable désastre en 1948, chaque souverain cherchant à tirer le meilleur profit de la Nakba palestinienne. Hajj Amine al-Husseini, le mufti de Jérusalem déchu par les Britanniques pour ses activités nationalistes, s’enferre dans une ligne maximaliste en refusant le moindre compromis territorial avec les sionistes, puis en s’alignant sur Saddam Hussein. Le gouvernement de toute la Palestine, qu’il met en place à Gaza, est d’autant plus fragile qu’il est contesté par le roi Abdallah, qui s’emploie à annexer la Cisjordanie à la Transjordanie.
Cet alignement d’Arafat sur Saddam Hussein, en 1990, achève de disqualifier l’OLP aux yeux de l’administration américaine qui l’exclut du processus de paix lancé à Madrid en 1991. Le sommet arabe de Beyrouth, en mars 2002, adopte un “plan arabe de paix” proposé par l’Arabie saoudite, plan qui envisage pour la première fois la reconnaissance d’Israël en contrepartie d’un retrait total des territoires occupés en 1967. Sharon n’en tient aucun compte, tout occupé qu’il est à préparer sa nouvelle offensive de réoccupation de la Cisjordanie. Quant à Arafat, assiégé dans sa présidence de Ramallah, il est contraint, à défaut d’obtenir le moindre soutien arabe, de trouver refuge en France où il meurt peu après. Son successeur, Mahmoud Abbas, président d’une Autorité palestinienne à la légitimité de plus en plus fragile, est confronté à l’indifférence, voire à l’hostilité des régimes arabes, d’autant plus que le Hamas conteste sa représentativité et s’impose, à partir de septembre 2020, comme interlocuteur de facto d’Israël dans les accords d’Abraham.
La dynamique factionnelle, une paralysie interne
Le nationalisme palestinien, à l’image d’autres mouvements de libération nationale, a toujours été traversé par la dynamique factionnelle. Mais le conflit inter-palestinien se distingue par une polarisation interne tellement marquée qu’elle a fini par paralyser une mobilisation collectivement efficace contre le mandat britannique et le sionisme. Le cœur de cette polarisation a été, dès l’origine, l’antagonisme entre les Husseini et les Nashashibi, les deux grandes familles arabes de Jérusalem qui vont rivaliser pour le contrôle des institutions et des réseaux d’allégeance, en jouant sur les solidarités claniques, religieuses et politiques.
L’essayiste retrace avec précision le rôle joué par l’administration britannique dans l’exacerbation de cette rivalité. Le haut-commissaire Samuel, soucieux de diviser la population arabe, nomme en 1921 Hajj Amine al-Husseini, neveu du nationaliste Moussa Kazem al-Husseini, “grand mufti” de Jérusalem. Il installe ainsi un chef religieux très jeune et peu expérimenté à la tête d’un Conseil suprême islamique, lui conférant une autorité religieuse inédite. Samuel parvient ainsi à islamiser une mobilisation nationaliste jusque-là largement portée par les associations islamo-chrétiennes. En outre, il nomme au poste symbolique de maire de Jérusalem Ragheb Nashashibi, ouvrant la voie à des décennies de conflit entre Husseini et Nashashibi, conflit que les autres régimes arabes s’empressent d’alimenter.
L’auteur souligne le coût exorbitant payé par le nationalisme palestinien à cette confrontation entre deux familles et leurs partisans. La paralysie interne qui en découle interdit en effet de saisir les rares occasions d’un compromis politique. La Grande révolte arabe de 1936 s’achève ainsi sur un échec cuisant, avant tout du fait de la suspension par les souverains arabes de la grève générale et du refus de Hajj Amine al-Husseini, toujours en exil, d’accepter le Livre blanc de 1939, qui prévoyait pour la première fois la création d’un État palestinien. La Nakba de 1948 est une nouvelle tragédie, avec l’effondrement des milices palestiniennes face à la cohésion sioniste et l’expulsion de la majorité de la population.
Les factions fedayines qui se constituent dans la diaspora, et qui vont prendre en 1969 le contrôle de l’OLP, sont d’abord marquées par leur fragmentation, avant que le chef du Fatah, Yasser Arafat, parvienne à brider ses rivales en combinant la contrainte et le clientélisme. Mais le processus de paix israélo-palestinien s’ouvre alors même que le Hamas conteste ouvertement la représentativité de l’OLP, nourrissant l’échec de ce processus. Quant à la division qui prévaut depuis 2007 entre l’Autorité palestinienne, de plus en plus déconsidérée, du Fatah à Ramallah et le gouvernement Hamas de la bande de Gaza, elle paralyse toute mobilisation nationaliste face au rouleau compresseur israélien.
Un "deux poids, deux mesures" qui profite à Israël
La cause palestinienne présente le paradoxe cruel d’un surinvestissement de la part de la communauté internationale, en termes d’activité diplomatique, d’aide humanitaire et de visibilité médiatique, et d’une érosion continue des droits des Palestiniens, depuis les accords fondateurs du mandat britannique en 1922 jusqu’à “l’accord du siècle” de Trump en 2020. Ce paradoxe, analysé par Jean-Pierre Filiu dans toute sa brutalité, découle du “deux poids, deux mesures” qui permet d’exonérer Israël de la loi des hommes, et donc du droit international.
L’auteur met ainsi en évidence comment ce parti pris pro-israélien est présent dès la naissance de la SDN, qui n’accorde aucun droit national au peuple palestinien pourtant majoritaire en Palestine, avant d’être conforté par la création de l’ONU et sa paralysie par les États-Unis durant des décennies au profit d’Israël. En 1949, alors que l’Assemblée générale de l’ONU vient d’adopter la résolution 194 qui garantit aux réfugiés palestiniens le “droit au retour”, l’UNRWA est instituée pour gérer cet exil, génération après génération, sans référence à un tel droit. Après la conquête en 1967 par Israël de l’ensemble de la Palestine historique, le Conseil de sécurité de l’ONU vote sa résolution 242 qui, malgré son libellé ambigu, est censée régir le processus de paix. Mais cette résolution ne mentionne les Palestiniens que sous l’angle des réfugiés, leur déniant tout droit national.
Le parti pris pro-israélien du médiateur américain rend encore plus impitoyable l’application de ce “deux poids, deux mesures”. Les “processeurs” de paix de l’administration Clinton, de Dennis Ross à Aaron David Miller, n’ont jamais caché leur préférence pour les intérêts israéliens. Et quand George W. Bush relance, en 2001, le dogme d’un État palestinien vassalisé par Israël au nom des impératifs de sécurité de l’État hébreu, l’UE se contente d’apporter son soutien financier à la mise en œuvre d’une formule aussi déséquilibrée. L’invasion américaine de l’Irak en 2003, puis les “guerres globales contre la terreur”, avec la stigmatisation systématique des Palestiniens en terroristes, ne font qu’aggraver ce biais, qui culmine avec la complicité affichée de Trump et de Netanyahou.
Jean-Pierre Filiu montre comment, après des décennies de déni de l’identité palestinienne, la communauté internationale a accepté la domination implacable d’Israël sur la population palestinienne. Les accusations de “crime d’apartheid”, portées par Amnesty International, Human Rights Watch et B’Tselem, ne sont pas suivies d’effet, alors même que la colonisation se poursuit à un rythme accéléré et que Gaza est soumise à un blocus asphyxiant.
L’auteur souligne avec justesse que l’accord d’Abraham entre Israël et les Émirats arabes unis, en 2020, a fait passer la question palestinienne au second plan, confortant le cynisme de régimes désormais résolus à s’accommoder de la domination israélienne. C’est ainsi que le “deux poids, deux mesures” s’est transformé en un choc civilisationnel du “nous contre eux” qui nie jusqu’à la possibilité d’un compromis territorial et laisse le Hamas s’imposer comme la seule force de résistance à Israël.
La paix, un impératif historique
Le conflit israélo-palestinien est souvent présenté comme un jeu à somme nulle, où la victoire de l’un implique la défaite de l’autre. L’offensive terroriste lancée par le Hamas en Israël, le 7 octobre 2023, a démontré avec une violence insoutenable la faillite d’une telle vision. L’effondrement des défenses israéliennes a en effet été suivi de massacres et de pillages d’une barbarie sans précédent. Quant à la contre-offensive d’Israël à Gaza, elle a transformé l’enclave palestinienne en un champ de ruines où plus de 50 000 civils ont été tués depuis le début du conflit.
La paix, loin d’être un objectif à atteindre à terme par la défaite d’une des parties, est un impératif historique, dont la réalisation ne peut être différée. Encore faut-il que les Israéliens acceptent de renoncer à la logique des faits accomplis et que les Palestiniens surmontent leurs contradictions internes. Leur destin est indissociablement lié et la coexistence de deux États souverains et démocratiques sur la terre historiquement palestinienne constitue le seul horizon d’avenir pour les peuples israélien et palestinien.
L’ouvrage de Jean-Pierre Filiu, par sa démarche décapante et son analyse structurée, offre une contribution essentielle à cette quête de la paix. Il démontre que la question palestinienne n’est pas une « cause perdue », mais qu’elle constitue au contraire le défi majeur d’Israël, un défi que seule une solution politique négociée peut permettre de relever. Et c’est pourquoi “Comment la Palestine fut perdue” est une lecture indispensable pour tous ceux qui refusent de se résigner à la violence et qui s’engagent pour une paix enfin durable au Moyen-Orient.

NOS PARTENAIRES
Faire un don
Vos dons nous permettent de faire vivre les libraires indépendants ! Tous les livres financés par l’association seront offerts, en retour, à des associations ou aux médiathèques de nos villages. Les sommes récoltées permettent en plus de garantir l’indépendance de nos chroniques et un site sans publicité.