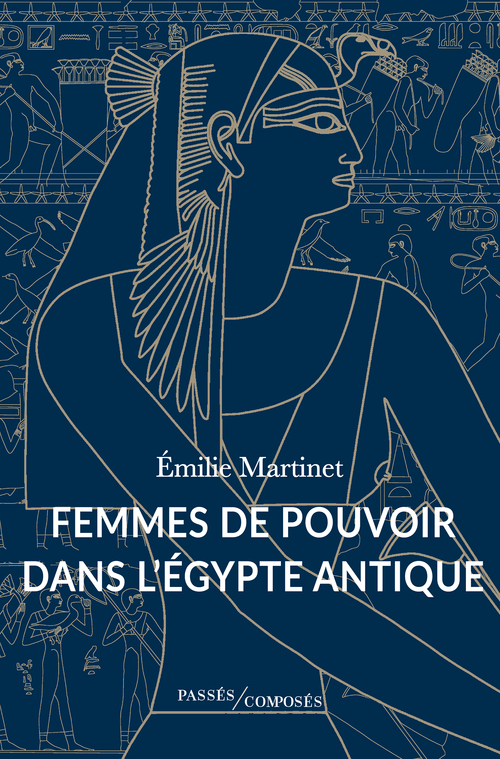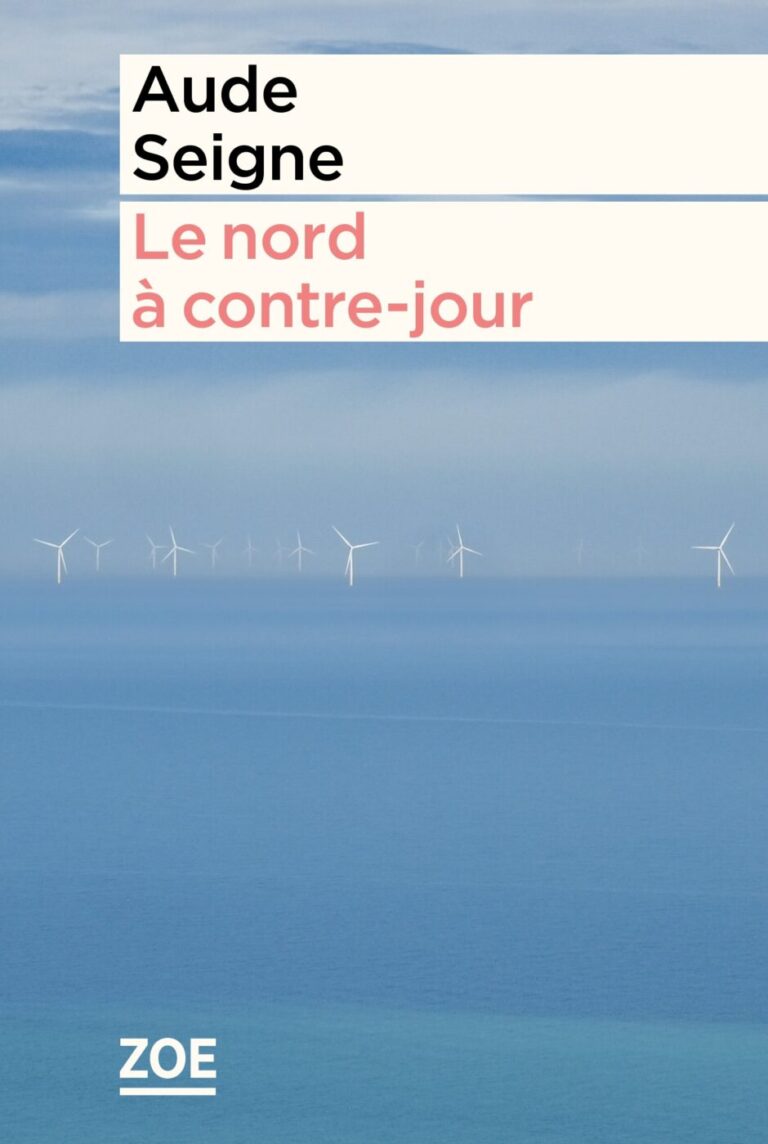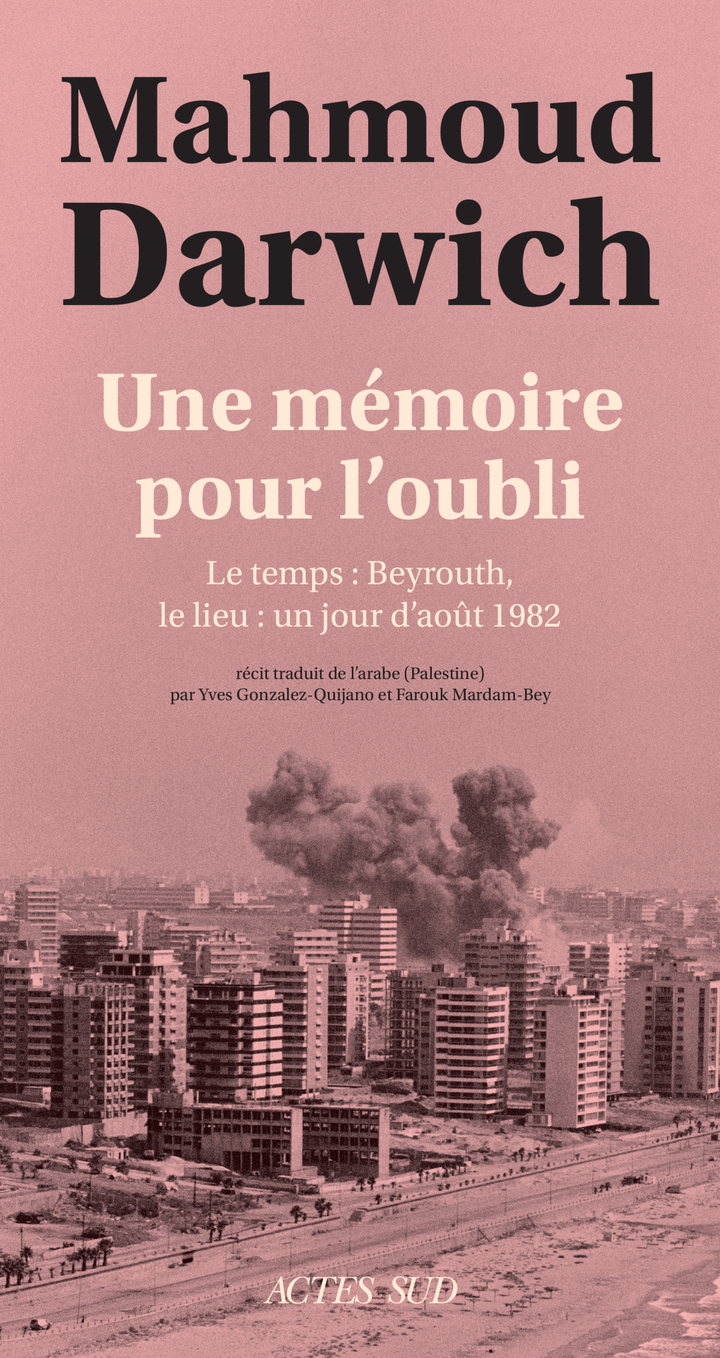Yves Pourcher, Qui a dénoncé Nakache ?, Éditions Gaussen, 11/09/2025, 240 pages, 22€
Écoutez notre Podcast
Et si l’on racontait Qui a dénoncé Nakache ? comme un roman noir ? Yves Pourcher tisse une trame fascinante où se croisent figures troubles, archives secrètes et retournements de situation. L’arrestation du champion de natation Alfred Nakache devient un thriller documentaire, une plongée en apnée dans les eaux glacées de la Collaboration. Mais sous cette intrigue méticuleusement instruite, ce sont les lignes de faille d’une société brisée qui apparaissent au grand jour : un antisémitisme diffus qui s’insinue dans les conversations de vestiaires, une bureaucratie complice qui enregistre la haine, une mémoire entravée qui peine à nommer les coupables. En suivant la chronologie du drame, de la piscine à la prison, puis des prétoires à la postérité, l’historien fait surgir une anatomie clinique de la délation.
Alfred Nakache : la trahison au bord du bassin
Tout commence dans une arène où le corps exulte : la piscine. Nous sommes en août 1943, aux Critériums de France à Toulouse. Le bassin, autrefois lieu d’exploits et de fraternité virile, se mue en scène politique où le poison de l’époque se répand. Alfred Nakache, au sommet de sa gloire, est interdit de compétition. La raison, assénée par l’occupant, mais relayée par les instances françaises, est simple : il est Juif. Cet événement est l’acte inaugural d’un drame qui révèle la gangrène morale du pays. Autour du champion déchu gravitent les spectres de l’affaire : Jacques Cartonnet, le rival flamboyant et milicien, figure trouble de la collaboration sportive ; et les Pallard, père et fils, dont l’amitié initiale pour Nakache se dissout dans le ressentiment. Yves Pourcher exhume des témoignages glaçants, comme cette phrase que Roland Pallard aurait lancée en plein match de water-polo : « Il est “dégueulasse” que vous fassiez jouer ce sale juif dans votre équipe. » L’enquête prend alors la forme d’une traque, une remontée à contre-courant des archives où chaque rapport de police constitue la pièce d’un puzzle vertigineux. Le gymnase, lieu de la consécration sportive devenu celui de l’arrestation, incarne ce basculement tragique ; il est la métonymie d’une France où la gloire peut, en un instant, virer à l’infamie.
Plus qu’une trahison : l’arme psychologique de la Gestapo contre Alfred Nakache
Au cœur de l’ouvrage palpite le récit de l’arrestation, le 21 décembre 1943. Là, le drame se noue et révèle l’infernale complexité de la dénonciation. L’agent de la Gestapo qui interroge Nakache lui brandit une vérité terrible et peut-être fictive. Nakache rapporte que « le deuxième lieutenant de la Gestapo m’avoua alors qu’il y avait eu vingt-cinq lettres anonymes, provenant de Français, envoyées à mon sujet ». Vingt-cinq. Le chiffre, sadique et précis, obsède le nageur et structure l’enquête de d’Yves Pourcher. Étaient-elles réelles ? Ou cette avalanche de dénonciations constituait-elle une arme psychologique, une mise en scène macabre destinée à convaincre la victime que sa propre société l’avait rejetée ? La Gestapo se révèle alors non seulement comme une force de répression, mais comme une machine à produire des récits, une officine capable d’instrumentaliser la jalousie pour en faire un outil de destruction. L’auteur, en disséquant cette méthode, explore la part française dans la mécanique de la déportation : l’arrestation de Nakache est moins le fait d’un seul traître que la résultante d’une chaîne de complicités, de la haine murmurée à la plainte déposée.
Les “zones grises” de la Résistance
L’ouvrage explore avec une minutie captivante les zones grises où les légendes se fracassent. Le cas des frères Foucher-Créteau et de leur mouvement de résistance, les « Légions françaises anti-Axe », est à ce titre exemplaire. Roger, le chef, se présente en résistant de la première heure ; son frère André, nageur, est un intime du collabo Cartonnet. La plainte déposée par Vincent Pallard contre ce mouvement, après avoir reçu des lettres de menace, déclenche une enquête de la police française qui attire l’attention de l’occupant. Yves Pourcher met au jour les conclusions stupéfiantes du Conseil d’État en 1962, qui démêle cet écheveau : le poste de commandement du groupe de résistance aurait été installé « dans la boulangerie du nageur Cartonnet, principal rival de Nakache, officier de la Milice, et antisémite notoire », menant à la conclusion que « la fiction paraît assez éloignée de la réalité ». On plonge ici dans cette « zone grise » chère à Primo Levi, où les frontières entre résistance et provocation, héroïsme et manipulation, se brouillent. Le livre montre que même les acteurs de la lutte contre l’occupant peuvent être pris dans des logiques troubles, où la vérité devient une arme à double tranchant.
La fresque glaçante d’une France rongée par le soupçon
En refermant Qui a dénoncé Nakache ?, une évidence s’impose : la question du titre est un leurre salutaire. Car au fil des pages, le coupable se démultiplie, il prend le visage d’une hydre. Il y a la haine antisémite, la jalousie sportive, l’opportunisme administratif, la vengeance personnelle. La réponse importe moins que la description du processus. Yves Pourcher compose la fresque d’une France où la délation fut une pathologie collective, un mal qui rongeait autant les institutions que les individus. Les procès d’après-guerre, que l’auteur retrace avec une précision clinique, en sont le prolongement. Le non-lieu dont bénéficie Vincent Pallard sonne, paradoxalement, comme une condamnation de l’imprudence des résistants. Surtout, l’historien révèle une dernière injustice, la plus durable : le combat de Nakache, rescapé d’Auschwitz, pour obtenir le statut de « déporté-résistant », un titre que l’administration française lui refusera obstinément pendant des décennies, le cantonnant à celui de « déporté politique », autrement dit, de Juif déporté. La dénonciation originelle trouve son écho funeste dans la froideur administrative d’après-guerre.
Ce livre ne se lit pas, il s’ausculte. Chaque page convoque les fantômes d’une mémoire qui refuse de se laisser simplifier, nous rappelant la phrase de Camus qui ouvre l’ouvrage : « Mais tout de même, qui est l’accusé ? C’est important d’être l’accusé. » La plume d’Yves Pourcher, précise et évocatrice, ne juge pas ; elle expose, elle déplie, elle restitue les dissonances d’archives qui mentent autant qu’elles révèlent. L’enquête sur Nakache devient une parabole sur la fragilité de la vérité historique. Il faut lire ce livre non pour trouver un coupable, mais pour comprendre, avec effroi, comment on en fabrique, comment une société en vient à sacrifier ses propres enfants sur l’autel de ses plus basses passions. Cette chronique d’un soupçon français est un miroir tendu vers ce que nous ne voulons pas voir de nous-mêmes, nous rappelant que la haine, avant de tuer, est une construction patiente, documentée, et parfois, administrative.