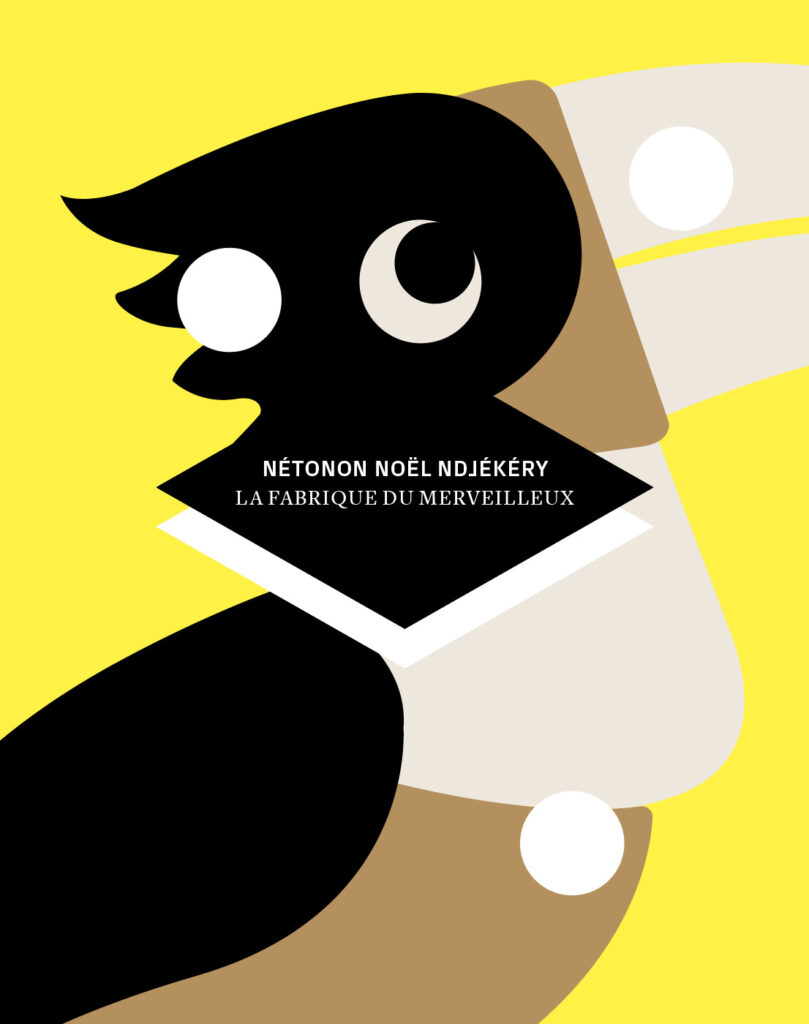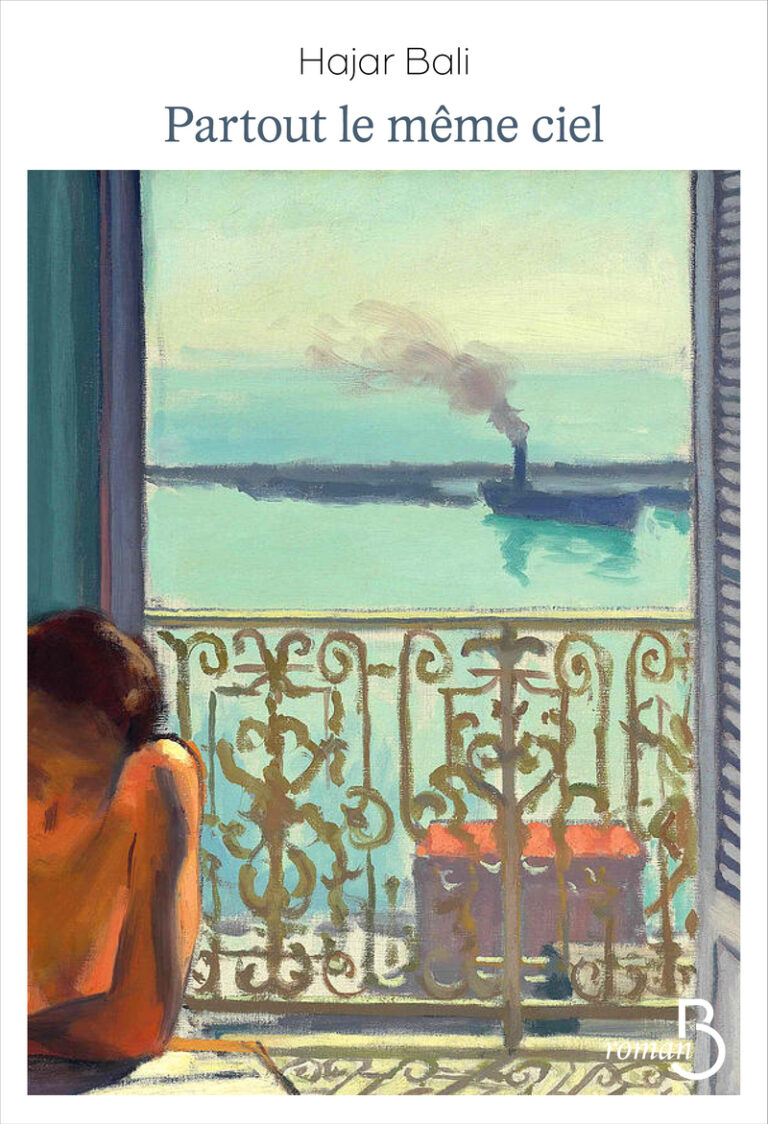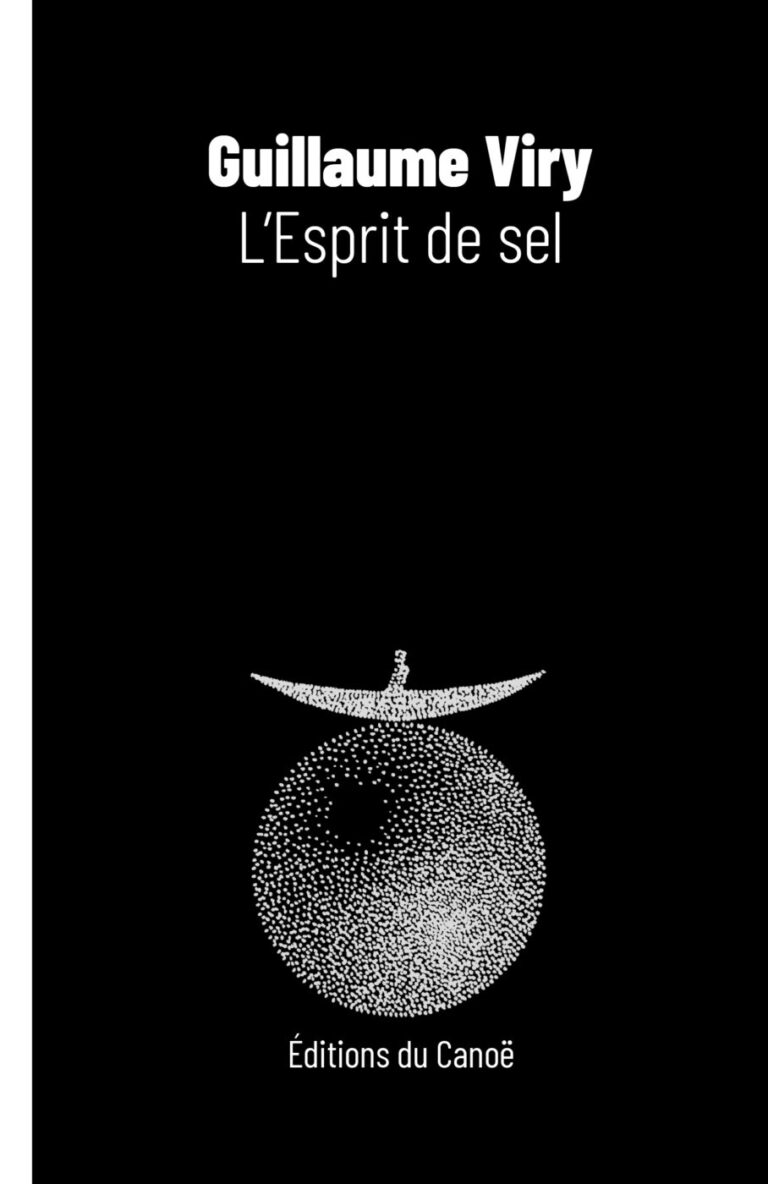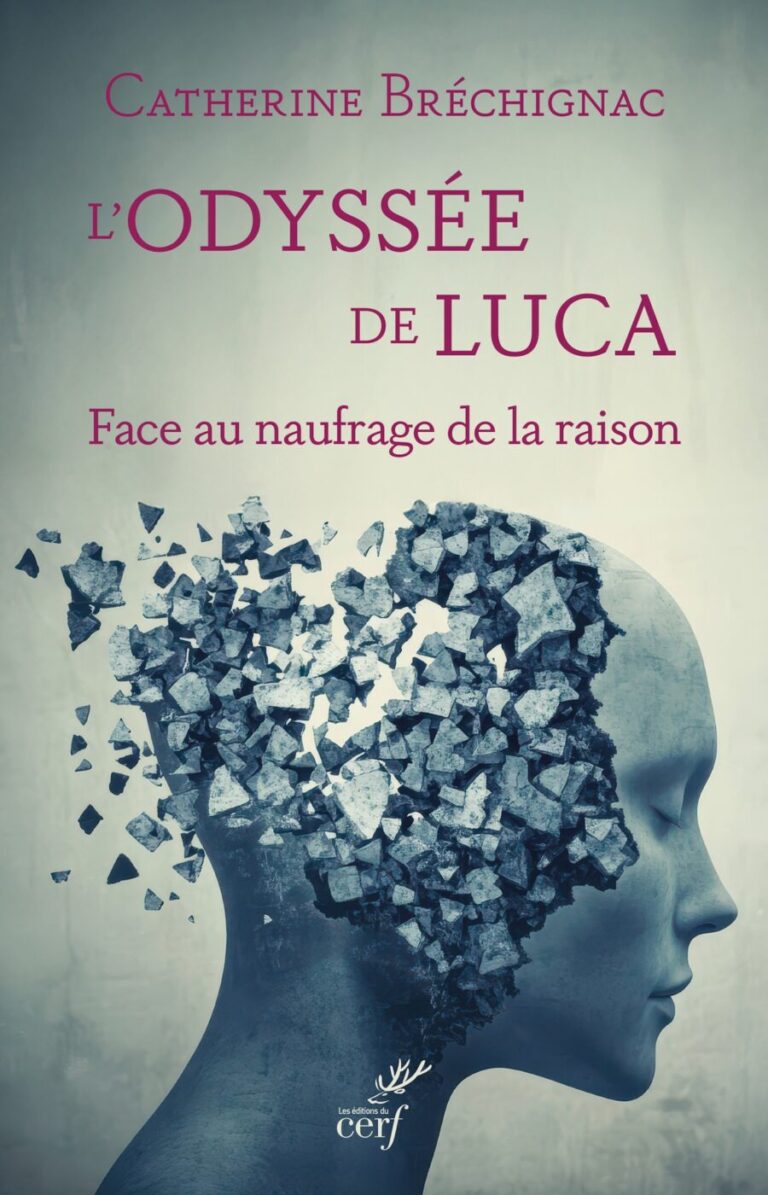Smaïn Laacher, L’Algérie, ma mère et moi. Éditions Grasset. 08/10/20025. 160 pages, 18 €
L’auteur raconte l’histoire de sa mère : partie d’Algérie en 1952 pour suivre son mari en France, peu avant la guerre d’indépendance (1954-1962), pour rejoindre la France, puis la vie vécue entre deux rives qui se regardent, qui s’appellent et ne se comprennent pas… ou plus. Dans ce livre l’auteur accomplit un voyage à l’intérieur d’une relation familiale complexe, une réflexion sur le lien entre mère et fils, entre deux pays, entre deux langues.
Quand le silence devient langue dans l’exil franco-algérien
Smaïn Laacher décrit son histoire, son chemin personnel. Il grandit en France à l’école de la République, tandis que sa mère reste « figée dans l’imaginaire de son pays de naissance ». Il existe des « murs invisibles » entre sa mère et son fils, entre l’Algérie et la France, entre générations, cultures, langues, « ces mots qui ont construit des murs entre nous, lentement, irréversiblement, des murs de silence et d’incompréhension ». Ce silence les unit. Il y a une langue du silence, une parole dans les mots qui ne se prononcent pas avec les lèvres mais qui se disent dans un ailleurs émouvant et troublant. Cela peut engendrer parfois chez le lecteur un certain malaise… quand nous sommes plongés dans cet « inter-monde», celui de la terre d’accueil (la France) et celui de la terre d’origine (l’Algérie), et comment la greffe n’a jamais tout à fait pris. « Au lieu de nous rapprocher, la France et l’Algérie nous ont éloignés, jusqu’à créer des frontières. Nous n’habitions plus le même monde ». L’ambiguïté de ces murs peut être frustrante. La fracture reste parfois sans vraie réparation. Smaïn Laacher attire d’une certaine façon l’attention sur la manière dont la langue maternelle, les mots, les non-dits créent des distances.
Smaïn Laacher éclaire l’exil par le prisme maternel
La mère est à la fois témoin et symbole : de la terre perdue, de l’exil, de l’enracinement déchiré. Le choix de se concentrer sur cette relation mère/fils permet d’aller au-fond des affects, de l’incommunicabilité et de la transmission. L’auteur est à la fois «le fils» et le sociologue. Ces deux réalités donnent au livre une double légitimité. Il tente d’éclairer une situation plus large (migrants, post-colonialisme, intégration). L’exil, la mémoire, la transmission, la filiation, et la fracture culturelle s’invitent sous la plume de l’auteur. Ainsi, sont mêlées deux dimensions : un récit intime et une réflexion sociologique. Le fait que l’auteur mélange son rôle de fils avec celui de sociologue permet de donner à la fois l’intime et le regard extérieur.
L’Algérie, la migration, la mémoire liée à la période coloniale et à l’indépendance du pays restent des marqueurs importants qui font aujourd’hui encore débat. Le contexte de l’exil ou de l’immigration, la migration franco-algérienne et la transmission culturelle sont indéniablement au cœur de ce récit mêlant intime et analyse à travers des deux personnages principaux et le prisme d’une mère algérienne et d’un fils français. Il rappelle que l’exil ne se résume pas à un déplacement géographique mais à une discontinuité intérieure, à des silences, à des paroles « enfermées » dans un silence. Il ne surjoue pas l’émotion mais laisse advenir lentement ce qui est au plus intime.
Silence et vérité comme fondements d’un possible après l’exil
En tant que chercheur et universitaire, fils d’immigré, Smaïn Laacher reste lui-même fondamentalement. Certains passages très réfléchis mais parfois moins « popularisés » rendent les pages émouvantes par l’intimité et la profondeur qui s’y dégagent. Il pose des questions importantes sur l’identité et la transmission. Le livre aborde la question de ce que signifie « être entre deux mondes », et comment les langues, les cultures, les générations peuvent séparer aussi bien qu’unir. C’est un des apports de l’ouvrage, très pertinent dans le contexte post-colonial français. Il ne prétend pas tout résoudre.
Le livre porte en lui-même beaucoup de vérité, de justesse et de profondeur. L’auteur ne parle pas seulement de complexité, du silence, de la douleur mais aussi à l’amour. Ce silence pourrait être également le terreau d’un chemin de dialogue à construire en donnant un développement à « un après ». Le livre est une lecture des relations familiales complexes dans un contexte migratoire. Le lecteur français sera intéressé par la complexité de ces rapports et de cette histoire, mais il ne sera pas le seul. Sans doute que pour d’autres raisons légitimes les lecteurs algériens, franco-algériens, seront également intéressés par l’histoire et la mémoire de l’Algérie en France au moment où l’actualité met à nouveau en regard la France et son ancienne colonie devenue un Département français.
Smaïn Laacher, héritier d’une mémoire algérienne silencieuse et digne
L’auteur aurait pu maugréer, se rebeller, être amer. Il aurait pu blâmer et dramatiser ; et pourtant il ne le fait pas. Il reste digne. Il n’y a pas d’excès. Il cherche simplement à comprendre, à ressentir, à essayer de trouver le chemin pour restaurer des liens. Smaïn Laacher est un fils de la culture arabo-andalouse, de ces terres du Maghreb et du Proche-Orient où le respect des parents est une arche sous laquelle chacun se situe. S’il met en lumière le « murmure des mots » et la manière dont la langue et les non-dits construisent des distances invisibles entre générations et entre pays il n’en reste pas moins présent à cette vie et à sa mère. Il est présent à son histoire, à cette terre d’accueil où il va grandir laissant derrière lui tout un pan de sa vie, des générations passées, de sa culture. La mère occupe une place importante dans la culture maghrébine. Son rôle est souvent chargé de significations symboliques et sociales. Là, il faut se construire entre ces mots, ces silences et creuser les sillons d’une nouvelle vie. La migration n’est jamais chose facile. On ne quitte pas son pays, sa terre, sa maison, ses morts par plaisir. On a sans doute parfois tendance à l’oublier. En lisant ce livre on peut penser à d’autres auteurs qui ont parlé de leur mère et de leurs terres. On pensera bien sûr à Albert Cohen, un autre fils d’Algérie… Colette, Maxime Gorki, Louis, Romain Gary, Delphine de Vigan, Roland Barthes, Marguerite Duras, Philippe Labro, Alexandre Najjar, Peter Handke… Je retiens deux phrases fortes de deux écrivains du Maghreb, un Algérien et un Marocain :
Tous les Algériens gardent une sorte de sentiment de culpabilité vis-à-vis de leur mère, parce qu’ils se sont comportés – et souvent encore aujourd’hui – avec les femmes comme s’ils les niaient.
Kateb Yacine
J’ai toujours été choqué quand j’ai lu des livres où certains écrivains occidentaux règlent leurs comptes avec leurs parents. Chez nous, il y a une religion de l’amour filial.
Tahar Ben Jelloun
Smaïn Laacher rend une âme à l’écriture en étant à la fois fils d’une terre, héritier d’une culture et, désormais pleinement invité à vivre dans ce pays d’accueil qui a tant de mal à intégrer son histoire et les fils issus des évènements qui ont meurtri les corps et les esprits. Les silences de ce livre appellent à une parole. Merci, cher Smaïn.