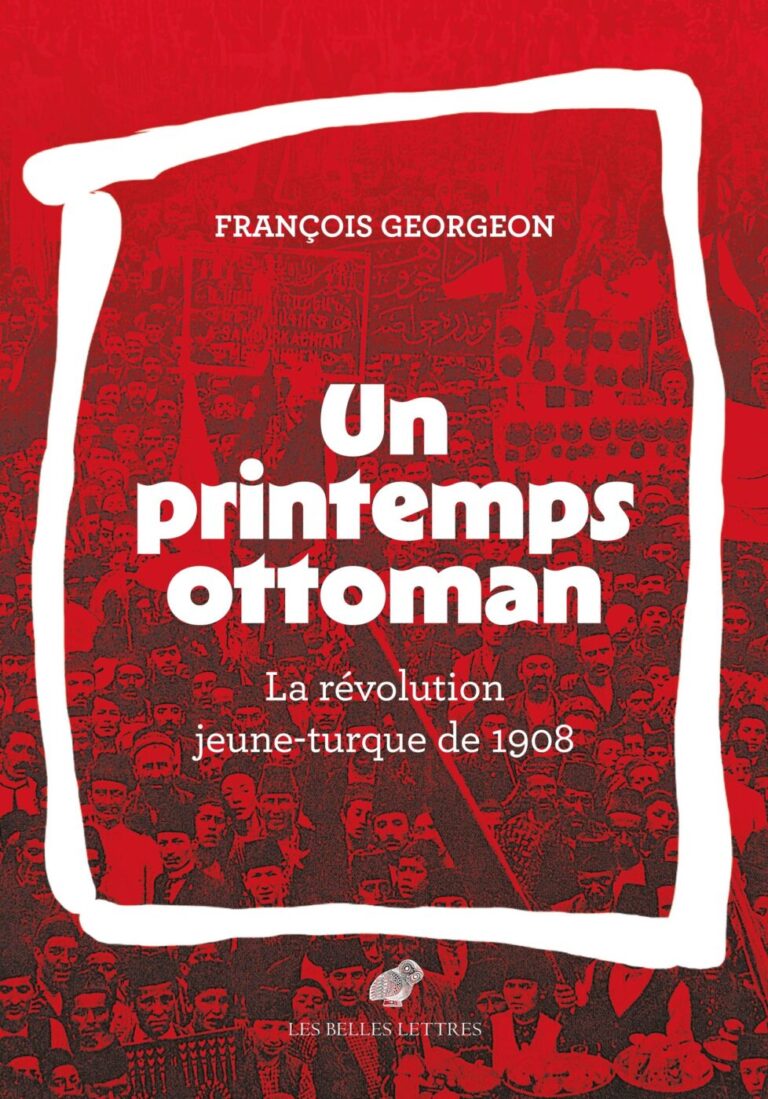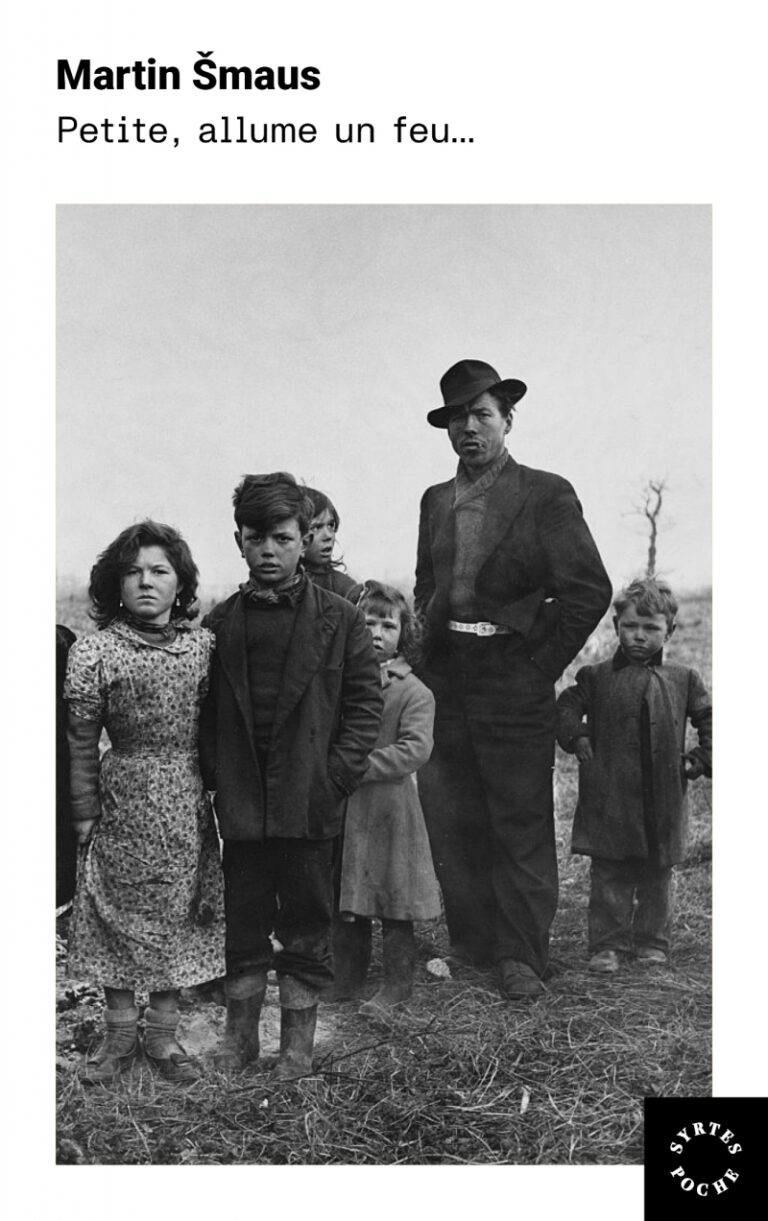Pierre Ansart, Naissance de l’anarchisme, Éditions L’échappée, 14/03/2025, 384 pages, 22€
Avec Naissance de l’anarchisme, Pierre Ansart entreprend de relire l’histoire des idées comme un processus d’insertion sociale, reliant gestes intellectuels et milieux d’émergence. En croisant trajectoire théorique et pratiques collectives, ce livre nous donne à voir comment se constitue une idéologie agissante. Le récit devient alors enquête : que voulait dire penser pour agir au XIXe siècle ?
Les dessous d’une idéologie insurgée
Il est des œuvres dont la puissance réside dans leur capacité à refuser le confort des synthèses établies. Celle de Pierre-Joseph Proudhon est de cette trempe, champ de bataille interprétatif où s’affrontent, depuis plus d’un siècle, des lectures irréconciliables. Plutôt que de s’enrôler dans ces querelles d’exégètes où chaque camp brandit un Proudhon taillé sur mesure – ici, le petit-bourgeois chancelant croqué par Marx ; là, le titan révolutionnaire adoubé par Bakounine ; ailleurs, le traditionaliste providentiel récupéré par les cercles de l’Action française –, Pierre Ansart, avec Naissance de l’anarchisme, déplace la focale. Son projet, d’une audace méthodologique remarquable, consiste en une excavation sociologique : il ne s’agit plus de savoir ce que Proudhon a dit, mais d’où il parlait, et quel écho sa parole trouvait dans les pratiques concrètes des classes laborieuses de son temps. L’auteur quitte la bibliothèque pour descendre dans l’atelier. Il postule que la genèse d’une pensée aussi radicale ne peut se comprendre par le seul jeu des influences intellectuelles, mais doit s’ancrer dans une expérience collective, dans un éthos particulier qui lui donne sa substance et sa direction. Ce geste inaugural fait de son livre une aventure intellectuelle où le lecteur assiste, en direct, à la transformation d’une conscience de classe en système philosophique.
Dans l’interstice, l’anarchie
Le cœur de la démonstration de Pierre Ansart repose sur la recherche minutieuse des « homologies structurales » entre la pensée proudhonienne et le monde social de la monarchie de Juillet. Ce n’est pas un simple reflet mécanique qu’il nous décrit, mais un jeu complexe de correspondances et de tensions. La France des années 1840 est un territoire économique éclaté : une grande industrie naissante, brutale et concentrée, coexiste avec un monde paysan encore dominant et, surtout, avec un artisanat manufacturier urbain, foisonnant et résilient. Cette hétérogénéité, ce combat permanent entre des logiques de production antagonistes, se retrouvent dans les contradictions mêmes de l’œuvre de Proudhon, qui oscille entre la critique implacable du monopole capitaliste et la défense acharnée d’une économie de petits producteurs autonomes. C’est dans cet interstice, dans cette zone grise où l’artisan n’est plus tout à fait maître mais pas encore simple prolétaire, que naît l’anarchisme.
Pierre Ansart tisse patiemment le fil qui mène des organisations traditionnelles, comme les compagnonnages – avec leurs rites, leurs hiérarchies, mais aussi leur puissante culture de la résistance –, aux sociétés de secours mutuels, ces embryons de solidarité moderne où s’invente une nouvelle praxis égalitaire. Mais le prototype historique de ce que Proudhon théorisera comme l’« anarchie positive » se trouve ailleurs : dans le mutuellisme des canuts lyonnais. L’auteur nous livre un portrait saisissant de ce milieu. Le chef d’atelier lyonnais n’est pas un sujet économique comme les autres. Propriétaire de ses métiers, gestionnaire de sa petite unité de production, il reste un salarié dépendant du marchand-fabricant qui lui commande les étoffes. Il est cet oxymore vivant, ce producteur-gestionnaire, qui vit l’exploitation non comme une fatalité misérable, mais comme une injustice rationnellement contestable. De cette condition ambivalente naît une pensée politique qui rejette avec une égale vigueur la tyrannie du capital et l’absorption de l’individu dans un communisme étatique. Le mutuellisme devient alors plus qu’une simple caisse d’entraide : il est une contre-société en acte, un laboratoire d’auto-organisation qui affirme la capacité des producteurs à gérer eux-mêmes l’économie, à créer un ordre sans État, une justice sans tribunaux, un contrat social sans Rousseau.
Le présent insoumis : quand Proudhon revient
Si Pierre Ansart ancre le proudhonisme dans son siècle, son analyse lui confère paradoxalement une stupéfiante actualité. Le modèle de l’« anarchie positive » – cet ordre spontané et fédératif émergeant de l’association libre des producteurs – n’a-t-il pas connu d’étranges récurrences, de l’effervescence des conseils ouvriers de 1917 aux assemblées des Zapatistes au Chiapas, des utopies autogestionnaires des années 1970 aux logiques des biens communs numériques ? Chaque fois que des collectifs cherchent à s’extraire de la double emprise de l’État et du Marché pour inventer des formes de vie et de production autonomes, c’est un peu de l’esprit du mutuellisme qui resurgit. Lire Pierre Ansart aujourd’hui, c’est donc être invité à réinterroger le mot même d’anarchie. Au-delà du cliché du chaos, on découvre une pensée exigeante de l’organisation, une critique radicale de toute forme d’autorité déléguée et non contrôlée, qu’elle soit politique, économique ou même intellectuelle. L’an-archos proudhonien n’est pas le désordre, mais la fin du commandement vertical, l’affirmation que la seule souveraineté légitime est celle qui circule horizontalement entre les associés.
Finalement, le tour de force de Naissance de l’anarchisme est de nous rendre Proudhon intensément contemporain, non comme une icône figée, mais comme un interlocuteur pour nos propres révoltes. Dans un monde saturé par des institutions bureaucratiques opaques et des plateformes numériques qui organisent notre travail et nos vies selon des logiques qui nous échappent, la question du canut lyonnais – qui contrôle réellement la production et à qui profite-t-elle ? – n’a rien perdu de son tranchant. Pierre Ansart nous montre que le projet proudhonien n’était pas une rêverie pour un avenir lointain, mais une stratégie pour agir ici et maintenant, pour reconquérir des parcelles de souveraineté dans le présent. En restituant à la pensée sa chair sociale, il nous rappelle que les idées les plus puissantes sont celles qui parviennent à nommer et à légitimer une pratique déjà là, murmurant son désir d’émancipation.