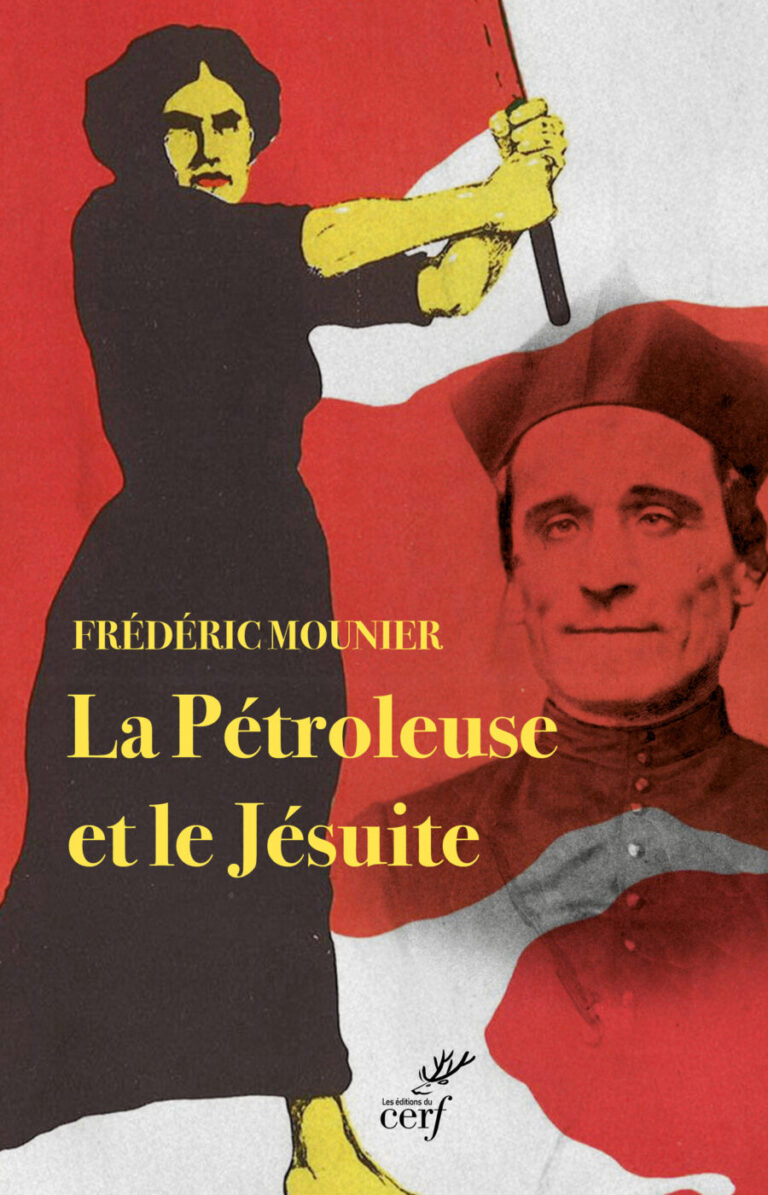Yuri Felshtinsky, Le Complot Da Vinci, traduction de Gilles Ceausescu, Les Éditions du Cerf, 15/05/2025, 272 pages, 22,00 €
Ecoutez notre Podcast
Et si la plus grande vente de l’histoire de l’art n’était qu’un écran de fumée ? Dans Le Complot Da Vinci, Yuri Felshtinsky suit l’itinéraire du Salvator Mundi pour en faire le révélateur d’une emprise discrète mais dévastatrice : celle de l’État russe sur le capitalisme globalisé. Le récit devient ainsi une chronique d’un monde en trompe-l’œil, où chaque toile cache un transfert de pouvoir, chaque collection une opération d’influence.
Derrière le marteau, l’ombre du Kremlin
Au cœur de l’hiver new-yorkais de 2017, le marteau du commissaire-priseur de Christie’s s’abat dans un bruit assourdissant, scellant la vente du Salvator Mundi, un panneau de noyer attribué, non sans controverses, à Léonard de Vinci, pour la somme délirante de 450,3 millions de dollars. Devant un parterre de collectionneurs et de curieux, une page de l’histoire du marché de l’art s’écrit, baignant la scène d’une lumière presque mythique. Pourtant, Yuri Felshtinsky, dans une enquête minutieuse et glaciale qui se lit comme le plus paranoïaque des romans d’espionnage, nous invite à regarder au-delà de cette frénésie savamment orchestrée. Ce n’est pas l’esthétique d’un Christ énigmatique qui l’intéresse, mais la transaction chiffrée, le signal envoyé à travers les continents, le symptôme d’une pathologie qui ronge les fondements du monde occidental. Ce coup de marteau, nous dit-il, n’était pas un point d’orgue, mais un point de départ ; la partie visible d’un iceberg de manœuvres où l’art sert de monnaie d’échange dans des guerres qui ne disent pas leur nom.
Dans le brouillard des paradis fiscaux et des salles de conseil feutrées, Yuri Felshtinsky fait apparaître, comme des silhouettes dans un film noir, les protagonistes de ce drame contemporain. D’un côté, Donald Trump, magnat de l’immobilier surendetté, dont l’empire vacillant cherche désespérément une perfusion de capitaux frais pour éviter un nouveau naufrage financier et politique. De l’autre, Dmitri Rybolovlev, oligarque au regard d’acier, produit des privatisations mafieuses de la Russie eltsinienne, qui a troqué son diplôme de cardiologue contre un empire de la potasse, naviguant avec une dextérité glaciale entre les bas-fonds du crime organisé de Perm et les salons du Kremlin. Et entre eux, l’homme de l’ombre, Yves Bouvier, roi des ports francs, ce marchand d’art singulier qui ne vend pas des toiles, mais des solutions logistiques, fiscales et discrétionnaires pour les fortunes nomades et nerveuses du globe. Ces trois figures, a priori étrangères les unes aux autres, voient leurs destins converger autour de quelques chefs-d’œuvre et de beaucoup d’argent, dessinant les contours d’une cartographie du pouvoir où les lignes ne suivent plus les frontières des États, mais les flux financiers opaques.
Yuri Felshtinsky saisit d’emblée que cette histoire ne peut se lire sur un seul plan. L’itinéraire du Salvator Mundi devient un fil d’Ariane qui nous guide dans un labyrinthe où chaque couloir révèle une nouvelle dimension du complot. Au niveau esthétique, la provenance douteuse du tableau et son état de conservation précaire sont un écho métaphorique de la fragilité des vérités officielles. Sur le plan financier, l’inflation vertigineuse du prix de l’œuvre illustre la déconnexion d’un marché de l’art transformé en lessiveuse de luxe pour capitaux sans origine. Enfin, et surtout, la dimension géopolitique, qui voit une toile de la Renaissance devenir un pion dans la stratégie d’influence de la Russie post-soviétique, un instrument silencieux pour installer une créance, une emprise, sur l’homme qui allait devenir le président de la première puissance mondiale.
La toile de l’oligarque
Le cas de Dmitri Rybolovlev, méticuleusement reconstitué par l’auteur, est un cours magistral sur la genèse de l’oligarchie russe et ses liens indéfectibles avec le pouvoir. Né de la “vente du siècle”, ce dépeçage méthodique des actifs de l’Union soviétique, Rybolovlev s’accapare Uralkali, l’un des joyaux de l’industrie potassique, non par génie entrepreneurial, mais par une succession d’alliances troubles, de pressions et de protections assurées par des figures du crime local et, plus décisivement, par des officiers du FSB, dont le général Sergueï Ezoubtchenko devient son “ange gardien” et son véritable commanditaire. Yuri Felshtinsky démontre, sans jamais forcer le trait, que l’oligarque russe n’est pas un capitaliste autonome, mais un opérateur de l’État, une courroie de transmission dont la fortune n’est qu’un prêt, révocable à tout instant par le Kremlin. Le “divorce du siècle” qui l’oppose à son ex-femme Elena devient une affaire d’État qui l’oblige à plonger dans les eaux troubles des systèmes judiciaires de Monaco et de Chypre, à corrompre, menacer, et finalement, à transformer ces États-européens-en-poche en extensions de son théâtre d’opérations.
L’acquisition de biens devient alors une stratégie d’influence, une méthode pour tisser une toile d’accès et de dépendances. Le club de football de l’AS Monaco n’est pas un caprice de milliardaire ; il est le sésame qui ouvre les portes du palais princier, le moyen de placer ses hommes au sommet de la police et de la justice monégasques. Les yachts, les villas fastueuses à travers le monde, les fêtes somptueuses peuplées de jeunes femmes venues de l’Est via des agences spécialisées, et surtout, l’art, sont autant d’instruments de soft power destinés à acheter une respectabilité, à graisser des rouages, à se constituer un réseau de obligés. Dans ce dispositif, chaque dépense est un investissement, chaque cadeau une créance, chaque collection un arsenal. L’art n’est plus une fin, mais un moyen, la monnaie la plus discrète et la plus portable pour des transactions qui ne doivent laisser aucune trace.
C’est dans cette logique que s’inscrit la relation avec Donald Trump. Au moment de la crise financière de 2008, l’empire Trump est au bord du gouffre. Les banques occidentales lui ont fermé leurs portes. C’est alors que surgit Rybolovlev qui, en achetant pour 95 millions de dollars une villa en Floride que Trump avait acquise pour 41 millions et peinait à vendre, réalise bien plus qu’une mauvaise affaire immobilière. Il opère une transfusion financière qui sauve Trump du désastre et, de fait, le place en position de débiteur. Cette transaction, incompréhensible selon les logiques du marché, devient parfaitement claire lorsqu’on la replace dans le contexte d’une opération d’influence à long terme, supervisée depuis Moscou. Trump devient, à cet instant précis, un “actif” potentiel, un homme tenu par une dette dont la valeur n’est pas seulement monétaire, mais politique. Il est désormais sur la laisse du Kremlin.
L’Art de la guerre hybride
En fermant Le Complot Da Vinci, le lecteur est confronté à l’ambivalence d’un genre littéraire nouveau : le document implacable qui se lit comme un thriller postmoderne. Yuri Felshtinsky ne spécule pas, il accumule les faits, les dates, les noms, les procès-verbaux, les extraits de presse, tissant une toile factuelle si dense qu’elle finit par générer un vertige de fiction. La réalité, dans ce qu’elle a de plus brut et de plus documenté, dépasse les scénarios les plus invraisemblables. On sort de cette lecture avec la conviction troublante que l’enquête journalistique et le roman d’espionnage ne sont plus deux genres distincts, mais deux manières de raconter une même dissolution du réel dans des stratégies de manipulation globales.
Ce livre est ainsi le symptôme d’un basculement civilisationnel. Il décrit avec une froideur clinique comment l’État profond russe, héritier direct des méthodes et du personnel du KGB, a compris et retourné contre l’Occident les armes mêmes du capitalisme : la finance offshore, les zones de non-droit fiscal, la porosité des systèmes judiciaires, le culte de l’argent et la vénalité des élites. La capture systémique qu’il expose n’est pas celle d’un État par un autre via la force militaire, mais une OPA silencieuse menée à coups de milliards, où l’Occident est vendu à la découpe, tableau par tableau, conscience par conscience, jusqu’à ce que ses institutions – justice, politique, médias – soient si creuses qu’elles ne deviennent que des coquilles vides.
Le Salvator Mundi termine donc ce long périple comme un miroir noir, renvoyant l’image non d’un sauveur divin, mais d’une civilisation en proie au doute, fascinée par ses propres reflets et vulnérable à ceux qui maîtrisent l’art de les manipuler. L’œuvre de Yuri Felshtinsky, en sus de répondre à la question de savoir comment Poutine tient Trump ; elle nous en pose une, bien plus essentielle : jusqu’où l’art, ce supposé refuge de l’esprit, peut-il dissimuler l’empire du crime et le crime de l’empire ? La question reste, et elle résonne avec une urgence sinistre dans le silence de nos musées et de nos démocraties.